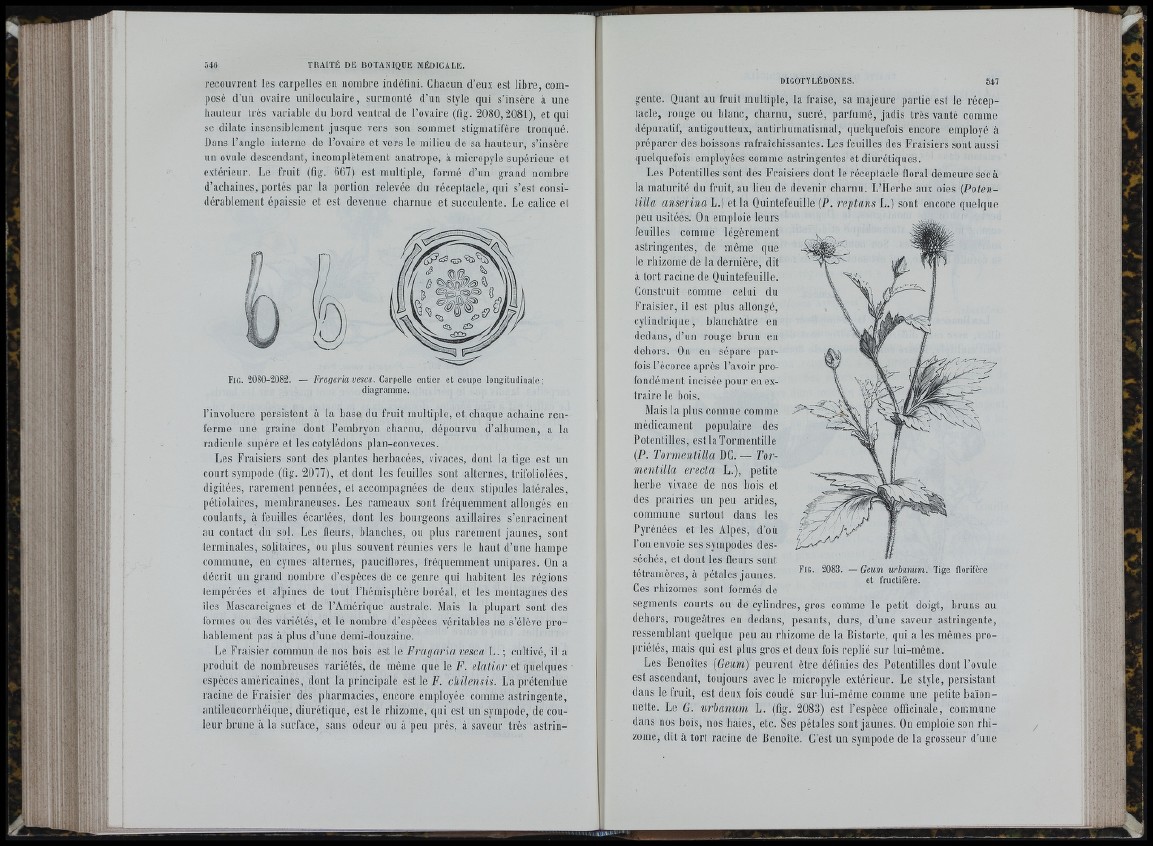
" :P-'
i k i i l
IB"
/ : "
-i
.1ÎT7-"
recouvrent les carpelles en nombre indéfmi. Cbacun d’eux est libre, composé
d’un ovaire uniloculaire, surmonté d’un style qui s’insère à une
bauteur très variable du bord ventral de l’ovaire (fig. 2080,2081), et qui
se dilate insensiblement jusque vers son sommet stigmatifère tronqué.
Dans l’angle interne de l’ovaire et vers le milieu de sa bauteur, s’insère
nn ovule descendant, incomplètement anatrope, à micropyle supérieur et
extérieur. Le fruit (fig. GG7) est multiple, formé d’un grand nombre
d’acbaines, portés par la portion relevée du réceptacle, qui s’est considérablement
épaissie et est devenue cbarnue et succulente. Le calice el
F ig . 2080-2082. — Fragaria vesca. Carpelle entier et coupe lo ngitudin ale ;
diagramme.
l’involucre persistent à la base du fruit multiple, et chaque achaine renferme
une graine dont l’embryon cbarnu, dépourvu d’albumen, a la
radicule supère et les cotylédons plan-convexes.
Les Lraisiers sont des plantes herbacées, vivaces, dont la tige est un
court sympode (fig. 2077), et dont les feuilles sont alternes, trifoliolées,
digitées, rarement pennées, et accompagnées de deux stipules latérales,
pétiolaires, membraneuses. Les rameaux sont fréquemment allongés en
coulants, à feuilles écartées, dont les bourgeons axiliaires s’enracinent
au contact du sol. Les fleurs, blancbes, ou plus rarement jaunes, sont
terminales, solitaires, ou plus souvent réunies vers le haut d’iiiie hampe
commune, en cymes alternes, pauciflores, fréquemment unipares. On a
décrit un grand nombre d’espèces de ce genre qui babitent les régions
tempérées et alpines de tout l’bémisphère boréal, et les montagnes des
des Mascareigues et de l ’Amérique australe. Mais la plupart sont des
formes ou des variétés, et le nombre d’espèces véritables ne s’élève probablement
pas à plus d’une demi-douzaine.
Le Fraisier commun de nos bois est le Fragar ia vesca L. ; cultivé, il a
produit de nombreuses variétés, de môme que le F. elatior et quelques
espèces américaines, dont la principale est le U. chilensis. La prétendue
racine de Fraisier des pharmacies, encore employée comme astringente,
aiitileucorrbéique, diurétique, est le rbizome, qui est un sympode, de couleur
brune à la surface, sans odeur ou à peu près, à saveur très astringente.
Quant au fruit multiple, la fraise, sa majeure partie est le réceptacle,
rouge ou blanc, charnu, sucré, parfumé, jadis très vanté comme
dépuratif, antigoutteux, anlirhumatismal, quelquefois encore employé à
préparer des boissons rafraîchissantes. Les feuilles des Fraisiers sont aussi
quelquefois employées comme astringentes et diurétiques.
Les Potentilles sont des Fraisiers dont le réceptacle floral demeure sec à
la maturité du fruit, au lieu de devenir charnu. L’Herbe aux oies {Poten-
tilla anserina L.) et la Quintefeiiille {P. reptans L.) sont encore quelque
peu usitées. On emploie leurs
feuilles comme légèrement
astringentes, de même que
le rhizome de la dernière, dit
à tort racine de Quintefeiiille.
Construit comme celui du
Fraisier, il est plus allongé,
cylindrique, blanchâtre en
dedans, d’un rouge brun en
dehors. On en sépare parfois
Técorce après l’avoir profondément
incisée pour en extraire
le bois.
Mais la plus connue comme
médicament populaire des
Potentilles, estlaTormentille
(P. Tormentilla DG. —■ Tor-
mentilla erecta L.), petite
berbe vivace de nos bois et
des prairies un peu arides,
commune surtout dans les
Pyrénées et les Alpes, d’où
l’on envoie scs sympodes desséchés,
et dont les fleurs sont
F ig . 2083. Geum urbanum. Tige florifère
tétramères, â pétales jaunes.
et fructifère.
Ges rbizomes sont formés de
segments courts ou de cylindres, gros comme le petit doigt, bruns au
dehors, rougeâtres en dedans, pesants, durs, d’une saveur astringente,
ressemblant quelque peu au rhizome de la Bistorte, qui a les mêmes propriétés,
mais qui esl plus gros et deux fois replié sur lui-même.
Les Benoîtes (Geum) peuvent être définies des Potentilles dont l’ovule
est ascendant, toujours avec le micropyle extérieur. Le style, persistant
dans le fruit, est deux fois coudé sur lui-même comme une petite baïonnette.
Le G. urbanum L. (fig. 2083) est l’espèce officinale, commune
dans nos bois, nos haies, etc. Ses pétales sont jaunes. On emploie son rbizome,
dit â tort racine de Benoîte. G’est un sympode de la grosseur d’une
• .'Vk