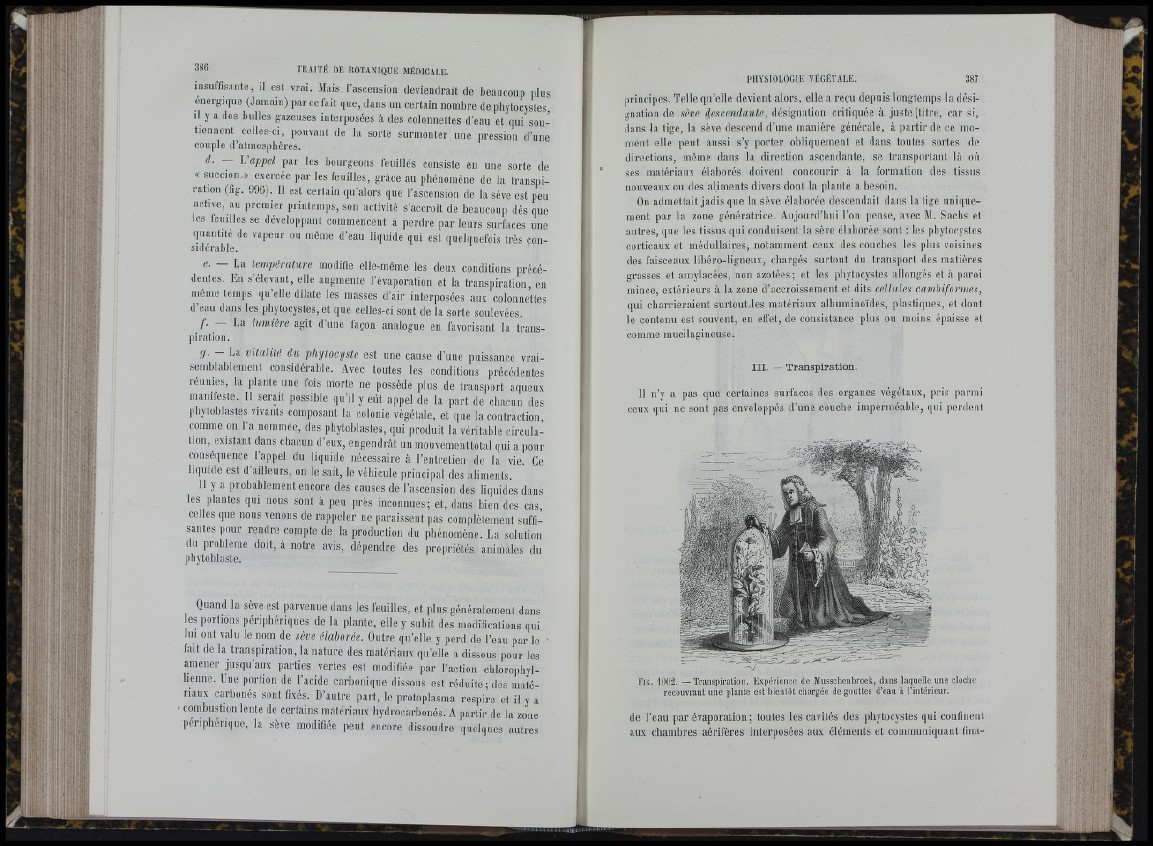
insuffisante, il est vrai, 3Iais. l ’ascension deviendrait de beaucoup plus
énergique (Jamain) par ce fait que, dans un certain nombre de pbytocystes,
il y a des bulles gazeuses interposées à des colonnettes d’eau et qui soutiennent
celles-ci, pouvant de la sorte surmonter une pression d’une
couple d’atmospbères.
d. L appel par les bourgeons feuillés consiste en une sorte de
« succion » exercée par les feuilles, grâce au pbénomène de la transpiration
(fig. 996). II est certain qu’alors que l’ascension de la sève est peu
active, au premier printemps, son activité s’accroît de beaucoup dès que
les feuilles se développant commencent à perdre par leurs surfaces une
quantité de vapeur ou même d’eau liquide qui est quelquefois très considérable.
e. La température modifie elle-même les deux conditions précédentes.
En s’élevant, elle augmente l ’évaporation et la transpiration, en
même temps qu’elle dilate les masses d’air interposées aux colonnettes
d’eau dans les phytocystes, et que celles-ci sont de la sorte soulevées.
_ f- lumière agit d’une façon analogue en favorisant la transpiration.
g. La vitalité du phytocyste est une cause d’une puissance vraisemblablement
considérable. Avec toutes les conditions précédentes
réunies, la plante une fois morte ne possède plus de transport aqueux
manifeste. II serait possible qu’il y eût appel de la part de chacun des
phytoblastes vivants composant la colonie végétale, et que la contraction,
comme on l ’a nommée, des phytoblastes, qui produit la véritable circulation,
existant dans chacun d’eux, engendrât un mouvementtotal qui a pour
conséquence l’appel du liquide nécessaire à l’entretien de la vie. Ce
liquide est d ailleurs, on le sait, le véhicule principal des aliments.
11 y a probablement encore des causes de l’ascension des liquides dans
les plantes qui nous sont à peu près inconnues; et, dans bien des cas,
celles que nous venons de rappeler ne paraissent pas complètement suffisantes
pour rendre compte de la production du phénomène. La solution
du pioblème doit, à notre avis, dépendre des propriétés animales du
phytoblaste.
Quand la sève est parvenue dans les leiiilles, et plus généralement dans
les portions périphériques de la plante, elle y subit des modifications qui
liu ont valu ie nom de séve élaborée. Outre qu’elle y perd de l’eau par le
fait de la tran ^ ira tio n , la nature des matériaux qu’elle a dissous pour les
amener jusqu’aux parties vertes est modifiée par l’action chlorophyllienne.
Une portion de l’acide carbonique dissous est réduite ; des matériaux
carbonés sont fixés. D’autre part, le protoplasma respire et il y a
combustion lente de certains matériaux hydrocarbonés. A partir de la zone
périphérique, la sève modifiée peut encore dissoudre quelques autres
principes. Telle qu’elle devient alors, elle a reçu depuis longtemps la désignation
de séve descendante, désignation critiquée à juste [titre, car si,
dans la tige, la sève descend d’une manière générale, à partir de ce moment
elle peut aussi s’y porter obliquement et dans toutes sortes de
directions, même dans la direction ascendante, se transportant là où
ses matériaux élaborés doivent concourir à la formation des tissus
nouveaux ou des aliments divers dont la plante a besoin.
On admettait jadis que la sève élaborée descendait dans la lige uniquement
par la zone génératrice. Aujourd’hui l’on pense, avec M. Sachs et
autres, que les tissus qui conduisent la sève élaborée sont : les phytocystes
corticaux et médullaires, notamment ceux des coucbes les plus voisines
des faisceaux libéro-ligneux, chargés surtout du transport des matières
grasses et amylacées, non azotées ; et les pbytocystes allongés el à paroi
mince, extérieurs à la zone d’accroissement et dits cellules cambiformes,
qui charrieraient surtout les matériaux albuminoïdes, plastiques, et dont
le contenu est souvent, en effet, de consistance plus ou moins épaisse et
comme mucilaginense.
III. — Transpiration.
Il n’y a pas que certaines surfaces des organes végétaux, pris parmi
ceux qui ne sont pas enveloppés d’une couche imperméable, qui perdent
Fig. 1002. — Transpiration. Expérience de Musschenbroek, dans laquelle une cloche
recouvrant une plante est bientôt chargée de gouttes d’eau à l’intérieur.
de l’eau par évaporation; toutes les cavités des phytocystes qui confinent
aux chambres aérifères interposées aux éléments et communiquant fina