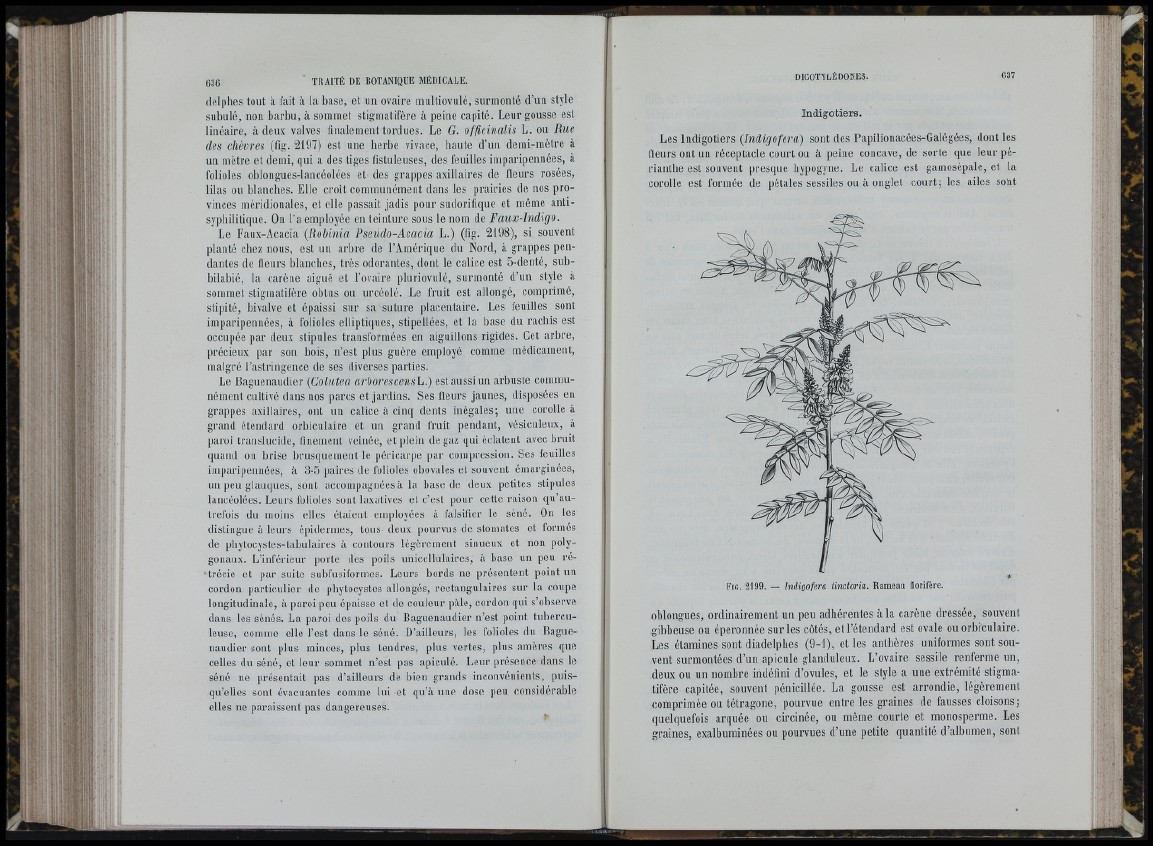
' i '1li
r:
"iil:
t U
(lelphes tout à fait à la base, et un ovaire multiovulé, surmonté d’un style
subulé, non barbu, à sommet stigmatifère à peine capité. Leur gousse est
linéaire, à deux valves finalement tordues. Le G. officinalis L. ou Rue
des chèvres (fig. 2197) est nue herbe vivace, baute d’un demi-mètre à
un mètre et demi, qui a des tiges fistuleuses, des feuilles imparipennées, à
folioles oblongues-lancéolées et des grappes axiliaires de fleurs rosées,
lilas ou blancbes. Elle croît communémeiit dans les prairies de nos provinces
méridionales, et elle passait jadis pour sudorifique et même anti-
sypbilitique. On l'a employée en teinture sous le nom de Faux- Indigo.
Le Laux-Acacia (Robinia Pseudo-Acacia L.) (fig. 2198), si souvent
planté chez nous, est un arbre de l’Amérique du Nord, à grappes pendantes
de fleurs blancbes, très odorantes, dont le calice est 5-denté, sub-
bilabié, la carène aiguë et l’ovaire pluriovulé, surmonté d’un style a
sommet stigmatifère obtus ou urccolé. Le fruit est allongé, comprimé,
stipité, bivalve et épaissi sur sa suture placentaire. Les feuilles sont
imparipennées, à folioles elliptiques, stipellées, et la base du racbis est
occupée par deux stipules transformées en aiguillons rigides. Cet arbre,
précieux par son bois, n’est plus guère employé comme médicament,
malgré l’astringence de ses diverses parties.
Le Bagnenandier (Colutea arborescensh.) est aussi un arbuste communément
cultivé dans nos parcs et jardins. Ses fleurs jaunes, disposées en
grappes axiliaires, ont un calice à cinq dents inégales; une corolle à
grand étendard orbiculaire et un grand fruit pendant, vésiculeux, à
paroi translucide, finement veinée, et plein de gaz qui éclatent avec bruit
quand on brise brusquement le péricarpe par compression. Ses feuilles
imparipennées, à 3-5 paires de folioles obovales et souvent émarginées,
un peu glauques, sont accompagnées à la base de deux petites stipules
lancéolées. Leurs folioles sont laxatives et c’est pour cette raison qu’autrefois
dn moins elles étaient employées à falsifier le séné. On les
distingue à leurs épidermes, tous deux pourvus de stomates et formés
de pbytocystes-labulaires à contours légèrement sinueux et non polygonaux.
L’inférieur porte des poils unicellulaires, à base un peu rétrécie
et par suite subfusiformes. Leurs bords ne présentent point un
cordon particulier de pbytocystes allongés, rectangulaires sur la coupe
longitudinale, à paroi peu épaisse et de couleur pâle, cordon qui s’observe
dans les sénés. La paroi des poils du Bagnenandier n’est point tuberculeuse,
comme elle l’est dans le séné. D’ailleurs, les folioles du Bague-
naudier sont plus minces, plus tendres, plus vertes, plus amères que
celles du séné, et leur sommet n’est pas apiculé. Leur présence dans le
séné ne présentait pas d’ailleurs de bien grands inconvénients, puisqu’elles
sont évacuantes comme lui et qu’â une dose peu considérable
elles ne paraissent pas dangereuses.
toi;.
Indigotiers.
Les Indigotiers (Indigofera) sont des Papilionacées-Galégées, dont les
fleurs ont un réceptacle court ou â peine concave, de sorte que leur périantbe
est souvent presque bypogyne. Le calice est gamosépale, et la
corolle est formée de pétales sessiles ou â onglet court; les ailes sont
Fig. 2199. — Indigofera tinctoria. Rameau florifère.
oblongues, ordinairement un peu adhérentes â la carène dressée, souvent
gibbeuse ou éperonnée sur les côtés, et l’étendard est ovale ou orbiculaire.
Les étamines sont diadelpbes (9-1), et les anthères uniformes sont souvent
surmontées d’un apiculé glanduleux. L’ovaire sessile renferme un,
deux ou un nombre indéfmi d’ovules, et le style a une extrémité stigmatifère
capitée, souvent pénicillée. La gousse est arrondie, légèrement
comprimée ou tétragone, pourvue entre les graines de fausses cloisons;
quelquefois arquée ou circinée, ou même courte et monosperme. Les
graines, exalbuminées ou pourvues d’une petite quantité d’albumen, sont
f f- :
il-!l i l i II
l'i, „.'toj