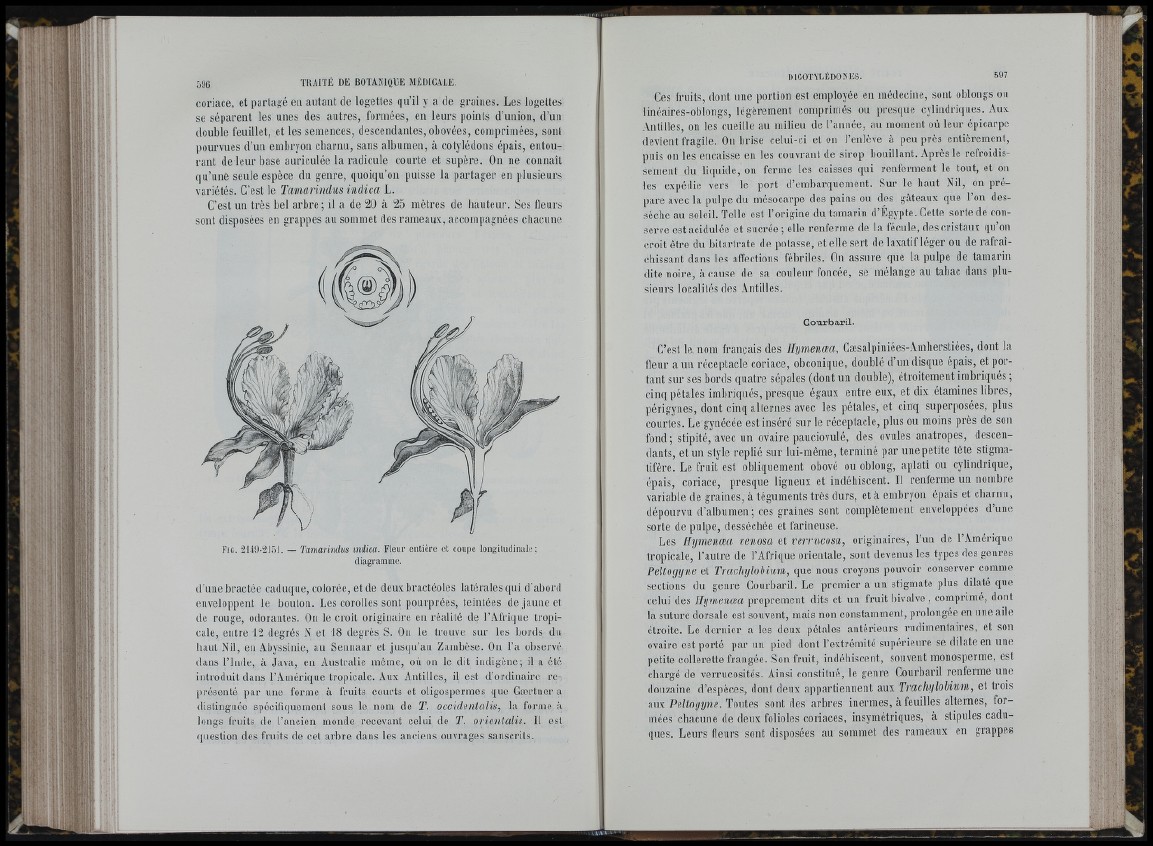
■' to 'i!l
coriace, et partagé eu autant de logettes qu’il y a de graines. Les logettes
se séparent les uues des autres, formées, en leurs points d’union, d’un
double feuillet, et les semences, descendantes, obovées, comprimées, sont
pourvues d’un embryon cbarnu, sans albumen, à cotylédons épais, entourant
de leur base auriculée la radicule courte et supère. Ou ue connaît
qu’une seule espèce du genre, quoiqu’on puisse la partager en plusieurs
variétés. C’est le Tamarindus indica L.
C’est uu très bel arbre ; il a de 20 à 25 mètres de bauteur. Scs fleurs
sont disposées eu grappes au sommet des rameaux, accompagnées cliacune
Fig. 2149-2151. Tamarindus indica. Fleur entière et coupe longitudinale;
diagramme.
ti’uiie bractée caduque, colorée, et de deux bractéoles latérales qui d’aborti
enveloppent le boulon. Les corolles sont pourprées, teintées de jaune el
de rouge, odorantes. Ou le croit originaire en réalité de l’Afrique tropicale,
entre 12 degrés N et 18 degrés S. Ou le trouve sur les bords du
liant Nil, en Abyssinie, au Sennaar et jusqu’au Zambèse. Ou l’a observé
dans l’Inde, à Java, en Australie même, où on le dit indigène; il a été
introduit dans l’Amérique tropicale. Aux Antilles, il est d’ordinaire représenté
par une forme à fruits courts et oligospermes que Gærtuer a
distinguée spcciliquemeiit sous le nom de 2’. occidentalis, la forme à
longs fruits de l’ancien monde recevant celui de T. orientalis. Il esl
(juestion des fruits de cet arbre dans les anciens ouvrages sanscrits.
Ces fruits, dont une portion est employée en médecine, sont oblongs ou
linéaires-oblongs, légèrement comprimés ou presque cylindriques. Aux
Antilles, 011 les cueille au milieu de l’année, au moment où leur épicarpe
devient fragile. Ou brise celui-ci et on l’enlève à peu près entièrement,
puis ou les encaisse eu les couvrant de sirop bouillant. Après le refroidissement
du liquide, ou ferme les caisses qui renferment le tout, et ou
les expédie vers le port d’embarquement. Sur le baut Nil, on prépare
avec la pulpe du mésocarpe des pains ou des gâteaux que l’on des-
sècbe au soleil. Telle est l’origine du tamarin d’Égypte. Celte sorte de conserve
est acidulée et sucrée ; elle renferme de la lécule, des cristaux qu ou
croit être du bitartrate de potasse, et elle sert de laxatif léger ou de rafraî-
cbissaut daus les affections fébriles. Ou assure que la pulpe de tamarin
dite noire, â cause de sa couleur foncée, se mélange au tabac dans plusieurs
localités des Antilles.
to/riik;
Gourbaril.
C’est le. nom français des Hymenæa, Cæsalpiniées-Amberstiées, dont la
lleur a uu réceptacle coriace, obconique, doublé d’un disque épais, et portant
sur ses bords quatre sépales (dont un double), étroitement imbriqués ;
cinq pétales imbriqués, presque égaux entre eux, et dix étamines libres,
périgynes, dont cinq alternes avec les pétales, et cinq superposées, plus
courtes. Le gynécée est inséré sur le réceptacle, plus ou moins près de son
fond ; stipité, avec un ovaire pauciovulé, des ovules anatropes, descendants,
et un style replié sur lui-même, terminé par une petite tête stigmatifère.
Le fruit est obliquement obové ou oblong, aplati ou cylindrique,
épais, coriace, presque ligneux et indébiscent. Il renferme un nombre
variable de graines, â téguments très durs, et â embryon épais et cbarnu,
dépourvu d’albumen; ces graines sont complètement enveloppées d’une
sorte de pulpe, dessécbée et farineuse.
Les Hymenæa venosa et verrucosa, originaires, l’un de l’Amérique
tropicale, l’autre de l’Afrique orientale, sont devenus les types des genres
Peltogyne et Trachylobium, que nous croyons pouvoir conserver comme
sections du genre Courbaril. Le premier a un stigmate plus dilaté que
celui des Hymenæa proprement dits et un fruit bivalve, comprimé, dont
la suture dorsale est souvent, mais non constamment, prolongée en une aile
étroite. Le dernier a les deux pétales antérieurs rudimentaires, et sou
ovaire est porté par un pied dont l’extrémité supérieure se dilate en une
petite collerette frangée. Son fruit, indébiscent, souvent monosperme, est
cbargé de verrucosités. Ainsi constitué, le genre Courbaril renferme une
douzaine d’espèces, dont deux appartiennent aux Trachylobium, et trois
aux Peltogyne. Toutes sont des arbres inermes, â feuilles alternes, formées
cbacune de deux folioles coriaces, insymétriques, à stipules caduques.
Leurs fleurs sont disposées au sommet des rameaux en grappes