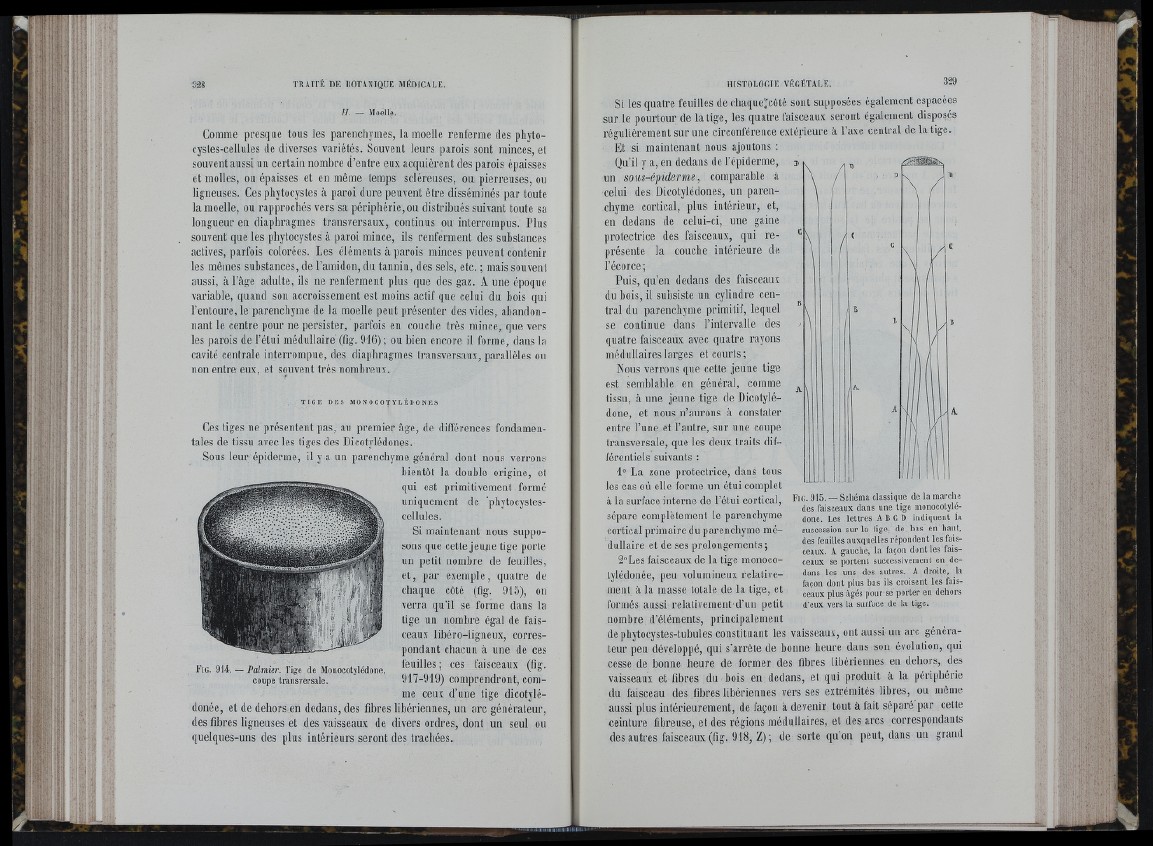
toi
î’ '
i
k-Î (
. .1 Ai
i a
..i£' - -ii: . . . . . . «)|
II. Moelle.
Comme presque tous les parenchymes, la moelle renferme des phylo-
cystes-cellules de diverses variétés. Souvent leurs parois sont minces, el
souvent aussi un certain nombre d’entre eux acquièrent des parois épaisses
et molles, ou épaisses et en même temps scléreuses, ou pierreuses, ou
ligneuses. Ces phytocystes à paroi dure peuvent être disséminés par toute
la moelle, ou rapprochés vers sa périphérie, ou distribués suivant toute sa
longueur en diaphragmes transversaux, continus ou interrompus. Plus
souvent que les pbytocystes cà paroi mince, ils renferment des substances
actives, parfois colorées. Les éléments à parois minces peuvent contenir
les mêmes substances, de l’amidon, du tannin, des sels, etc. ; mais souvent
aussi, à l’âge adulte, ils ne renferment plus que des gaz. A une époque
variable, quand son accroissement est moins actif qne celui du bois qui
l’entoure, le parenchyme de la moelle peut présenter des vides, abandonnant
le centre pour ne persister, parfois en couche très mince, que vers
les parois de l’étui médullaire (fig. 91G); ou bien encore il forme, dans la
cavité centrale interrompue, des diaphragmes transversaux, parallèles on
non entre eux, et souvent très nombreux.
TIGE DES MONOCOTYL ÉDONE S
Ces tiges ne présentent pas, an premier âge, de différences fondamentales
de tissu avec les tiges des Dicotylédones.
Sous leur épiderme, il y a un parenchyme général dont nous verrons
bientôt la double origine, et
qui est primitivement formé
uniquement de 'phytocystes-
cellules.
Si maintenant nous supposons
que cette jeune tige porte
un petit nombre de feuilles,
e t , par exemple, quatre de
chaque côté (fig. 915), on
verra qu’il se forme dans la
lige un nombre égal de faisceaux
libéro-ligneux, correspondant
chacun à une de ces
feuilles ; ces faisceaux (fig.
917-919) comprendront, comme
ceux d’nne tige dicotylédonée,
Eig. 914. — Palmier. Tige de Monocotylédone,
coupe transversale.
et de dehors en dedans, des fibres libériennes, un arc générateur,
des fibres ligneuses et des vaisseaux de divers ordres, dont un seul on
quelques-uns des plus intérieurs seront des trachées.
I
Si les quatre feuilles de cbaque’côté sont supposées également espacées
sur le pourtour de la lige, les quatre faisceaux seront également disposés
régulièrement sur une circonférence extérieure à l’axe central de la tige.
Lt si maintenant nous ajoutons ;
Qu’il y a, en dedans de Tépiderme,
un sous-épiderme, comparable â
celui des Dicotylédones, un parenchyme
/
A \
cortical, plus intérieur, et,
en dedans de celui-ci, une gaine
protectrice des faisceaux, qui re présente
la couche intérieure de
Técorce;
Puis, qu’en dedans des faisceaux
du bois, il subsiste un cylindre central
du parenchyme primitif, lequel
se continue dans l’intervalle des
quatre faisceaux avec quatre rayons
médullaires larges et courts ;
Nous verrons que cette jeune tige
est semblable en général, comme
tissu, à une jeune tige de Dicotylédone,
et nous n’aurons à constater
entre Tune et Tanlre, sur une coupe
transversale, que les deux traits différentiels
suivants :
1® La zone protectrice, dans tous
les cas où elle forme un étui complet
à la surface interne de Tétni cortical,
sépare complètement le parenchyme
cortical primaire du parenchyme médullaire
et de ses prolongements;
2® Les faisceaux de la tige monoco-
tylédonée, peu volumineux relativement
à la masse totale de la tige, et
FiG. 915. — Schéma classique de la marche
des faisceaux dans une tige monocotylédone.
Les lettres A B G D indiquent la
succession sur la tige, de bas en haut,
des feuilles auxquelles répondent les faisceaux.
A gauche, la façon dont les faisceaux
se portent successivement en dedans
les uns des autres. A droite, la
façon dont plus bas ils croisent les faisceaux
plus âgés pour se porter en dehors
formés aussi relativement'd’un petit
d’eux vers la surface de la tige.
nombre d’éléments, principalement
de phytocystes-tubules constituant les vaisseaux, ont aussi un arc générateur
peu développé, qui s’arrête de bonne heure dans son évolution, qui
cesse de bonne heure de former des fibres libériennes en dehors, des
vaisseaux et fibres du bois en dedans, et qui produit à la périphérie
du faisceau des fibres libériennes vers ses extrémités libres, ou même
aussi plus intérieurement, de façon à devenir tout à fait séparé par cette
ceinture fibreuse, et des régions médullaires, et des arcs correspondants
des autres faisceaux (fig. 918, Z) ; de sorte qn’on peut, dans un grand