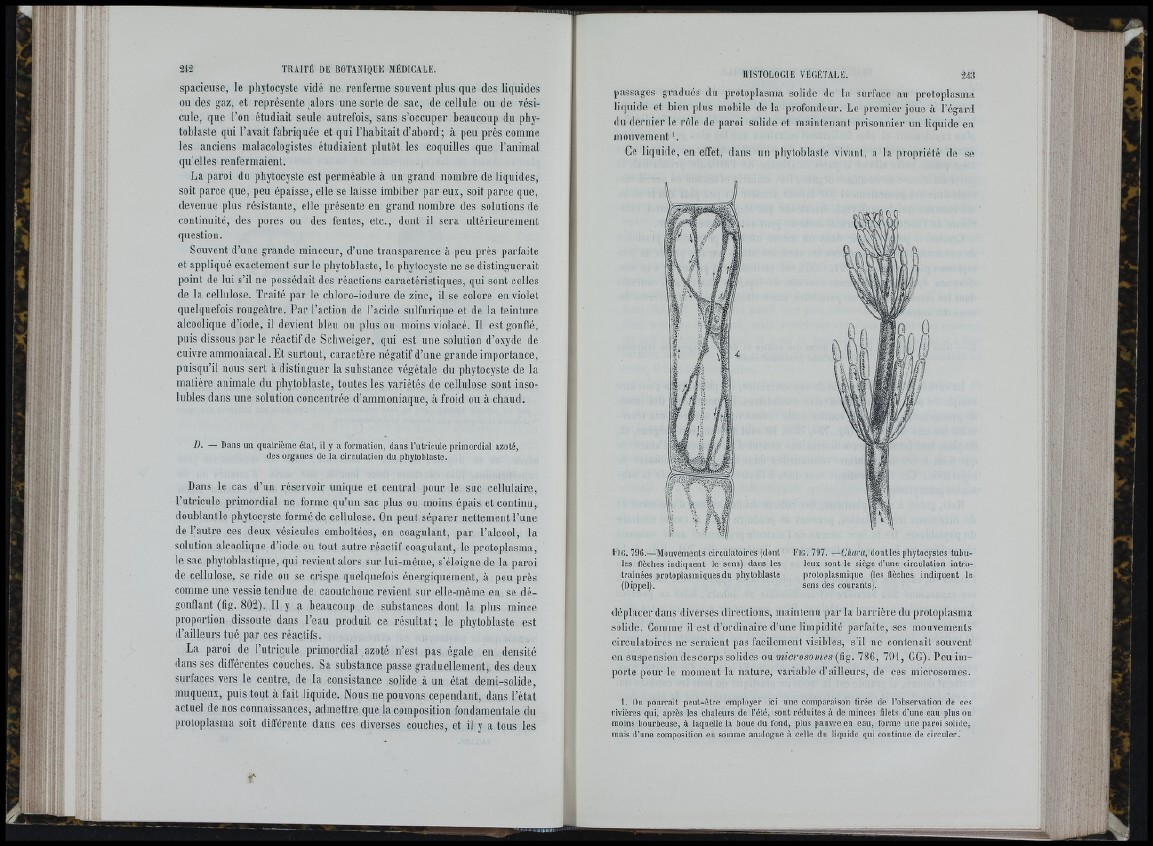
ì'Z
k ■
Gii '■
;ï i
1
: ? „
spacieuse, le phytocyste vidé ne renferme souvent plus que des liquides
ou des gaz, et représente alors une sorte de sac, de cellule ou de vésicule,
que l’on étudiait seule autrefois, sans s’occuper beaucoup du phytoblaste
qui l’avait fabriquée et qui l ’habitait d’abord ; à peu près comme
les anciens malacologistes étudiaient plutôt les coquilles que l’animal
qu’elles renfermaient.
La paroi du phytocyste est perméable à un grand nombre de liquides,
soit parce que, peu épaisse, elle se laisse imbiber par eux, soit parce que,
devenue plus résistante, elle présente en grand nombre des solutions de
continuité, des pores ou des fentes, etc., dont il sera ultérieurement
question.
Souvent d’une grande minceur, d’une transparence à peu près parfaite
et appliqué exactement sur le phytoblaste, le phytocyste ne se distinguerait
point de lui s’il ne possédait des réactions caractéristiques, qui sont celles
de la cellulose. Traité par le chloro-iodure de zinc, il se colore en violet
quelquefois rougeâtre. Par l’action de l’acide siilfurique et de la teinture
alcoolique d’iode, il devient bleu ou plus ou moins violacé. Il est gonflé,
puis dissous par le réactif de Schweiger, qui est une solution d’oxyde de
cuivre ammoniacal. Et surtout, caractère négatif d’nne grande importance,
puisqu’il nous sert à distinguer la substance végétale du phytocyste de la
matière animale du phytoblaste, toutes les variétés de cellulose sont insolubles
dans une solution concentrée d’ammoniaque, à froid ou à chaud.
jD- — Dans un quatrième état, il y a formation, dans l ’utricule primordial azoté,
des organes de la circulation du phytoblaste.
Dans le cas d’un réservoir unique et central pour le suc cellulaire,
l’utricule primordial ne forme qu’un sac plus ou moins épais et continu,
doublantle phytocyste formé de cellulose. On peut séparer nettement l’une
de l’autre ces deux vésicules emboîtées, en coagulant, par l ’alcool, la
solution alcoolique d’iode ou tout autre réactif coagulant, le protoplasma,
le sac phytoblastique, qui revient alors sur lui-même, s'éloigne de la paroi
de cellulose, se ride ou se crispe quelquefois énergiquement, à peu près
comme une vessie tendue de caoutchouc revient sur elle-même en se dégonflant
(fig. 802). Il y a beaucoup de substances dont la plus mince
proportion dissoute dans l’eau produit ce résultat ; le phytoblaste est
d’ailleurs tué par ces réactifs.
La paroi de l’utricule primordial azoté n’est pas égale en densité
dans ses différentes couches. Sa substance passe graduellement, des deux
surfaces vers le centre, de la consistance solide à un état demi-solide,
muqueux, puis tout à fait liquide. Nous ne pouvons cependant, dans l’état
actuel de nos connaissances, admettre que la composition fondamentale du
protoplasma soit différente dans ces diverses couches, et il y a tous les
passages gradués du protoplasma solide de la surface au protoplasma
liquide et bien plus mobile de la profondeur. Le premier joue à l’égard
du dernier le rôle de paroi solide et maintenant prisonnier un liquide cn
mouvement L
Ge liquide, en effet, dans un phytoblaste vivant, a la propriété de se
t
. i r
ITg. 796.— Mouvements circulatoires (dont
les flèches indiquent le sens) dans les
traînées protoplasmiques du phytoblaste
(Dippel).
F ig . 797. — LVi«;'«, dont les phytocystes tubuleux
sont le siège d’une circulation intra-
protoplasmique (les flèches indiquent le
sens des courants).
déplacer dans diverses directions, maintenu par la barrière du protoplasma
solide. Comme il est d’ordinaire d’une limpidité parfaite, ses mouvements
circulatoires ne seraient pas facilement visibles, s’il ne contenait souvent
en suspension des corps solides ou microsomes (fig. 786, 791, GG). Peu importe
pour le moment la nature, variable d’ailleurs, de ces microsomes.
1. On pourrait peut-être employer ici une comparaison tirée de l’observation de ces
rivières qui, après les chaleurs de l’été, sont réduites à de minces filets d’une eau plus ou
moins bourbeuse, à laquelle la boue du fond, plus pauvre en eau, forme une paroi solide,
mais d’une composition en somme analogue à celle du liquide qui continue de circuler.
;, ,
k k ::;:k
Mik Aikikfk'
i ■, ■' ■
: u
u,k; '
'■Mi- i.. . i' . ■
■AA/kl A.'M
r - k k
iP?
' ï :
l’À'
. d