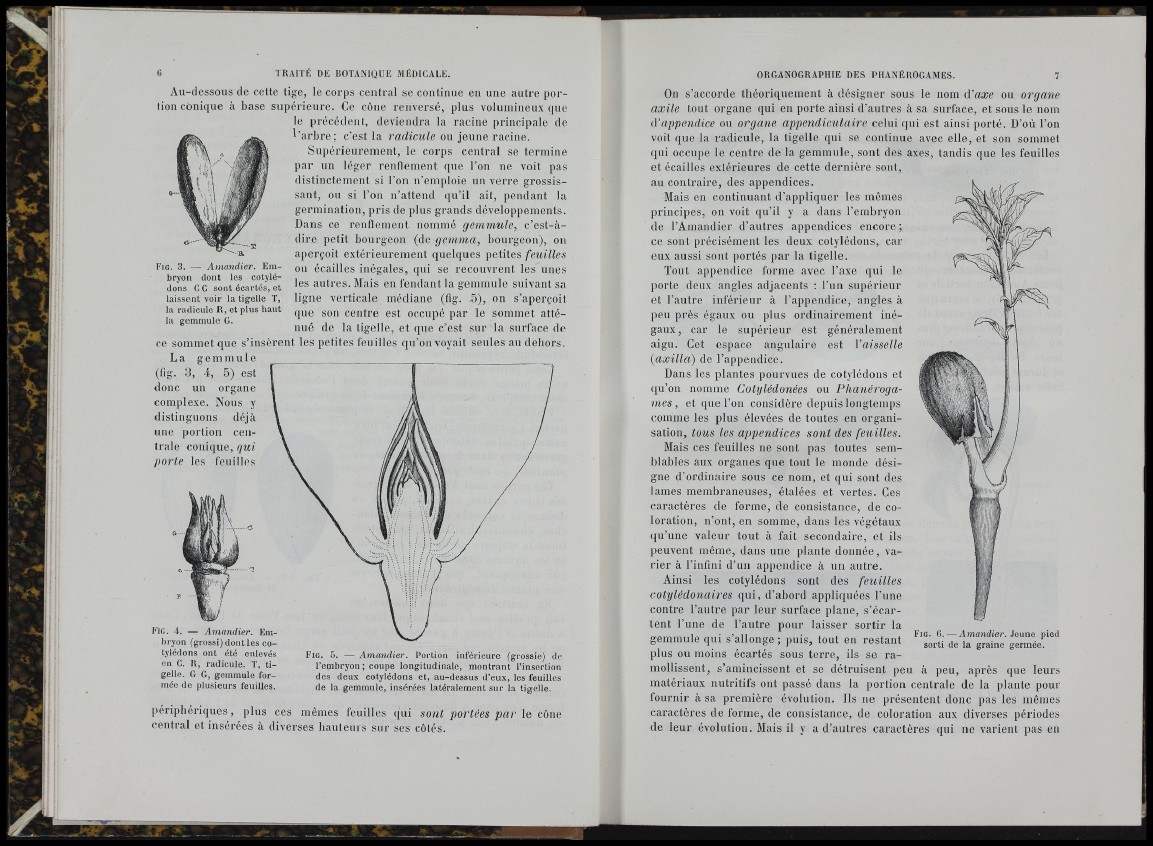
Au-dessous de cette tige, le corps central se continue en une autre portion
conique à base supérieure. Ce cône renversé, plus volumineux que
le précédent, deviendra la racine principale de
l ’arbre; c’est la radicule ou jeune racine.
Supérieurement, le corps central se termine
par un léger renflement que l’on ne voit pas
distinctement si l’on n’emploie un verre grossissant,
ou si l’on n’attend qu’il ait, pendant la
germination, pris de plus grands développements.
Dans ce renflement nommé gemm,ule, c’est-à-
dire petit bourgeon (de gemma, bourgeon), on
aperçoit extérieurement quelques petites feuilles
ou écailles inégales, qui se recouvrent les unes
les autres. Mais en fendant la gemmule suivant sa
ligne verticale médiane (fig. 5), on s’aperçoit
que son centre est occupé par le sommet atténué
de la tigelle, et que c’est sur la surface de
F ig . 3. — Am a n d ie r. Embryon
dont les cotylédons
C G sont écartés, et
laissent voir la tigelle T,
la radicule R, et plus haut
la gemmule G.
ce sommet que s’insèrent les petites feuilles qu’on voyait seules au dehors.
La g em m u l e
(fig. 3, 4, 5) est
donc un organe
complexe. Nous y
distinguons déjà
une portion centrale
conique, qui
porte les feuilles
Fig. 4. — Am a n d ie r. Em-
bryon (grossi) dont les cotylédons
ont été enlevés
en C. R, radicule. T, tigelle.
G G, pm m u le formée
de plusieurs feuilles.
Fig. 5. — Am a n d ie r. Portion inférieure (grossie) de
l’embryon ; coupe longitudinale, montrant l’insertion
des deux cotylédons et, au-dessus d’eux, les feuilles
de la gemmule, insérées latéralement sur la tigelle.
périphériques, plus ces mêmes feuilles qui so?it portées p a r le cône
central et insérées à diverses hauteurs sur ses côtés.
On s’accorde théoriquement à désigner sous le nom à'aæe ou organe
axile tout organe qui en porte ainsi d’autres à sa surface, et sous le nom
d’appendice ou organe appendiculaire celui qui est ainsi porté. D’où l’on
voit que la radicule, la tigelle qui se continue avec elle, et son sommet
qui occupe le centre de la gemmule, sont des axes, tandis que les feuilles
et écailles extérieures de cette dernière sont,
au contraire, des appendices.
Mais en continuant d’appliquer les mêmes
principes, on voit qu’il y a dans l’embryon
de l’Amandier d’autres appendices encore;
ce sont précisément les deux cotylédons, car
eux aussi sont portés par la tigelle.
Tout appendice forme avec l’axe qui le
porte deux angles adjacents : l’un supérieur
et l’autre inférieur à l’appendice, angles à
peu près égaux ou plus ordinairement inégaux,
car le supérieur est généralement
aigu. Cet espace angulaire est Vaisselle
(axilla) de l’appendice.
Dans les plantes pourvues de cotylédons et
qu’on nomme Cotylédonées ou Phanérogames,
et que l’on considère depuis longtemps
comme les plus élevées de toutes en organisation,
tous les appendices sont des feuilles.
Mais ces feuilles ne sont pas toutes semblables
aux organes que tout le monde désigne
d’ordinaire sous ce nom, et qui sont des
lames membraneuses, étalées et vertes. Ces
caractères de forme, de consistance, de coloration,
n’ont, en somme, dans les végétaux
qu’une valeur tout à fait secondaire, et ils
peuvent même, dans une plante donnée, varier
à l’infini d’un appendice à un autre.
Ainsi les cotylédons sont des feuilles
cotylédonaires qui, d’abord appliquées l’une
contre l’autre par leur surface plane, s’écartent
l’une de l’autre pour laisser sortir la
gemmule qui s’allonge ; puis, tout en restant
plus ou moins écartés sous terre, ils se ramollissent,
Fig. g. — Amandier. Jeune pied
sorti de la graine germée.
s’amincissent et se détruisent peu à peu, après que leurs
matériaux nutritifs ont passé dans la portion centrale de la plante pour
fournir à sa première évolution. Ils ne présentent donc pas les mêmes
caractères de forme, de consistance, de coloration aux diverses périodes
de leur évolution. Mais il y a d’autres caractères qui ne varient pas en