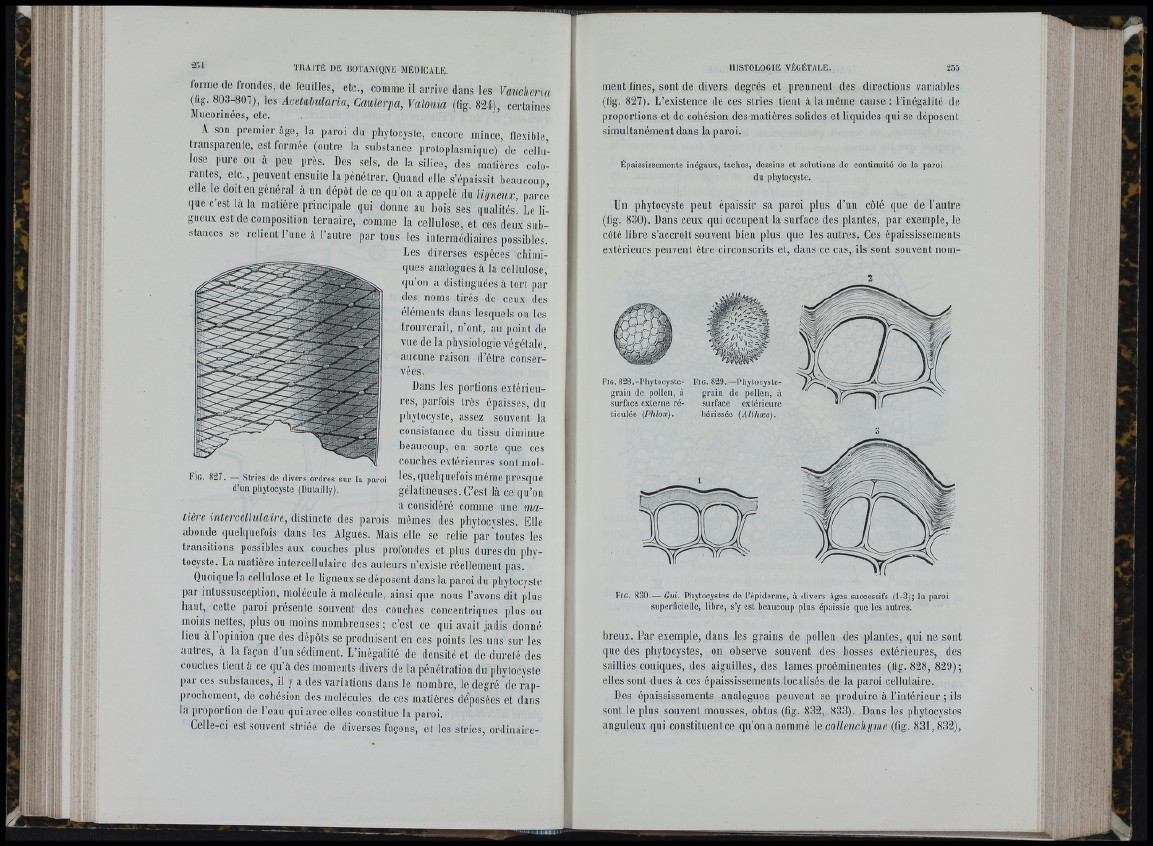
forme de Irondes, de fouilles, etc., comme il arrive dans les Vaucheria
(tig. 803-807), les Acetabularia, Caulerpa, Valonia (fig. 824), certaines
Mucorinées, etc.
A son premier âge, la paroi du phytocyste, encore mince, flexible
iransparente, est formée (outre la substance protoplasmique) de cellulose
pure ou à peu près. Des sels, de la silice, des matières colorantes,
etc., peuvent ensuite la pénétrer. Quand elle s’épaissit beaucoup
elle le doit en général à un dépôt de ce qu’on a appelé du ligneux, parce
(lue c’est la la matière principale qui donne au bois ses qualités. Le ligneux
est de composition ternaire, comme la cellulose, et ces deux substances
se relient l’une à l’autre par tous les intermédiaires possibles.
Les diverses espèces cbimi-
ques analogues à la cellulose,
qu’on a distinguées à tort par
des noms tirés de ceux des
éléments dans lesquels ou les
trouverait, n’ont, au point de
vue de la physiologie végétale,
aucune raison d’être conservées.
Dans les portions extérieures,
parfois très épaisses, du
phytocyste, assez souvent la
consistance du tissu diminue
beaucoup, en sorte que ces
couches extérieures sont molles,
quelquefois même presque
gélatineuses. C’est là ce qu’on
a considéré comme une matière
IT g. 827. — Stries de divers ordres sur la paroi
d’un phytocyste (Dutailly).
intercellulaire, distincte des parois mêmes des phytocystes. Elle
abonde quelquefois dans les Algues. Mais elle se relie par toutes les
tiansitions possibles aux couches plus profondes et plus dures du pby-
tocyste. La matière intercellulaire des auteurs n’existe réellement pas.
Quoique la cellulose et le ligneux se déposent dans la paroi du phytocyste
par intussusception, molécule a molécule, ainsi que nous l’avons dit plus
haut, cette paroi présente souvent des couches concentriques plus ou
moins nettes, plus ou moins nombreuses ; c’est ce qui avait jadis donné
lieu à 1 opinion que des dépôts se produisent en ces points les uns sur les
autres, à la façon d’un sédiment. L’inégalité de densité et de durelé des
couches tient à ce qu à des moments divers de la pénétration du phytocyste
par ces substances, il y a des variations dans le nombre, le degré de rapprochement,
de cohésion des molécules de ces matières déposées et dans
la proportion de l’eau qui avec elles constitue la paroi.
Celle-ci est souvent striée de diverses façons, et les stries, ordinaire-
t
ment fines, sont de divers degrés et prennent des directions variables
(fig. 827). L’existence de ces stries tient à la même cause : l’inégalité de
proportions et de cohésion des matières solides et liquides qui se déposent
simultanément dans la paroi.
Épaississements inégaux, taches, dessins et solutions de continuité de la paroi
du phytocyste.
Un phytocyste peut épaissir sa paroi plus d’un côté que de l’autre
(fig. 830). Dans ceux qui occupent la surface des plantes, par exemple, le
côté libre s’accroît souvent bien plus que les autres. Ces épaississements
extérieurs peuvent être circonscrits et, dans ce cas, ils sont souvent nom-
F ig . 828.-Phytocyste- FiG. 829.—Phytocystc-
grain de pollen, à grain de pollen, à
surface externe ré- surface extérieure
ticulée (Phlox). hérissée (Althæa).
F ig . 830.— Gui. Phytocystes de l’épiderme, à divers âges successifs (1-3); la paroi
superficielle, libre, s’y est beaucoup plus épaissie que les autres.
breux. Par exemple, dans les grains de pollen des plantes, qui ne sont
que des phytocystes, on observe souvent des bosses extérieures, des
saillies coniques, des aiguilles, des lames proéminentes (fig. 828, 829);
elles sont dues à ces épaississements localisés de la paroi cellulaire.
Des épaississements analogues peuvent se produire à l’intérieur ; ils
sont le plus souvent mousses, obtus (fig. 832, 833). Dans les phytocystes
anguleux qui constituentce qu’onanommé le collenchyme (fig. 831,832),
l4ë'- (ij
oranaBw»»»'*'