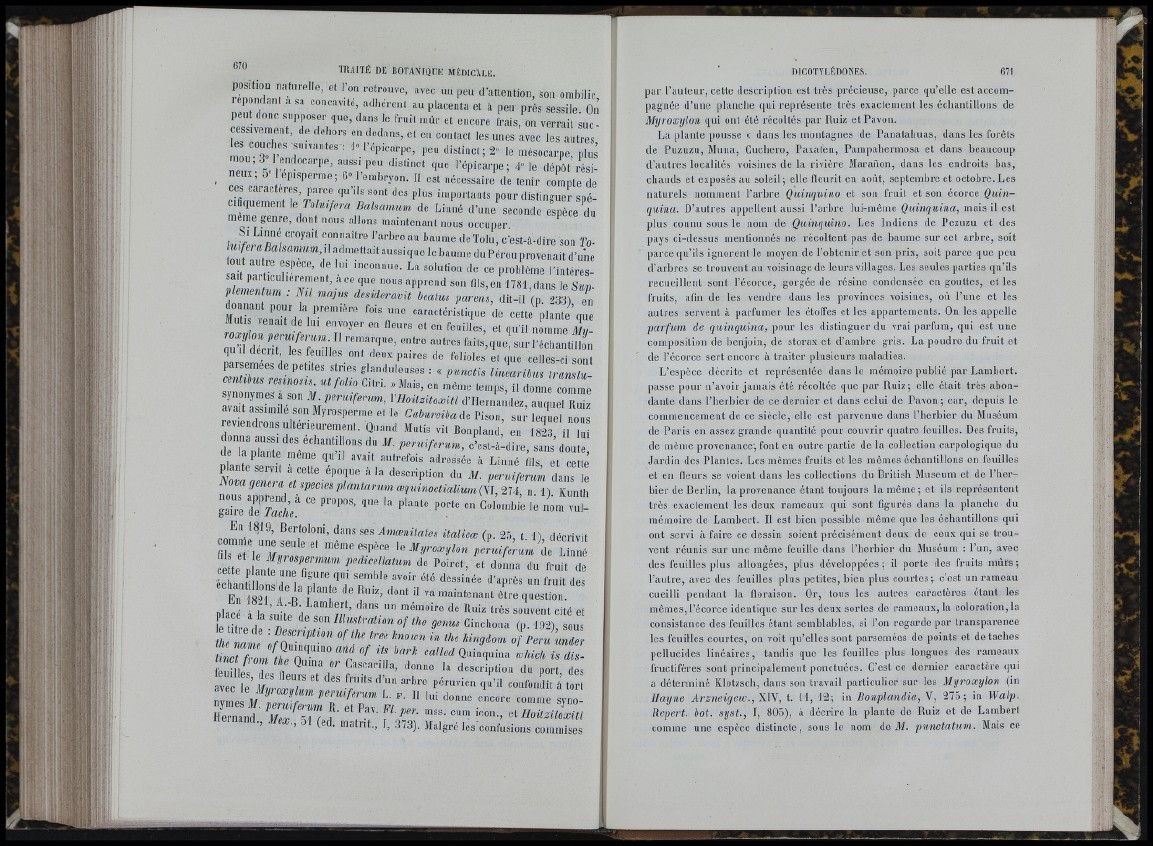
6 ^ 6 T R A I T É D E B O T A N I Q U E M É D I C A L E .
position naturelle, et l ’on retrouve, avec un peu d’attention, son ombilic
repondant a sa concavité, adhérent au placenta et à peu près sessile. On
peut donc supposer que, dans le fruit mûr et encore frais, on verrait successivement,
de. dehors en dedans, et en conlact les unes avec les autres
m L ' T l ’e' P®*" ^¡stinct; 2® le mésocarpe, plus
mou, 3 1 endocarpe, aussi peu distinct que l ’épicarpe; 4® le dépôt rési-
^ neux; 5® episperme; 6» l ’embryon. II est nécessaire de tenir compte de
ces caracteres, parce qu’ils sont des plus importants pour distingue^ spé-
cificRement le r o /m / .m Bal samum de Linné d’une seconde espèce du
eme genre, dont nous allons maintenant nous occuper
Si Linné croyait connaître l ’arbre au baume de Tolu, c’est-à-dire son Toluifera
Balsamum, il admettait aussi qne le baume du Pérou provenait d’u'ne
tout autre espece, de lui inconnue. La solution de ce problème l ’intéressait
paiticuherement, ace que nous apprend son fils,en 1781 dans le Sun-
plementum : m majus desideravit heatus parens, dit-il ’(p. 233) en
onnant pour la première fois une caractéristique de cette plante ’que
lutis venait de lui envoyer en fleurs et en feuilles, et qu’il nomme Mv
qu décrit les feuilles ont deux paires de folioles et que celles-ci sont
parsemeesde petites stries glanduleuses : . p u n c tü l i L r i i u f t r Z Z -
cenMus r e sm om . ut folio Citri. » Mais, eu même temps, il douue comme
ynonymes a son M^peruiferunt, VHoitzüoxitl d ’Hernaldez, au/nel R“
aiait assimile son Myrosperme et le Cabureiba de Pison, sur leguel nous
reviendrons ulteneurement. Quand Mutis vit Bonpland, en 1823 il lui
donna aussi des échantillons dn M. p e rui fe rum, c’est-à-dire, sans’ doute
de la plante meme qn’il avait autrefois adressée à Linné fils et cette
^ ante servit a cette époque à la description du M. pe rui fer im dans le
9^ne> a et species plantarum oequinoctialium (XI, 214 n 1) Kunth
Col’ombi’e T u L v u Ï
En 1819, B e r t o l o n i , dans ses Amoemiates (p. 25 t 1 ) décrivit
ce të u L t e u 7 T ™ “ ‘I® ®t donna du fruit de
cette p ante une figure qui semble avoir été dessinée d’après un fruit des
t ■ Í 7/ ™ ”’™‘®nnn' C Z l Z
placé à ia Li te de 7 m f ”/ “® ®®"''®"‘ ®¡« ®'
le titre do ■ n Illustration o f the genus Cinchona (p. 192) sous
the name ' <>f the tree known in the kingdom of Peru under
“ 1 7 ” 1 Cnooooilla, donne la description du port des
Ive ë ’ Z T P®®“ "®" qn’il confond 11 tor
Heruand.', Mew ¡ T f d ' » t . m1 atCrit., ' Jf, ÿ3m73). MS aTig r"e TIe s '™co‘nLf’usions commises
D I C O T Y L É D O N E S . 671
par l’auteur, cette description est très précieuse, parce qu’elle est accompagnée
d’une planche qui représente très exactement les échantillons de
Myroxylon qui ont été récoltés par Ruiz et Pavon.
La plante pousse « dans les montagnes de Panatahuas, dans les forêts
de Puzuzii, Muna, Cuchero, Paxaten, Pampahermosa et dans beaucoup
d’autres localités voisines de la rivière Maraûon, dans les endroits bas,
chauds et exposés au soleil; elle fleurit en août, septembre et octobre. Les
naturels nomment l’arbre Quinquino et son fruit et son écorce Quinquina.
D’autres appellent aussi l ’arbre lui-même Quinquina, mais il est
plus connu sous le nom de Quinquino. Les Indiens de Pezuzu et des
pays ci-dessus mentionnés ne récoltent pas de baume sur cet arbre, soit
parce qu’ils ignorent le moyen de l’obtenir et son prix, soit parce que peu
d’arbres se trouvent au voisinage de leurs villages. Les seules parties qu’ils
recueillent sont Técorce, gorgée de résine condensée en gouttes, et les
fruits, afin de les vendre dans les provinces voisines, où Tnne et les
autres servent à parfumer les étoifes et les appartements. On les appelle
parfum de quinquina, pour les distinguer du vrai parfum, qui est une
composition de benjoin, de storax et d’ambre gris. La poudre du fruit et
de Técorce sert encore à traiter plusieurs maladies.
L’espèce décrite et représentée dans le mémoire publié par Lambert,
passe pour n’avoir jamais été récoltée que par Ruiz; elle était très abondante
dans Therbier de ce dernier et dans celui de Pavon; car, depuis le
commencement de ce siècle, elle est parvenue dans Therbier du Muséum
de Paris en assez grande quantité pour couvrir quatre feuilles. Des fruits,
de même provenance', font en outre partie de la collection carpologique du
Jardin des Plantes. Les mêmes fruits et les mêmes échantillons en feuilles
et en fleurs se voient dans les collections du British Muséum et de Therbier
de Berlin, la provenance étant toujours la même; et ils représentent
très exactement les deux rameaux qui sont figurés dans la planche du
mémoire de Lambert. II est bien possible même que les échantillons qui
ont servi à faire ce dessin soient précisément deux de ceux qui se trouvent
réunis sur une même feuille dans Therbier du Muséum : Tun, avec
des feuilles plus allongées, plus développées; il porte des fruits mûrs;
Tautre, avec des feuilles plus petites, bien plus courtes; c’est un rameau
cueilli pendant la floraison. Or, tous les autres caractères étant les
mêmes, Técorce identique sur les deux sortes de rameaux, la coloration, la
consistance des feuilles étant semblables, si Ton regarde par transparence
les feuilles courtes, on voit qu’elles sont parsemées de points et de taches
pellucides linéaires, tandis que les feuilles plus longues des rameaux
fructifères sont principalement ponctuées. G’est ce dernier caractère qui
a déterminé Klotzscb, dans son travail particulier sur les Myroxylon (in
Hayne Arzneigew., XIV, t. 11, 12; in Bonplandia, V, 275; in Walp.
Repert. bot. syst., I, 805), à décrire la plante de Ruiz et de Lambert
comme une espèce distincte, sous le nom de M. punctatum. Mais ce