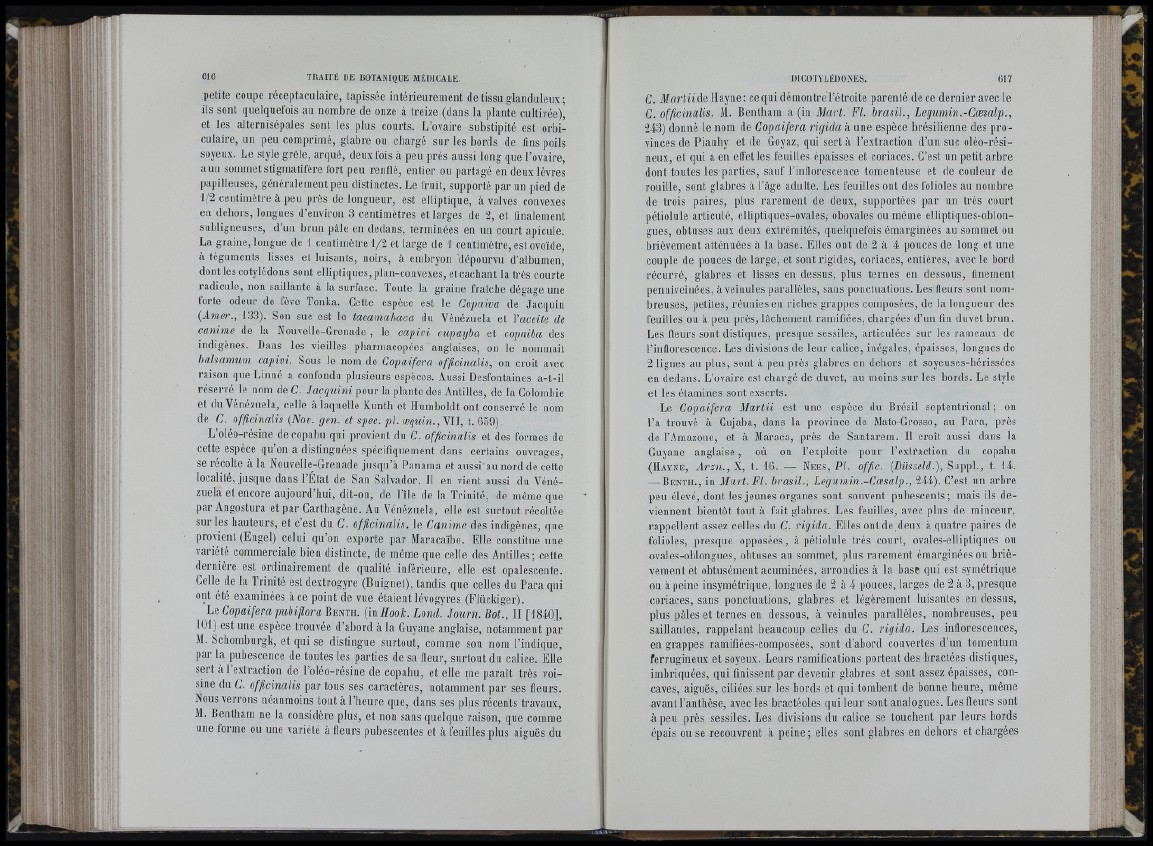
petite coupe réceptaculaire, tapissée intérieurement de tissu glanduleux ;
ils sont quelquefois au nombre de onze à treize (dans la plante cultivée),
et les alternisépales sont les plus courts. L’ovaire substipité est orbiculaire,
un peu comprimé, glabre ou cbargé sur les bords de fins poils
soyeux. Le style grêle, arqué, deuxfois à peu près aussi long que l’ovaire,
a un sommet stigmatifère tort peu renflé, entier ou partagé en deux lèvres
papilleuses, généralement peu distinctes. Le fruit, supporté par un pied de
1/2 centimètre à peu près de longueur, est elliptique, à valves convexes
en dehors, longues d’environ 3 centimètres et larges de 2, et finalement
subligneuses, d’un brun pâle en dedans, terminées en un court apiculé.
La graine, longue de 1 centimètre 1/2 et large de 1 centimètre, est ovoïde,
à téguments lisses et luisants, noirs, à embryon ‘dépourvu d’albumen,
dont les cotylédons sont elliptiques, plan-convexes, et cachant la très courte
radicule, non saillante à la surface. Toute la graine fraîche dégage une
forte odeur de fève Tonka. Cette espèce est le Copaiva de Jacquin
(Amer., 133). Son suc est le tacamahaca du Vénézuela et Vaceite de
canime de la Nouvelle-Grenade , le capivi cupaijba et copaiba des
indigènes. Dans les vieilles pharmacopées anglaises, on le nommait
balsamum capivi. Sous le nom de Copaifera officinalis, on croit avec
raison que Linné a confondu plusieurs espèces. Aussi Desfontaines a-t-il
réservé le nom de C. Jacquini pour la plante des Antilles, de la Colombie
et du Vénézuela, celle à laquelle Kunth et Humboldt ont conservé le nom
de C. officinalis (Nov. gen. et spec. pl. oequin., VII, t. 659) .
L’oléo-résine de copahu qui provient du C. officinalis et des formes de
cette espèce qu on a distinguées spécifiquement dans certains ouvrages,
se récolte à la Nouvelle-Grenade jusqu’à Panama et aussi au nord de cette
localité, jusque daus l’État de San Salvador. H en vient aussi du Vénézuela
et encore aujourd’hui, dit-on, de 1 île de la Trinité, de même que
par Angostura et par Garthagène. Au Vénézuela, elle est surtout récoltée
sur les hauteurs, et c’est du C. officinalis, le Canime des indigènes, que
provient (Engel) celui qu’on exporte par Maracaïbo. Elle constitue une
variété commerciale bien distincte, de même que celle des Antilles; cette
dernière est ordinairement de qualité inférieure, elle est opalescente.
Celle de la Trinité est dextrogyre (Buignet), tandis que celles du Para qui
ont été examinées à ce point de vue étaient lévogyres (Flückiger).
Le Copaifera pubi f ioraRnmi i . (InHook. Lond. Journ. Bot., II [1840],
101) est une espèce trouvée d’abord à la Guyane anglaise, notamment par
M. Schomburgk, et qui se distingue surtout, comme son nom l’indique,
par la pubescence de toutes les parties de sa fleur, surtout du calice. Elle
sert à 1 extraction de l’oléo-résine de copahu, et elle nue paraît très voisine
du C. officinalis partons ses caractères, notamment par ses fleurs.
Nous verrons néanmoins tout à l ’heure que, dans ses plus récents travaux,
M. Bentham ne la considère plus, et non sans quelque raison, que comme
une forme ou une variété à fleurs pubescentes et à feuilles plus aiguës du
C. Mar t i i de Hayne : ce qui démontrel’étroite parenté de ce dernier avec le
C. officinalis. M. Bentham a (in Mari. Fl. brasil., Legumin.-Coesalp.,
243) donné le nom de Copaifera rigida à une espèce brésilienne des provinces
de Piauhy et de Goyaz, qui sert à l’extraction d’un suc oléo-résineux,
et qui a en effet les feuilles épaisses et coriaces. G’est un petit arbre
dont toutes les parties, sauf l’inflorescence tomenteuse et de couleur de
rouille, sont glabres à l’âge adulte. Les feuilles ont des folioles au nombre
de trois paires, plus rarement de deux, supportées par un très court
pétiolule articulé, elliptiques-ovales, obovales ou même elliptiques-oblon-
gues, obtuses aux deux extrémités, quelquefois émarginées au sommet ou
brièvement atténuées à la base. Elles ont de 2 à 4 pouces de long et une
couple de pouces de large, et sont rigides, coriaces, entières, avec le bord
récurvé, glabres et lisses en dessus, plus ternes en dessous, finement
penniveinées, à veinules parallèles, sans ponctuations. Les fleurs sont nombreuses,
petites, réunies en ricbes grappes composées, de la longueur des
feuilles ou à peu près, lâchement ramifiées, chargées d ’un fm duvet brun.
Les fleurs sont distiques, presque sessiles, articulées sur les rameaux de
l’inflorescence. Les divisions de leur calice, inégales, épaisses, longues de
2 lignes au plus, sont à peu près glabres en dehors et soyeuses-hérissées
en dedans. L’ovaire est chargé de duvet, au moins sur les bords. Le style
et les étamines sont exserts.
Le Copaifera Mar t i i est une espèce du Brésil septentrional ; on
l ’a trouvé à Gujaba, dans la province de Mato-Grosso, au Para, près
de l’Amazone, et à Màraca, près de Santarem. Il croît aussi dans la
Guyane anglaise, où on l’exploite pour l’extfaction du copahu
(H a y n e , Ar zn . , X, t. 16. — N e e s , Pl. offic. (Düsseld.), Suppl., t. 14.
— B e n t h . , in Mart. Fl. brasil., Legumin.-Coesalp., 244). G’est un arbre
peu élevé, dont les jeunes organes sont souvent pubescents; mais ils deviennent
bientôt tout à fait glabres. Les feuilles, avec plus de minceur,
rappellent assez celles du C. rigida. Elles ont de deux à quatre paires de
folioles, presque opposées, à pétiolule très court, ovales-elliptiqnes ou
ovales-oblongues, obtuses au sommet, plus rarement émarginées ou brièvement
et obtusément acuminées, arrondies à la base qui est symétrique
ou à peine insymétrique, longues de 2 à 4 pouces, larges de 2 à 3, presque
coriaces, sans ponctuations, glabres et légèrement luisantes en dessus,
plus pâles et ternes en dessous, à veinules parallèles, nombreuses, peu
saillantes, rappelant beaucoup celles du C. rigida. Les inflorescences,
en grappes ramifiées-composées, sont d’abord couvertes d ’un tomentum
ferrugineux et soyeux. Leurs ramifications portent des bractées distiques,
imbriquées, qui finissent par devenir glabres et sont assez épaisses, concaves,
aiguës, ciliées sur les bords et qui tombent de bonne heure, même
avant Tanthèse, avec les bractéoles qui leur sont analogues. Les fleurs sont
à peu près sessiles. Les divisions du calice se touchent par leurs bords
épais ou se recouvrent à peine ; elles sont glabres en dehors et chargées