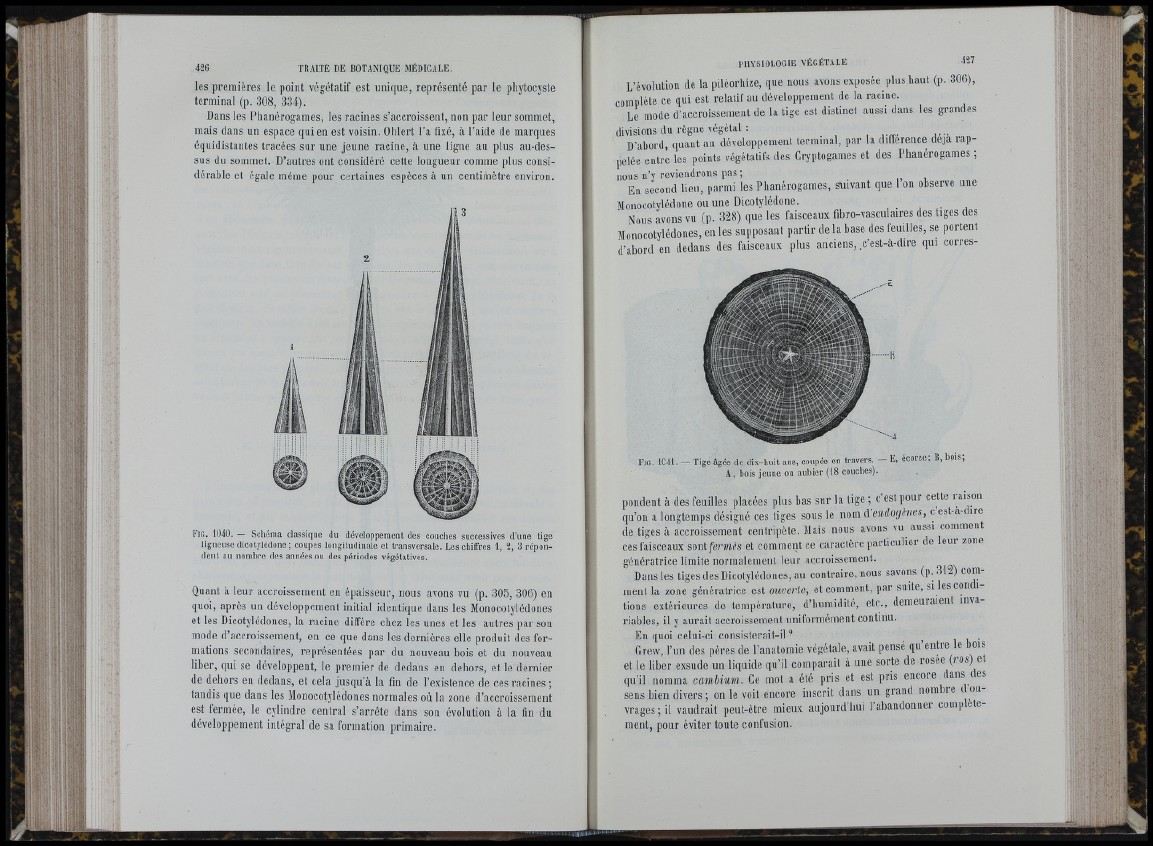
les premières le point végétatif est unique, représenté par le phytocyste
terminal (p. 308, 334).
Dans les Phanérogames, les racines s’accroissent, non par leur sommet,
mais dans un espace qui en est voisin. Oldert l’a fixé, à l’aide de marques
équidistantes tracées sur une jeune racine, à une ligne au plus au-dessus
du sommet. D’autres ont considéré cette longueur comme plus considérable
et égale même pour certaines espèces à un centimètre environ.
FiG. 1040. — Schéma classique du développemeut des couches successives d’une tige
ligneuse dicotylédone; coupes longitudinale et transversale. Les chiffres 1, 2, 3 répondent
au nombre des années ou des périodes végétatives.
Quant à leur accroissement en épaisseur, nous avons vu (p. 305, 306) en
quoi, après un développement initial identique dans les Monocotylédones
et les Dicotylédones, la racine diffère chez les unes et les autres par son
mode d’accroissement, en ce que dans les dernières elle produit des formations
secondaires, représentées par du nouveau bois et du nouveau
liber, qui se développent, le premier de dedans en dehors, et le dernier
de dehors en dedans, et cela jusqu’à la fin de l’existence de ces racines ;
tandis que dans les Monocotylédones normales où la zone d’accroissement
est fermée, le cylindre central s’arrête dans son évolution à la fin du
développement intégral de sa formation primaire.
L’évolution de la piléorhize, que nous avons exposée plus haut (p. 306),
complète ce qui est relatif au développement de la racine.
Le mode d’accroissement de la tige est distinct aussi dans les grandes
divisions du règne végétal .
D’abord, quant au développement terminal, par la difference deja rappelée
entre les points végétatifs des Cryptogames et des Phanérogames ;
nous n ’y reviendrons pas;
En second lieu, parmi les Phanérogames, suivant que 1 on observe une
Monocotylédone ou une Dicotylédone. . , • «
Nous avons vu (p. 328) que les faisceaux fibro-vasculaires des tiges des
Monocotylédones, en les supposant partir de la base des teudles, se portent
d’abord en dedans des faisceaux plus anciens, .c’est-à-dire qui corres-
FiG. iC41. — Tige âgée de dix-huit ans, coupée cn travers. — E, écorce; B, bois;
A, bois jeune ou aubier (18 couches).
pondent à des feuilles placées plus bas sur la tige ; c est pour cette raison
qu’on a longtemps désigné ces tiges sous le nom d endogènes, c est-à- ire
de tiges à accroissement centripète. Mais nous avons vu aussi comment
ces faisceaux sont fermés et commentée caractère particulier de leui zone
génératrice limite normalement leur accroissement.
Dans les tiges des Dicotylédones, au contraire, nous savons (p. 31 ) corn
ment la zone génératrice est ouverte, et comment, par suite, si lescon i-
tions extérieures de température, d’humidité, etc., demeuraient inva
riables, il y aurait accroissement uniformément continu.
En quoi celui-ci consisterait-il? ^ i b •
Grew, l’un des pères de l’anatomie végétale, avait pensé qu’entre le bois
et le liber exsude un liquide qu’il comparait à une sorte de rosée (î os) et
cju’il nomma cambium. Ce mot a été pris et est pris encore dans es
sens bien divers ; on le voit encore inscrit dans un grand nombre ou
vrages ; ¡1 vaudrait peut-être mieux aujourd’hui l’abandonner complète
ment, pour éviter toute confusion.