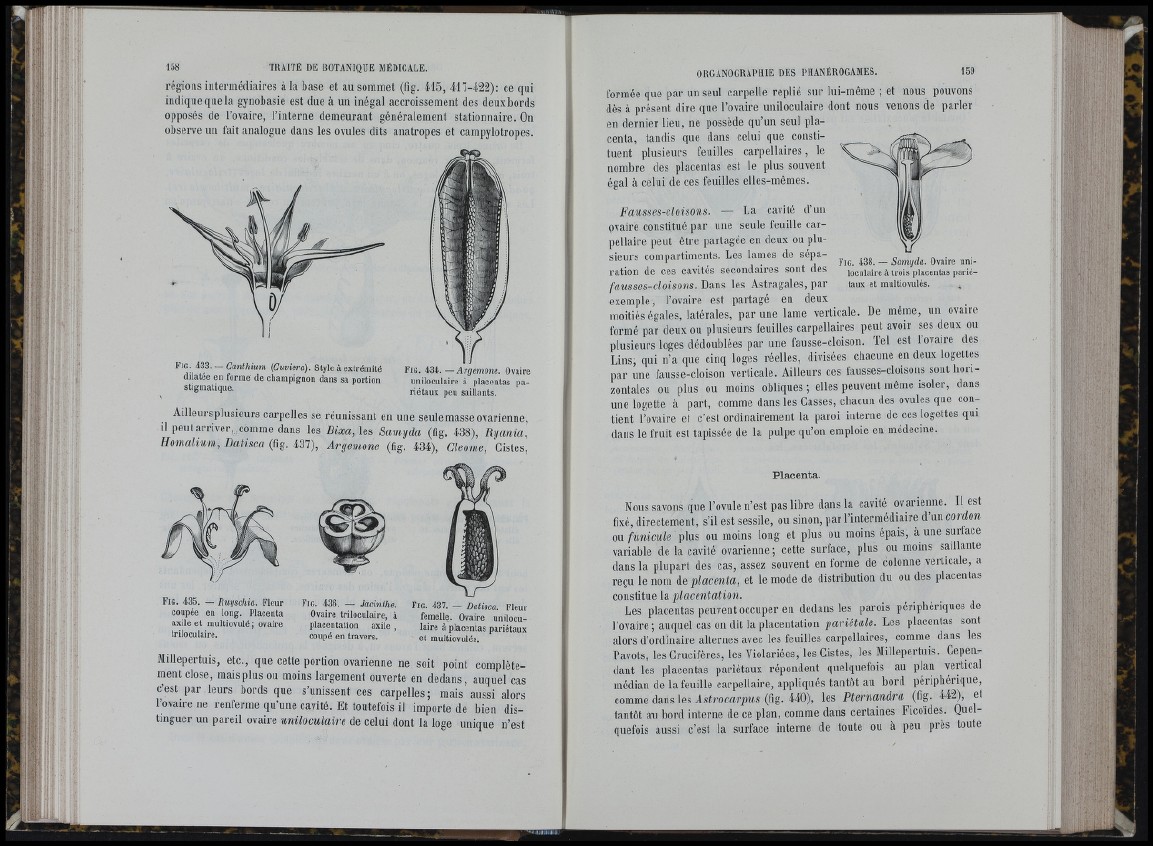
• i 'M'
V\ë-. :
|?fî
Ili"
i; :/ I N
Ip , 'i 'iü ‘ if Y 1^1,
,Sf -G,
i X !|
mh .r:';
i.
■■
*' ’i I >
Mí líl
», ■) :*’ I: . •
; j '■
•; J
régions intermédiaires à la base et au sommet (fig. 415, 417-422): ce qui
indique que la gynobasie est due à un inégal accroissement des deux bords
opposés de l’ovaire, l’interne demeurant généralement stationnaire. On
observe un fait analogue dans les ovules dits anatropes et campylotropes.
F ig . i33. ~ Cant Ilium (Cuviera). Style à extrémité
ditatée en formé de champignon dans sa portion
stigmatique.
Fig. 434. — Argemone. Ovaire
uniloculaire à placentas pariétaux
peu saillants.
Ailleursplusieurs carpelles se réunissant en une seulemasse ovarienne,
il peut arriver, comme dans les Bixa, les S amyda (fig. 438), Ryania,
Homa h um, Datisca (fig. 437), Argemone (fig. 434), Cleome, Cistes,
Fig. 435. — Ruyschia. Fleur
coupée en long. Placenta
axile et multiovulé; ovaire
triloculaire.
Fig. 436. — Jacinthe.
Ovaire triloculaire, à
placentation axile ,
coupé en travers.
Fig. 437. — Datisca. Fleur
femelle. Ovaire uniloculaire
à placentas pariétaux
et multiovulés.
Millepertuis, etc., que cette portion ovarienne ne soit point complètement
close, mais plus ou moins largement ouverte en dedans, auquel cas
c’est par leurs bords que s’unissent ces carpelles ; mais aussi alors
l’ovaire ne renferme qu’une cavité. Et toutefois il importe de bien distinguer
un pareil ovaire uniloculaire de celui dont la loge unique n’est
159
formée que par un seul carpelle replié sur lui-même ; et nous pouvons
dès à présent dire que l’ovaire uniloculaire dont nous venons de parler
en dernier lieu, ne possède qu’un seul placenta,
tandis que dans celui que constituent
plusieurs feuilles carpellaires , le
nombre des placentas est le plus souvent
égal à celui de ces feuilles elles-mêmes.
Fausses-cloisons. La cavité d’un
F ig . 438. — Samyda. Ovaire uniloculaire
à trois placentas pariétaux
et multiovulés.
pvaire constitué par une seule feuille carpellaire
peut être partagée en deux ou plusieurs
compartiments. Les lames de séparation
de ces cavités secondaires sont des
fausses-cloisons. Dans les Astragales, par
exemple, l’ovaire est partagé en deux
moitiés égales, latérales, par une lame verticale. De même, un ovaire
formé par deux ou plusieurs feuilles carpellaires peut avoir ses deux ou
plusieurs loges dédoublées par une fausse-cloison. Tel est 1 ovaire des
Lins, qui n ’a que cinq loges réelles, divisées cbacune en deux logettes
par une fausse-cloison verticale. Ailleurs ces fausses-cloisons sont horizontales
ou plus ou moins obliques ; elles peuvent même isoler, dans
une logette à part, comme dans les Casses, chacun des ovules que contient
l’ovaire et c’est ordinairement la paroi interne de ces logettes qui
dans le fruit est tapissée de la pulpe qu’on emploie en médecine.
Placenta.
Nous savons que l’ovule n’est pas libre dans la cavité ovarienne. Il est
fixé, directement, s’il est sessile, ou sinon, par l’intermédiaire d’un cordon
ou funicule plus ou moins long et plus ou moins épais, à une surface
variable de la cavité ovarienne ; cette surface, plus ou moins saillante
dans la plupart des cas, assez souvent en forme de colonne verticale, a
reçu le nom de placenta, et le mode de distribution du ou des placentas
constitue la placentation.
Les placentas peuvent occuper en dedans les parois périphériques de
l’ovaire ; auquel cas on dit la placentation pariétale. Les placentas sont
alors d’ordinaire alternes avec les feuilles carpellaires, comme dans les
Pavots, les Crucifères, les Yiolariées, les Cistes, les Millepertuis. Cependant
les placentas pariétaux répondent quelquefois au plan vertical
médian de la feuille carpellaire, appliqués tantôt au bord périphérique,
comme dans les (fig. 440), les Pternandra (fig. 442), et
tantôt an bord interne de ce plan, comme dans certaines Ficoïdes. Quelquefois
aussi c’est la surface interne de toute ou à peu près toute