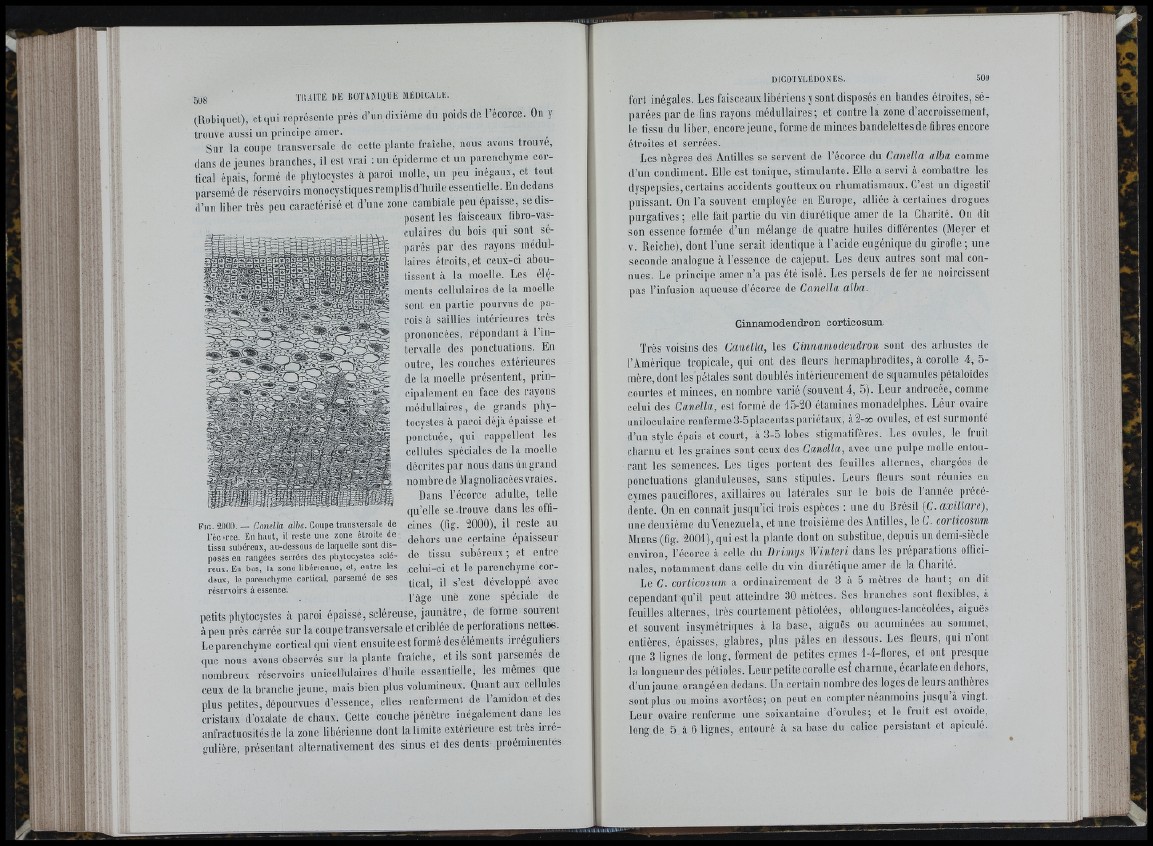
■ i !
>/■
i
5^8 TliAITÉ DE BOTANIQUE MÉDICALE.
(Robiquel), et. qui représente près d’un dixième du poids de Técorce. On y
trouve aussi uu principe amer.
Sur la coupe transversale de cette plante fraîcbe, nous avons trouve,
dans de jeunes brandie s, il est vrai : un épiderme et un parencbyme cortical
épais, formé de pbytocystes à paroi molle, un peu inégaux et tout
parsemé de réservoirs m o n o c y s t i q u e s remplis d’buile essentielle. En dedans
d’un liber très peu caractérisé et d’une zone cambiale peu épaisse, se disposent
les faisceaux fibro-vasculaires
du bois qui sont séparés
par des rayons médullaires
étroits, et ceux-ci aboutissent
à la moelle. Les élri
ments cellulaires de la moelle
sont en partie pourvus de parois
à saillies intérieures très
prononcées, répondant à l ’intervalle
des ponctuations. En
outre, les coucbes extérieures
de la moelle présentent, principalement
en face des rayons
médullaires, de grands pbytocystes
à paroi déjà épaisse et
ponctuée, qui rappellent les
cellules spéciales de la moelle
décrites par nous dans un grand
nombre de Magnoliacées vraies.
Dans Técorce adulte, telle
qu’elle se .trouve dans les officines
(fig. 2000), il reste au
dehors une certaine épaisseur
de tissu subéreux; et entre
.celui-ci et le parenchyme cortical,
il s’est développé avec
Tâge une zone spéciale de
F i g . 2000. — Canella alba. Coupe transversale de
l e o r c e . Eu haut, il reste une zone étroite de
tissu subéreux, au-dessous de Iaf[uelie sont disposés
en rangées serrées des phytocystes scléreux.
En bas, la zone libérienne, et, entre les
deux, le parenchyme cortical, parsemé de ses
réservoirs à essence.
petits pbytocystes â paroi épaisse, scléreuse, jaunât re, de forme souvent
à peu près carrée sur la coupe transversale et criblée de perlorations nettes.
Le parenchyme cortical qui vient ensuite est formé des éléments irréguliers
que nous avons observés sur la plante fraîcbe, et ils sont parsemés de
nombreux réservoirs unicellulaires d’huile essentielle, les mêmes que
ceux de la branche jeune, mais bien plus volumineux. Quant aux cellules
plus petites, dépourvues d’essence, elles lenferment de Tamidou et des
cristaux d’oxalate de chaux. Gette couche pénètre inégalement dans les
anfractuosités de la zone libérienne dont la limite extérieure est très irrégulière,
présertanl alternativement des sinus et des dents proéminentes
DICOTYLÉDONES. 509
fort inégales. Les faisceaux libériens y sont disposés en bandes étroites, séparées
par de fins rayons médullaires; et contre la zone d’accroissement,
le tissu du liber, encore jeune, forme de minces bandelettes de fibres encore
étroites et serrées.
Les nègres des Antilles se servent de Técorce du Canella alba comme
d’un condiment. Elle est tonique, stimulante. Elle a servi à combattre les
dyspepsies, certains accidents goutteux ou rhumatismaux. C’est nn digestif
puissant. On Ta souvent employée en Europe, alliée à certaines drogues
purgatives; elle fait partie du vin diurétique amer de la Charité. On dit
son essence formée d’un mélange de quatre huiles différentes (Meyer et
V . Reiche), dont Tune serait identique à Tacide eugénique du girofle ; une
seconde analogue à Tessence de cajeput. Les deux autres sont mal connues.
Le principe ame rn ’a pas été isolé. Les persels de fer ne noircissent
pas l ’infusion aqueuse d’écorce de Canella alba.
C i n n a m o d e n d r o n c o r t i c o s n m .
Très voisins des Canella, les Cinnamodendron sont des arbustes de
l’Amérique tropicale, qui ont des fleurs hermaphrodites, a corolle 4, 5-
mère,dont les pétales sont doublés intérieurement de squamules pétaloïdes
courtes et minces, en nombre varié (souvent 4, 5). Leur androcée, comme
celui des Canella, est formé de 15-20 étamines monadelphes. Léur ovaire
uniloculaire renferme 3-5placentas pariétaux, à2-oo ovules, et est surmonté
d’un style épais et court, à 3-5 lobes stigmatifères. Les ovules, le fruit
charnu et les graines sont ceux des Canella, avec une pulpe molle entourant
les semences. Les tiges portent des feuilles alternes, chargées de
ponctuations glanduleuses, sans stipules. Leurs lleurs sont réunies en
cymes pauciffkes, axiliaires on latérales sur le bois de Tannée précédente.
On en connaît jusqu’ici trois espèces : une du Brésil {C. axillare),
une deuxième duVeiiezuela, et une troisième des Antilles, le 6. corticosnm
M i e r s (fig. 2001), qui est la plante dont on substitue, depuis nn demi-siècle
environ, Técorce â celle dn Drimys Winteri dans les préparations officinales,
notamment dans celle du vin diurétique amer de la Charité.
Le C. corticosnm a ordinairement de 3 a 5 mètres de baut ; on dit
cependant qu’il peut atteindre 30 mètres. Ses branches sont flexibles, a
feuilles alternes, très courtement pétiolées, oblongues-lancéolées, aiguës
et souvent iiisymétriqnes à la base, aiguës on acnminées au sommet,
entières, épaisses, glabres, plus pâles en dessous. Les fleurs, qui n ont
que 3 lignes de long, forment de petites cymes 1-4-ilores, et ont presque
la longueur des pétioles. Leur petite corolle esi charnue, écarlate en dehors,
d’un jaune orangé en dedans. Un certain nombre des loges de leurs anthères
sont plus ou moins avortées; on peut en compter néanmoins jusqii à vingt.
Leur ovaire renferme une soixantaine d’ovules; et le fruit est ovoïde,
long de 5 à 6 lignes, entouré â sa base du calice persistant et apiculé.
T
■/î
î ¡s:
;î ; A r
d