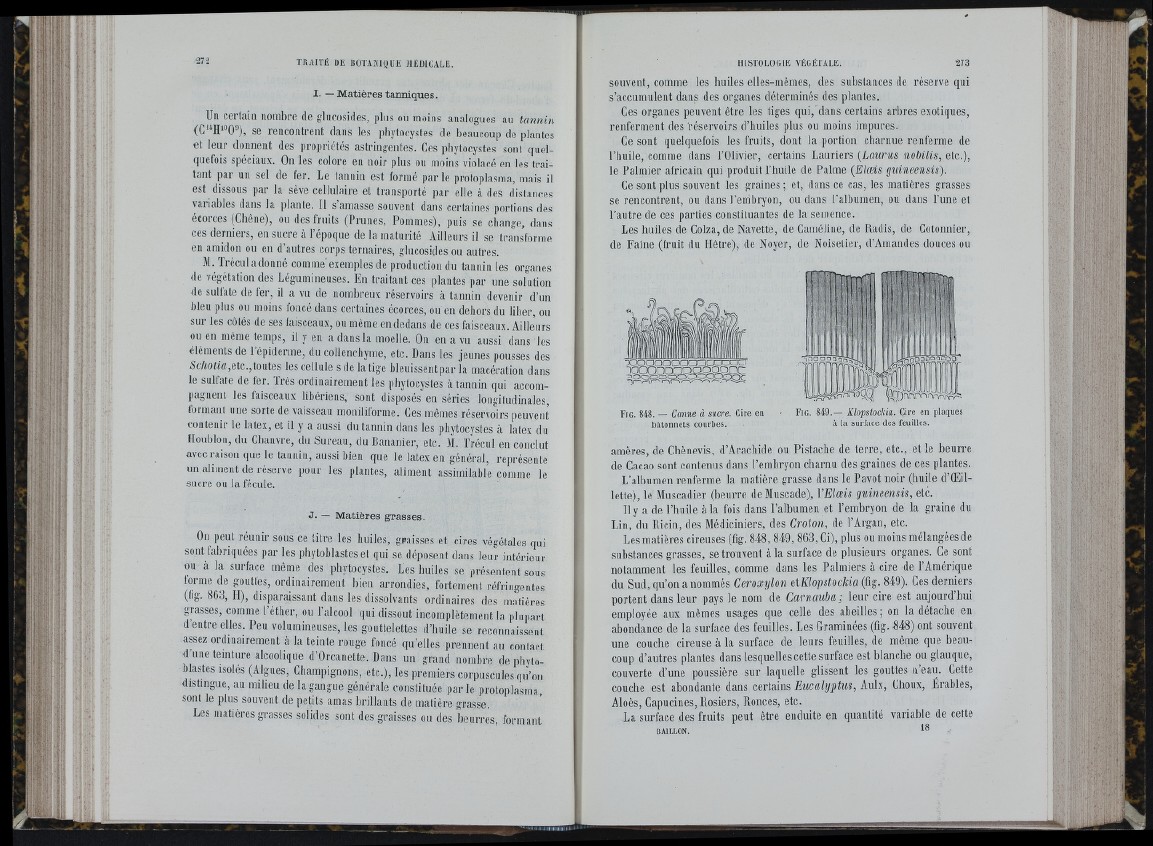
f
I
A u
i, ! f. .u
:|S k î ù
I. — Matières tanniques.
Un certain nombre de glucosides, plus ou moins analogues au tannin
se rencontrent dans les pbytocysles de beaucoup de plantes
et leur donnent des propriétés astringentes. Ces pbytocystes sont quelquefois
spéciaux. On les colore en noir plus ou moins violacé en les traitant
par un sel de fer. Le tannin est formé par le protoplasma, mais il
est dissous par la sève cellulaire et transporté par elle à des distances
vaiiables dans la plante. Il s amasse souvent dans certaines portions des
écorces (Cbène), ou des fruits (Prunes, Pommes), puis se change, dans
ces derniers, en sucre à l’époque de la maturité Ailleurs il se triînsforme
en amidon on en d’autres corps ternaires, glucosides ou autres.
M. Trécul a donné comme’ exemples de production du taimiu les organes
de végétation des Légumineuses. En traitant ces plantes par une solution
(le sulfate de fer, il a vu de nombreux réservoirs à tannin devenir d’un
bleu plus ou moins foncé dans certaines écorces, ou en dehors du liber, ou
sur les côtés de ses faisceaux, ou même en dedans de ces faisceaux. Ailleurs
ou eu même temps, il y en a dans la moelle. On en a vu aussi dans les
éléments de 1 épiderme, du collenchyme, etc. Dans les Jeunes pousses des
Schotia,etc.,toutes les cellule s de la tige bleuissent par la macération dans
le sulfate de fer. Très ordinairement les pbytocystes à tannin qui accompagnent
les faisceaux libériens, sont disposés en séries longitudinales,
formant une sorte de vaisseau moniliforme. Ces mêmes réservoirs peuvent
contenir le latex, et il y a aussi du tannin dans les pbytocystes à latex du
Houblon, du Chanvre, du Sureau, du Bananier, etc. M. Trécul en conclut
avec raison que le taimiu, aussi bien que le latex en général, représente
un aliment de réserve pour les plantes, aliment assimilable comme le
sucre ou la fécule.
J- — Matières grasses.
On peut réunir sous ce titre les huiles, graisses et cires végétales qui
sont fabriquées par les phytoblastes et qui se déposent dans leur intérieur
ou à la surface même des pbytocystes. Les huiles se présentent sous
tonne de gouttes, ordinairement bien arrondies, fortement réfringentes
(tig. 8G3, H), disparaissant dans les dissolvants ordinaires des imÎtières
grasses, comme l’étber, ou l’alcool qui dissout incomplètement la plupart
d’entre elles. Peu volumineuses, les gouttelettes d’huile se reconnaissent
assez ordinairement à la teinte rouge foncé qu’elles prennent au contact
d nue teinture alcoolique d’Orcaiiette. Dans un grand nombre de phytoblastes
isolés (Algues, Ghampignons, etc.), les premiers corpuscules qu’on
distingue, au milieu de la gangue générale constituée par le protoplasma,
sont le plus souvent de petits amas brillants de matière grasse.
Les matières grasses solides sont des graisses ou des beurres, formant
souvent, comme les huiles elles-mêmes, des substances de réserve qui
s’accumulent dans des organes déterminés des plantes.
Ces organes peuvent être les tiges qui, dans certains arbres exotiques,
renferment des réservoirs d’huiles plus ou moins impures.
Ce sont quelquefois les fruits, dont la portion charnue renferme de
l’huile, comme dans l’Olivier, certains Lauriers (Laurus nobilis, etc.),
le Palmier africain qui produit l’huile de Palme (Eloeis guineensis).
Ce sont plus souvent les graines; et, dans ce cas, les matières grasses
se rencontrent, ou dans l’embryon, ou dans l’albumen, ou dans l’une et
l’autre de ces parties constituantes de la semence.
Les huiles de Colza, de Navette, de Gaméline, de Radis, de Cotonnier,
de Faîne (fruit du Hêtre), de Noyer, de Noisetier, d’Amandes douces ou
_■_M___Q__Q__a_o_a__a_acxDqanaCT iOPi
Fjg. 848. — Canne à sucre. Cire en
bâtonnets courbes.
Fig. 849.— Klopsiockia. Cire en plaques
à la surface des feuilles.
amères, de Chènevis, d’Arachide ou Pistache de terre, etc., et le beurre
de Cacao sont contenus dans l’embryon charnu des graines de ces plantes.
L’albumen renferme la matière grasse dans le Pavot noir (huile d’OEil-
lette), le Muscadier (beurre de Muscade), VEloeis guineensis, etc.
Il y a de l’huile à la fois dans l’albumen et l’embryon de la graine du
Lin, du Ricin, des Médiciniers, des Croton, de l’Argan, etc.
Les matières cireuses (fig. 848, 849, 863, Gi), plus ou moins mélangées de
substances grasses, se trouvent à la surface de plusieurs organes. Ce sont
notamment les feuilles, comme dans les Palmiers à cire de l’Amérique
du Sud, qu’on a nommés Ceroxylon etKlopstocMa (fig. 849). Ces derniers
portent dans leur pays le nom de Carnauba; leur cire est aujourd’hui
employée aux mêmes usages que celle des abeilles ; on la détache en
abondance de la surface des feuilles. Les Graminées (fig. -848) ont souvent
une couche cireuse à la surface de leurs feuilles, de même que beaucoup
d’autres plantes dans lesquelles cette surface est blanche ou glauque,
couverte d’une poussière sur laquelle glissent les gouttes a ’eaii. Cette
couche est abondante dans certains Eucalyptus, Aulx, Choux, Érables,
Aloès, Capucines, Rosiers, Ronces, etc.
La surface des fruits peut être enduite en quantité variable de cette
BAILLON. ^3
1i