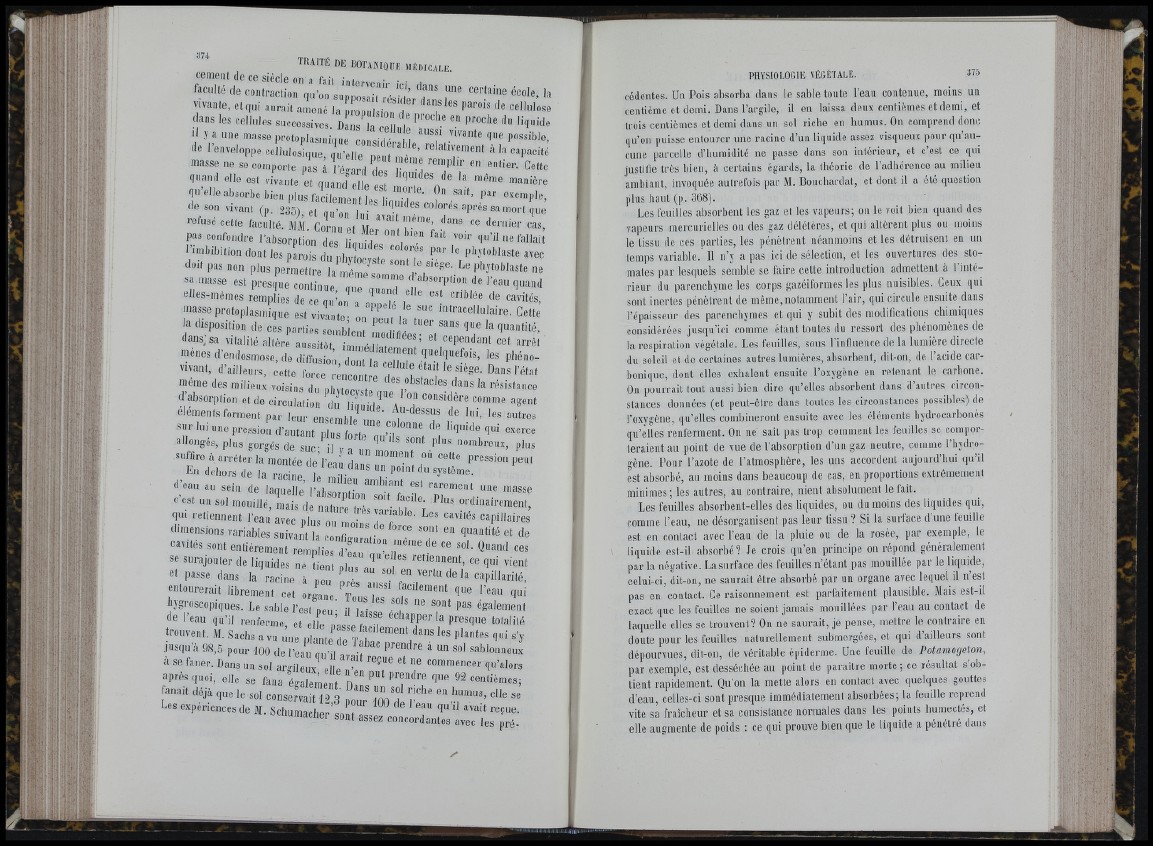
faculté de i 'o n f r a c iL r q t ’lrsupi^^^^^^^ '’f ® J"'® ‘^'^ole, la
vivante, et 'l'<i »:>roit a r e ? N k ; ! / ! / [ ; / f ;% ' <1? aellul’os;
(tans ies cellules successives Dsns l i / i ® ®"
" ï a •■"? .nasse P - 'o to p l a k “ ' J “ •, 1 1 "™ " ‘® '"'® P»?*'“ ?.
rte l’e..veloppe cellulosique, q.Pelle / ê l " “ ‘T “ ®"' “ ““P““ '?
masse ue se comporte pas à le»ar,i k , 1' ®" ' " ' ‘e?- ^etle
Oi.aurf elle gj, quand elle est ii!ÜT A "” '™® “ anière
QU elle absorbe bien pins facilement Iuî; f m Ou sait, par exemple,
de son vivant (p. 235) et qu’on Ini ^iprôs sa mort que
refusé cette faculté. MM. Coriiu et M '^^*®6ns ce dernier cas,
Y« confondre l ’absorption des liauidL i Qb’N ne fallait
l’imbibition dont les parois du DbvfomQi P^^r le phytoblaste avec
^loit pas non plus p e L e t î Î e sont le siège. Le phytoblaste ne
sa masse est presque continue mm n ' " T ' l ’eau quand
elles-mêmes remplies de ce qukn n f ^ criblée de cavités,
masse protoplasmique esl vivante- o n Z ^ h Z ' ' ’ '"*'’“e e " " 'a ire . Cette
la disposition de ces parties sembîeni / l r ‘®® 1“®
rtans;sa vilalilé altère aussitôt immé . ®®' eependant cet arrêt
mènes d'endosmose, de dilfusio,’, dont î m®/ .‘'" ''l . 'e fo i s , les ptiéno-
vivanl, d'ailleurs, )otle r r : ; . / “ , ! / ) f Z '® "®ê®' ' ’?*»'
meme des milieux voisins du nlivtoevsie ?s obstacles dans la résistance
rt'absorption et de circulation di! linuid?“ / , / ’ ' " ' ‘'" ‘‘é'-e »«mme agent
éléments forment par leur ensemlilc ' % rte lut, les autres
sur lui „ne pression d'autant o l n / Î , “® 1? '® ®'® “ i " “ ? i " ' exerce
allongés, pins gorgés de “ ^ '(1 '® / ® ® 1® P'"? '>oml..'eux, pins
suilire à arrêter la montée dcVeiu dan's' J® ??»« pression peut
Et. rtehors de ia raci.re l e ndie " "
(l’eau au sein de laquelle’ l ’absorncl "“ •?"/ ®f‘ ''“™“ ent une masse
e'es. un so, ' ’'"® ordinairement,
y®‘ '■el.ennent l'eau avec pins ou moins 2 r Z ®“''“ ®* e"!’'! '“ '.'«*
rtimenstons variables suivant la conir i- 1® ®°" ®" î " a . . ‘**é et de
cavités sont entièrement " n i i "d j 7e,;"®™®.'® ®® «"a.«! ces
se surajouter de liquides ne tient n l u r a j s ®®"e""ent, ce qui vient
et passe dans la racine à imn n ■ f"" vertu de la capillarité,
entourerait librement cet organe T T®®' f “ '? “ ? " “ I " ? l'eau qui
liygroscopiques. Le sable l'est peu^ il l / ®® ®°i "® ®®"* l"®® p a iem e n t
rte l'eau qu'il renferme el elfe n’as f i® ®® PP?"' 'a presque totalité
‘rouvent. M. Sachs a v u / n e p,1 , 7 .1®"®™®"%®"® I»“ '?? - id s’y
jusqu'a 98,5 pour 100 de l'eau ou'il av t "® P®?" a un sol sablonneux
à se faner. Dans un sol ar»ileux elle ? "®®“® ®‘ “® "“ “ mencer qu'alors
après quoi, elle se fana 7 em t 7 ' n ? " ‘ ’’/ " ' " f '’"® » « e e e ^m e s ;
anait déjà que le sol eonsei-vait ë s 7 " Z®d® 7 ®"
Ees expériences de M. Scbumae,ie)’s „ :
375
cédentes. Un Pois absorba dans le sable toute Teau contenue, moins un
centième et demi. Dans l’argile, il en laissa deux centièmes et demi, et
trois centièmes et demi dans un sol ricbe en humus. On comprend donc
qu’on puisse entourer une racine d’un liquide assez visqueux pour qu’aucune
parcelle d’bumidilé ne passe dans son intérieur, et c’est ce qui
justifie très bien, cà certains égards, la théorie de l’adhérence au milieu
ambiant, invoquée autrefois par M. Bouchardat, et dont il a été question
plus haut (p. 368).
Les feuilles absorbent les gaz et les vapeurs; on le voit bien quand des
vapeurs mercurielles ou des g<az délétères, et qui altèrent plus ou moins
le tissu de ces parties, les pénètrent néanmoins et les détruisent en un
temps variable.' D n’y a pcvs ici de sélection, et les ouvertures des stomates
par lesquels semble se faire celte introduction admettent à l’intérieur
du parenchyme les corps gazéiformes les plus nuisibles. Ceux qui
sont inertes pénètrent de même, notamment l’air, qui circule ensuite dans
l’épaisseur des parenchymes et qui y subit des modifications chimiques
considérées jusqu’ici comme étant toutes du ressort des phénomènes de
la respiration végétale. Les feuilles, sous l’influeiice de la lumière directe
du soleil et de certaines autres lumières, absorbent, dit-on, de l’acide carbonique,
dont elles exhalent ensuite l ’oxygène en retenant le carbone.
On pourrait tout aussi bien dire qu’elles absorbent dans d’autres circonstances
données (et peut-être dans toutes les circonstances possibles) de
Toxygène, qu’elles combineront ensuite avec les éléments hydrocarbones
qu’eUes renferment. On ne sait pas trop comment les feuilles se comporteraient
an point de vue de l’absorption d’un gaz neutre, comme l’h y d r e
gène. Pour l’azote de l’atmosphère, les uns accordent aujourd’hui qu’il
est absorbé, au moins dans beaucoup de cas, en proportions extrêmement
minimes; les autres, au contraire, nient absolument le fait.
Les feuilles absorbent-elles des liquides, ou du moins des liquides qui,
comme Peau, ne désorganisent pas leur tissu ? Si la surface d’une feuille
est en contact avec l’eau de la pluie ou de la rosée, par exemple, le
liquide est-il absorbé? Je crois qu’en principe on répond généralement
par la négative. La surface des feuilles n’étant pas mouillée par le liquide,
celui-ci, dit-on, ne saurait être absorbé par un organe avec lequel il n’est
pas en contact. Ge raisonnement est parfaitement plausible. Mais est-il
exact qne les feuilles ne soient jamais mouillées par l’eau au contact de
laquelle elles se trouvent? On ne saurait, je pense, mettre le contraire en
doute pour les feuilles naturellement submergées, et qui d’ailleurs sont
dépourvues, dit-on, de véritable épiderme. Une feuille de Potamogetón,
par exemple, est desséchée au point de paraître morte; ce résultat s’obtient
rapidement. Qu’on la mette alors en contact avec quelques gouttes
d’eau, celles-ci sont presque immédiatement absorbées; la feuille reprend
vite sa fraîcheur et sa consistance normales dans les points humectes, et
elle augmente de poids : ce qui prouve bien que le liquide a pénétré dans