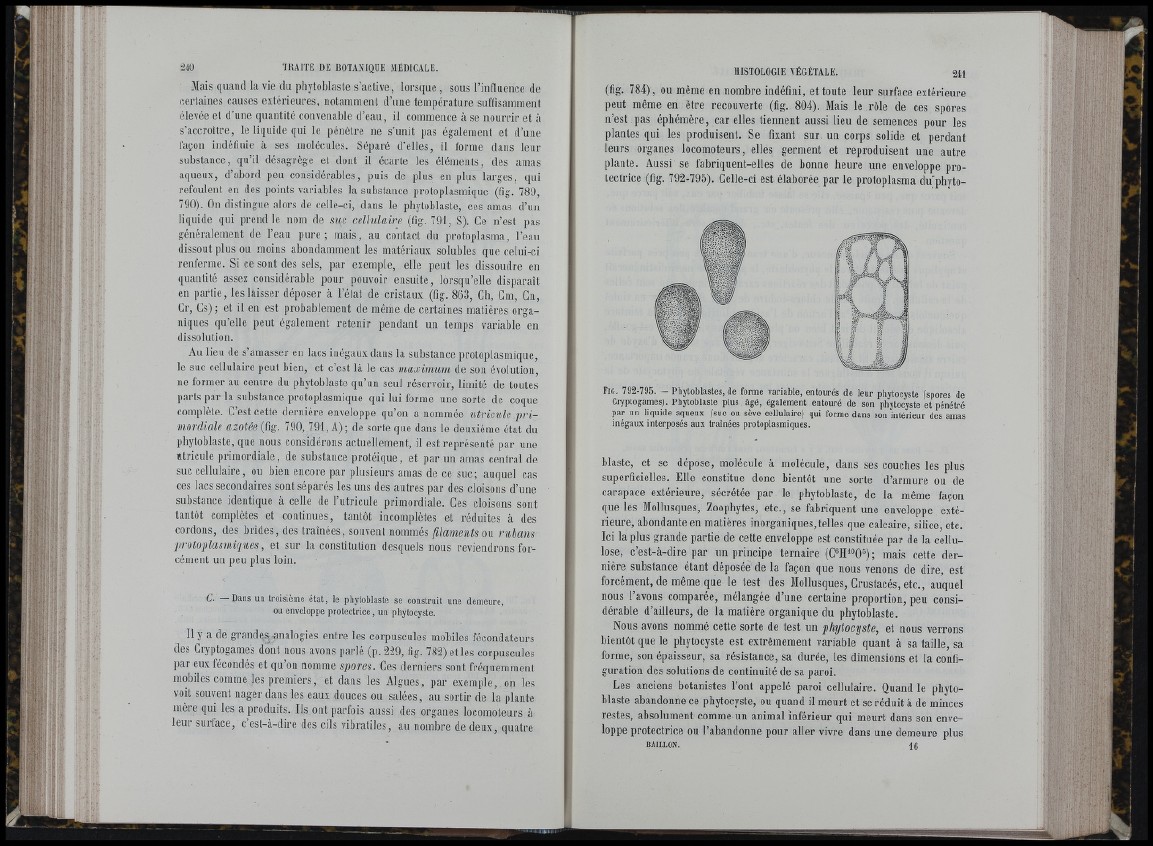
f i . •
Mais quand la vie du phytoblaste s’active, lorsque, sous l’inilueiice de
certaines causes extérieures, notamment d’nne température suffisamment
élevée et d’une quantité convenable d’eau, il commence à se nourrir et à
s’accroître, le liquide qui le pénètre ne s’unit pas également et d’une
façon indéfinie cà ses molécules. Séparé d’elles, il forme dans leur
substance, qu’il déscagrège et dont il écarte les éléments, des amas
caqueux, d’abord peu considérables, puis de plus en plus Larges, qui
refoulent en des points variables la substance protoplasmique (fig. 789,
790). On distingue alors de celle-ci, dcans le phytobLaste, ces amas d’un
liquide qui prend le nom de suc cellulaire (fig. 791, S). Ce n’est pcas
généralement de l’ccau p u re ; imais, au contact du protoplasma, Veau
dissout plus ou moins cabondamment les matéricaux solubles que celui-ci
renferme. Si ce sont des sels, par exemple, elle peut les dissoudre en
quantité assez considérable pour pouvoir ensuite, lorsqu’elle dispcaraît
en partie, les laisser déposer à l’étcat de cristaux (fig. 863, Ch, Cm, Cn,
Cr, Cs) ; et il en est probablement de même de certaines matières organiques
qu’elle peut égcalement retenir pendant un temps variable en
dissolution.
Au lieu de s’camasser en lacs inégiiux dans la substance protoplasmique,
le suc celluLaire peut bien, et c’est là le cas ma x imum de son évolution,
ne former au centre du phytoblaste qu’un seul réservoir, limité de toutes
piirts par la substance protoplasmique qui lui forme une sorte de coque
complète. C’est cette dernière enveloppe qu’on a nommée utricule p r i mordiale
azotée (fig. 790, 791, A) ; de sorte que dans le deuxième état du
phytoblaste, que nous considérons actuellement, il est représenté par une
utricule primordiale, de substance protéique, et par un amas central de
suc cellulaire, ou bien encore par plusieurs amas de ce suc; auquel cas
ces lacs secondaires sont séparés les uns des autres par des cloisons d’une
substance identique à celle de l’utricule primordiale. Ces cloisons sont
tantôt complètes et continues, tantôt incomplètes et réduites à des
cordons, des brides, des traînées, souvent nommés filaments oa rubans
protoplasmiques, et sur la constitution desquels nous reviendrons forcément
un peu plus loin.
C- Dans un troisième état, le phytoblaste se construit une demeure,
ou enveloppe protectrice, un phytocyste.
Il y a de grande^ analogies entre les corpuscules mobiles fécondateurs
des Cryptogames dont nous avons parlé (p. 229, fig. 782) et les corpuscules
par eux fécondés et qu’on nomme spores. Ces derniers sont fréquemment
mobiles comme les premiers, et dans les Algues, par exemple, on les
voit souvent nager dans les eaux douces ou salées, au sortir de la plante
mère qui les a produits. Ils ont parfois aussi des organes locomoteurs à
leur surface, c est-à-dire des cils vibrátiles, au nombre de deux, quatre
(fig. 784), ou même en nombre indéfini, et toute leur surface extérieure
peut même en être recouverte (fig. 804). Mais le rôle de ces spores
n ’est pas éphémère, car elles tiennent aussi lieu de semences pour les
plantes qui les produisent. Se fixant sur un corps solide et perdant
leurs organes locomoteurs, elles germent et reproduisent une autre
plante. Aussi se fabriquent-elles de bonne heure une enveloppe protectrice
(fig. 792-795). Celle-ci est élaborée par le protoplasma du'pliyto-
Fig. 792-795. - Phytoblastes, de forme variable, entourés de leur phytocyste (spores de
Cryptogames). Phytoblaste plus âgé, également entouré de son phytocyste et pénétré
par un liquide aqueux (suc ou sève cellulaire) qui forme dans son intérieur des amas
inégaux interposés aux traînées protoplasmiques.
blaste, et se dépose, molécule à molécule, dans ses couches les plus
superficielles. Elle constitue donc bientôt une sorte d’armure ou de
carapace extérieure, sécrétée par le phytoblaste, de ia même façon
que les Mollusques, Zoophytes, etc., se fabriquent une enveloppe extérieure,
abondante en matières inorganiques, telles que calcaire, silice, etc.
Ici la plus grande partie de cette enveloppe est constituée par de la cellulose,
c’est-à-dire par un principe ternaire (G®H^°0^); mais cette dernière
substance étant déposée de la façon que nous venons de dire, est
forcément, de même que le test des Mollusques, Crustacés, etc., auquel
nous l ’avons comparée, mélangée d’une certaine proportion, peu considérable
d’ailleurs, de la matière organique du phytoblaste.
Nous avons nommé cette sorte de test un phytocyste, et nous verrons
bientôt que le phytocyste est extrêmement variable quant à sa taille, sa
forme, son épaisseur, sa résistance, sa durée, les dimensions et la configuration
des solutions de continuité de sa paroi.
Les anciens botanistes l’ont appelé paroi cellulaire. Quand le phytoblaste
abandonne ce phytocyste, ou quand il m eurt et se réduit à de minces
restes, absolument comme un animal inférieur qui meurt dans son enveloppe
protectrice ou l ’abandonne pour aller vivre dans une demeure plus
BAILLON. 16
, “hboei.i-i
I'M K f'i .1
l i]
" k
iï
i «i <
’ •4... • *v. A'ù"
• .tóc '«wyrtiBfSM V' f 'f*A-
I ■ J
1 f,.
14- ’"!4
i|-, ’
j I ■ - • f i S i t e i . , - m * ' ‘ - I '- '» - "
MSEIS?-. Ul.
IK ill' ' ............. > I , »
'fil« r i «k
■' .‘' k , /
sa
- .-"Mil - ’.î
! ......4. , - 1
.... ■' •!
. ' '■ l