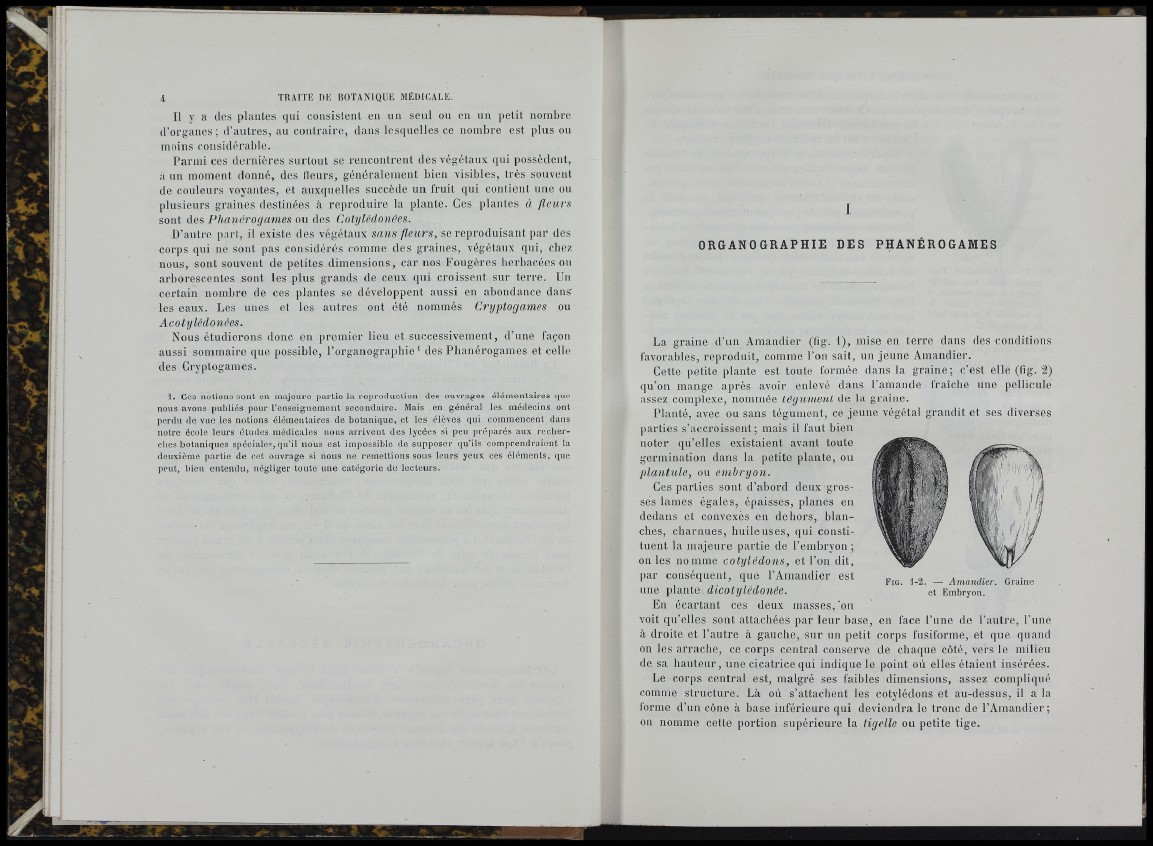
m
l ! ; !
i
i I
Il y a des plantes qui consistent en un seul ou en un petit nombre
d’organes; d’autres, au contraire, dans lesquelles ce nombre est plus ou
moins considérable.
Parmi ces dernières surtout se rencontrent des végétaux qui possèdent,
à un moment donné, des lleurs, généralement bien visibles, très souvent
de couleurs voyantes, et auxquelles succède un fruit qui contient une ou
plusieurs graines destinées à reproduire la plante. Ces plantes à fleurs
sont des Phanérogames ou des Cotylédonées.
D’autre part, il existe des végétaux sans fleurs, se reproduisant par des
corps qui ne sont pas considérés comme des graines, végétaux qui, chez
nous, sont souvent de petites dimensions, car nos Fougères herbacées ou
arborescentes sont les plus grands de ceux c{ui croissent sur terre. Un
certain nombre de ces plantes se développent aussi en abondance dans
les eaux. Les nues et les autres ont été nommés Cryptogames ou
Acotylédonées.
Nous étudierons donc en premier lien et successivement, d’une façon
aussi sommaire que possible, l’organographie ^ des Phanérogames et celle
des Cryptogames.
1. Ces notions sont en majeure partie la reproduction des ouvrages élémentaires que
nous avons publiés pour l’enseignement seconUaire. Mais en général les médecins ont
perdu de vue les notions élémentaires de botanique, et les élèves qui commencent dans
notre école leurs éludes médicales nous arrivent des lycées si peu préparés aux recherches
botaniques spéciales, qu’il nous est impossible de supposer qu’ils comprendraient la
deuxième partie de cet ouvrage si nous ne remettions sous leurs yeux ces éléments, que
peut, bien entendu, négliger tonte une catégorie de lecteurs.
ORGANOGRAPHIE DES PHANÉROGAMES
La graine d’un Amandier (üg. 1), mise en terre dans des conditions
favorables, reproduit, comme l’on sait, un jeune Amandier.
Cette petite plante est toute formée dans la graine; c’est elle (fig, 2)
qu’on mange après avoir enlevé dans l’amande fraîche une pellicule
assez complexe, nommée tégument de la graine.
Planté, avec ou sans tégument, ce jeune végétal grandit et ses diverses
parties s’accroissent; mais il faut bien
noter qu’elles existaient avant toute
germination dans la petite plante, ou
plantule, ou embryon.
Ces parties sont d’abord deux grosses
lames égales, épaisses, planes en
dedans et convexes en dehors, blanches,
charnues, huileuses, qui constituent
la majeure partie de l’embryon;
on les nomme cotylédons, et l’on dit,
par conséquent, que l’Amandier est
Fig. 1-2. — Am a n d ie r. Graine
une p]3.nie\ dicotylédonée.
et Embryon.
En écartant ces deux masses,'on
voit qu’elles sont attachées par leur base, en face l’une de l’autre, l’une
à droite et l’autre à gauche, sur un petit corps fusiforme, et que quand
on les arrache, ce corps central conserve de chaque côté, vers le milieu
de sa hauteur, une cicatrice qui indique le point où elles étaient insérées.
Le corps central est, malgré ses faibles dimensions, assez compliqué
comme structure. Là où s’attachent les cotylédons et au-dessus, il a la
forme d’un cône à base inférieure qui deviendra le tronc de l ’Amandier;
on nomme cette portion supérieure la tigelle ou petite tige.