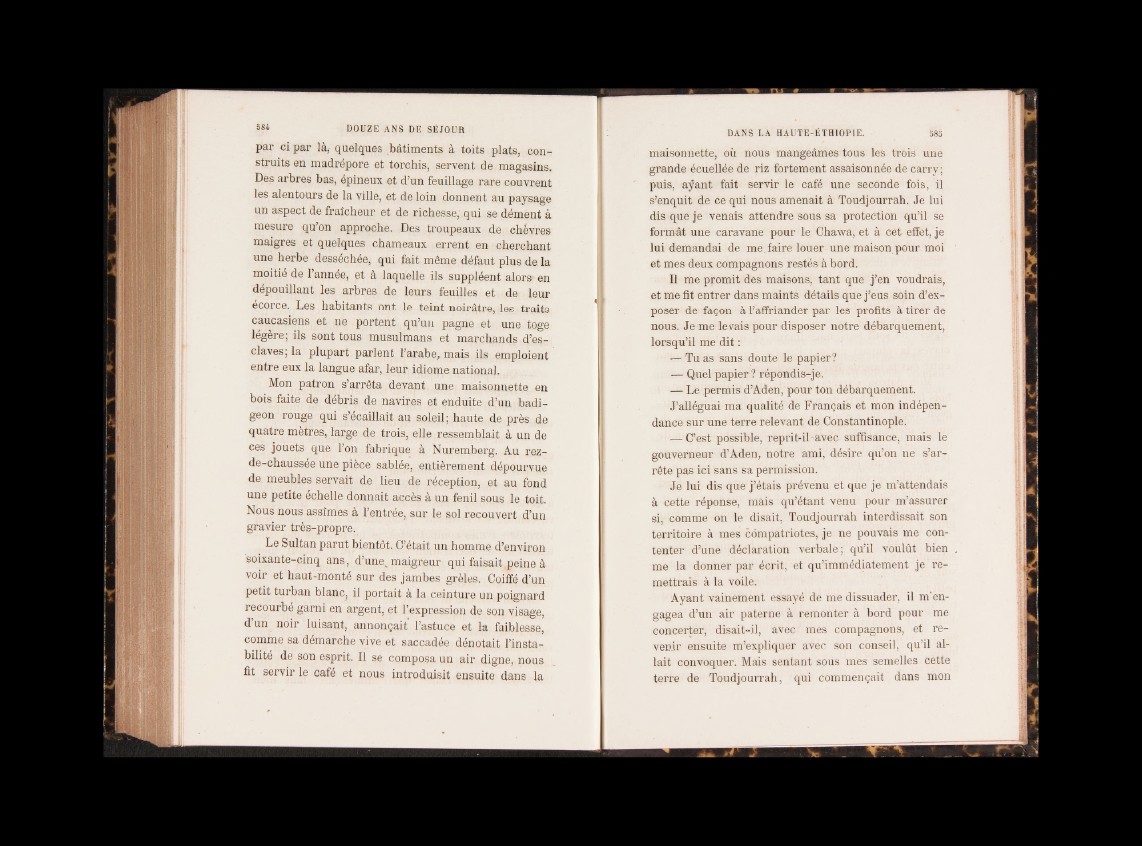
par ci par là, quelques bâtiments à toits plats, construits
en madrépore et torchis, servent de magasins.
Des arbres bas, épineux et d’un feuillage rare couvrent
les alentours de la ville, et de loin donnent au paysage
un aspect de fraîcheur et de richesse, qui se dément à
mesure qu’on approche. Des troupeaux de chèvres
maigres et quelques chameaux errent en cherchant
une herbe desséchée, qui fait même défaut plus de la
moitié de l’année, et à laquelle ils suppléent alors en
dépouillant les arbres de leurs feuilles et de leur
écorce. Les habitants ont le teint noirâtre, les traits
caucasiens et ne portent qu’un pagne et une toge
légère; ils sont tous musulmans et marchands d’esclaves;
la plupart parlent l’arabe, mais ils emploient
entre eux la langue afar, leur idiome national.
Mon patron s’arrêta devant une maisonnette en
bois faite de débris de navires et enduite d’un badigeon
rouge qui s’écaillait au soleil; haute de près de
quatre mètres, large de trois, elle ressemblait à un de
ces jouets que l’on fabrique à Nuremberg. Au rez-
de-chaussée une pièce sablée, entièrement dépourvue
de meubles servait de lieu de réception, et au fond
une petite échelle donnait accès à un fenil sous le toit.
Nous nous assîmes à l’entrée, sur le sol recouvert d’un
gravier très-propre.
Le Sultan parut bientôt. C’était un homme d’environ
soixante-cinq ans, d’une^ maigreur qui faisait peine à
voir et haut-monté sur des jambes grêles. Coiffé d’un
petit turban blanc; il portait à la ceinture un poignard
recourbé garni en argent, et l’expression de son visage,
d’un noir luisant, annonçait l’astuce et la faiblesse,
comme sa démarche vive et saccadée dénotait l’instabilité
de son esprit. Il se composa un air digne, nous
fit servir le café et nous introduisit ensuite dans la
maisonnette, où nous mangeâmes tous les trois une
grande écuellée de riz fortement assaisonnée de carry;
puis, ayant fait servir le café une seconde fois, il
s’enquit de ce qui nous amenait à Toudjourrah. Je lui
dis que je venais attendre sous sa protection qu’il se
formât une caravane pour le Chawa, et à cet effet, je
lui demandai de me. faire louer une maison pour moi
et mes deux compagnons restés à bord.
Il me promit des maisons, tant que j’en voudrais,
et me fit entrer dans maints détails que j’eus soin d’exposer
de façon à l’affriander par les profits à tirer de
nous. Je me levais pour disposer notre débarquement,
lorsqu’il me dit :
— Tu as sans doute le papier?
— Quel papier ? répondis-je.
— Le permis d’Aden, pour ton débarquement.
J’alléguai ma qualité de Français et mon indépendance
sur une terre relevant de Constantinople.
— C’est possible, reprit-il avec suffisance, mais le
gouverneur d’Aden, notre ami, désire qu’on ne s’arrête
pas ici sans sa permission.
Je lui dis que j’étais prévenu et que je m’attendais
à cette réponse, mais qu’étant venu pour m’assurer
si, comme on le disait, Toudjourrah interdissait son
territoire à mes compatriotes, je ne pouvais me contenter
d’une déclaration verbale; qu’il voulût bien
me la donner par écrit, et qu’immédiatement je remettrais
à la voile.
Ayant vainement essayé de me dissuader, il m’engagea
d’un air paterne à remonter à bord pour me
concerter, disait-il, avec mes compagnons, et revenir
ensuite m’expliquer avec son conseil, qu’il allait
convoquer. Mais sentant sous mes semelles cette
terre de Toudjourrah, qui commençait dans mon