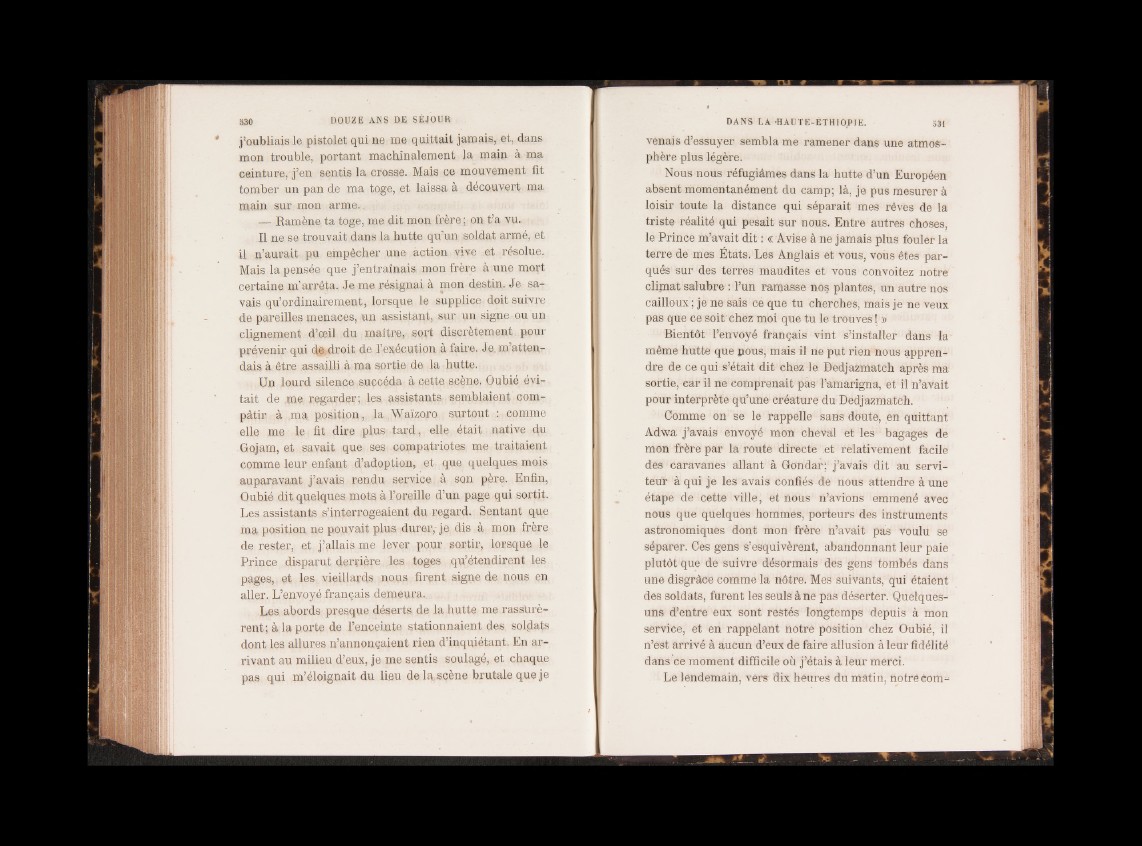
j’oubliais le pistolet qui ne me quittait jamais, et, dans
mon trouble, portant machinalement la main à ma
ceinture, j’en sentis la crosse. Mais ce mouvement fit
tomber un pan de ma toge, et laissa à découvert ma
main sur mon arme..
— Ramène ta toge, me dit mon frère ; on t’a vu.
Il ne se trouvait dans la.hutte qu’un soldat armé, et
il n’aurait pu empêcher une action vive :et résolue.
Mais la pensée que j’entraînais mon frère à une mort
certaine m’arrêta. Je me résignai à mon destin. Je savais
qu’ordinairement, lorsque le supplice doit suivre
de pareilles menaces, un assistant, sur un signe ou un
clignement d’oeil du maître, sort discrètement pour
prévenir qui de droit de l’exécution à faire. Je. m’attendais
à être assailli à ma sortie de la hutte.
Un lourd silence succéda à cette scène. Oubié évitait
de me regarder; les assistants semblaient com-
pâtir à ma position, la Waïzoro surtout : comme
elle me le fit dire plus tard, elle était native du
Gojam, et savait que ses compatriotes me traitaient
comme leur enfant d’adoption, et. que quelques mois
auparavant j’avais rendu service à son père. Enfin,
Oubié dit quelques mots à l’oreille d’un page qui sortit.
Les assistants s’interrogeaient du regard. Sentant que
ma position ne pouvait plus durer,-je dis à mon frère
de rester, et j’allais me lever pour sortir, lorsque le
Prince disparut derrière les toges qu’étendirent les
pages, et les vieillards nous firent signe de nous en
aller. L’envoyé français demeura.
Les abords presque déserts de la hutte me rassurèrent;
à la porte de l’enceinte stationnaient des soldats
dont les allures n’annonçaient rien d’inquiétant. En arrivant
au milieu d’eux, je me sentis soulagé, et chaque
pas qui m’éloignait du li.eu dela„.scène brutale que je
venais d’essuyer sembla me ramener dans une atmosphère
plus légère.
Nous nous réfugiâmes dans la hutte d’un Européen
absent momentanément du camp; là, je pus mesurer à
loisir toute la distance qui séparait mes rêves de la
triste réalité qui pesait sur nous. Entre autres choses,
le Prince m’avait dit : « Avise à ne jamais plus fouler la
terre de mes États. Les Anglais et vous, vous êtes parqués
sur des terres maudites et vous convoitez notre
climat salubre : l’un ramasse no§ plantes, un autre nos
cailloux ; je ne sais ce que tu cherches, mais je ne veux
pas que ce soit chez moi que tu le trouves ! »
Bientôt l’envoyé français vint s’installer dans la
même hutte que nous, mais il ne put rien nous apprendre
de ce qui s’était dit chez le Dedjazmatch après ma
sortie, car il ne comprenait pas l’amarigna, et il n’avait
pour interprète qu’une créature du Dedjazmatch.
Comme on se le rappelle sans doute, en quittant
Adwa j’avais envoyé mon cheval et les bagages de
mon frère par la route directe et relativement facile
des caravanes allant à Gondar; j’avais dit au serviteur
à qui je les avais confiés de nous attendre à une
étape de cette ville, et nous n’avions emmené avec
nous que quelques hommes, porteurs des instruments
astronomiques dont mon frère n’avait pas voulu se
séparer. Ces gens s’esquivèrent, abandonnant leur paie
plutôt que de suivre désormais des gens tombés dans
une disgrâce comme la nôtre. Mes suivants, qui étaient
des soldats, furent les seuls à ne pas déserter. Quelques-
uns d’entre eux sont restés longtemps depuis à mon
service, et en rappelant notre position chez Oubié, il
n’est arrivé à aucun d’eux de faire allusion à leur fidélité
dans ce moment difficile ou j’étais à leur merci.
Le lendemain, vers dix heures du mâtin, notre èom