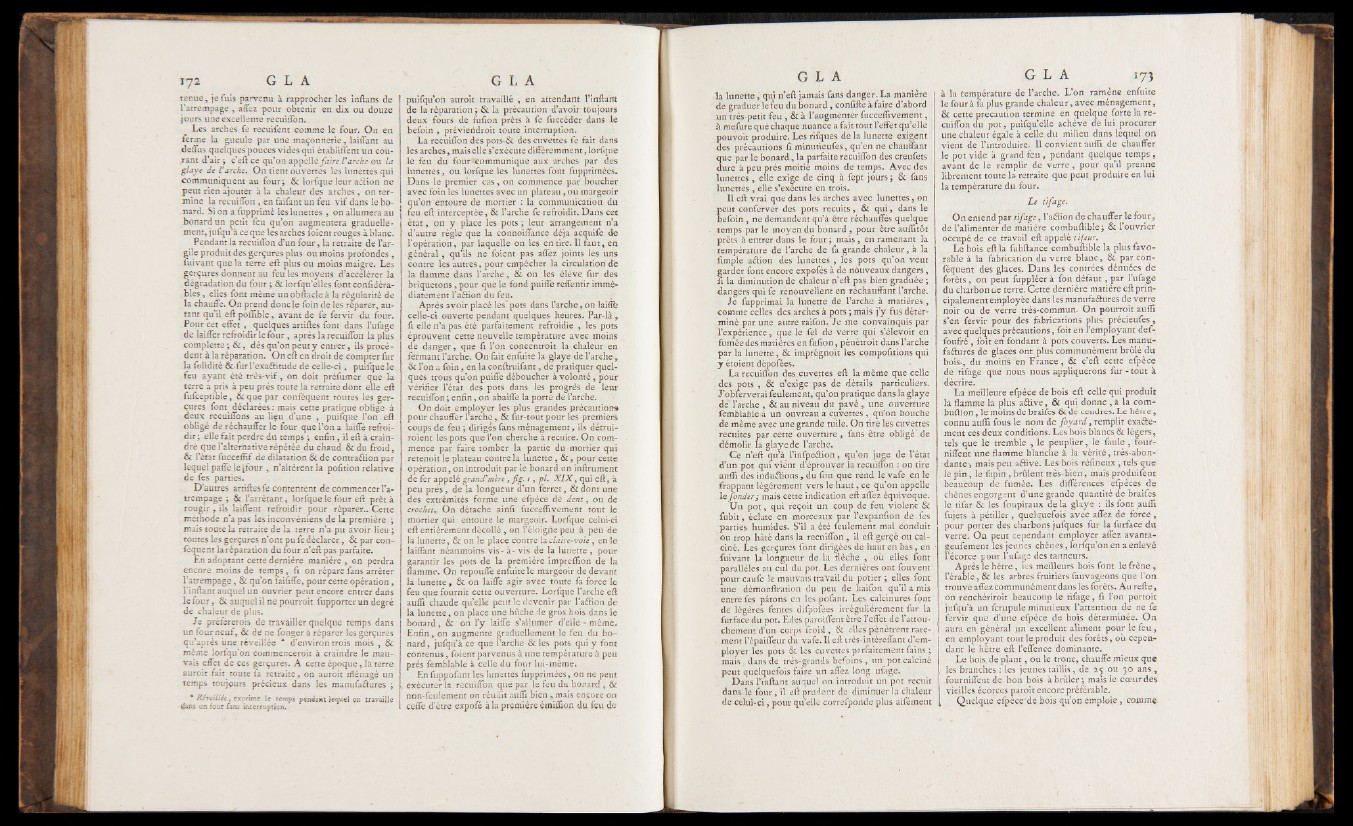
tenue, je fuis parvenu à rapprocher les inflans de
l ’atrempage, affez pour obtenir en dix ou douze
jours une excellente recuiffon.
Les arches fe recuifent comme le four. On en
ferme la gueule par une maçonnerie, laiflant au
deffus quelques pouces vides qui établirent un courant
d’air ; c’eft ce qu’on appellè faire l'arche ou la
glaye de l’arche. On tient ouvertes les lunettes qui
communiquent au four; & lorfque leur aélion ne
peut rien ajouter à la chaleur des arches , on termine
la recuiffon , en faifant un feu y if dans le bonard.
Si on afupprimé les lunettes , on allumera au
bonard un petit feu qu’on augmentera graduellement,
jufqu’à ce que les arches loienr rouges à blanc.
Pendant la recuiffon d’un four, la retraite de l’argile
produit des gerçures plus ou moins profondes,
iuivant que la terre eft plus ou moins maigre. Les
gerçures donnent au feu les moyens d’accélérer la
dégradation du four ; & lorfqu’elles font confidéra-
bles, elles font même un obftacle à la régularité de
la chauffe. On prend donc le foin de les réparer, autant
qu’il eft poflible, avant de fe fervir du four.
Pour cet e ffet, quelques artiftes font dans l’ufage
de laiffer refroidir le four , après la recuiffon la plus
complette ; & , dès qu’on peut y entrer, ils procèdent
à la réparation. On eft en droit de compter fur
la fôlidité &-furl’exa£titude de celle-ci, puifque le.
feu ayant été très-vif, on doit préfumer que la
terre a pris à peu près toute la retraite dont elle eft
fufceptible, & que par conféquent toutes les gerçures
font déclarées : mais cette pratique oblige à
deux recuiffons au lieu d’une , puifque l’on eft
obligé de réchauffer le four que l’on a laiffé refroidir;
elle fait perdre du temps ; enfin, il eft à craindre
que l’alternative répétée du chaud & du froid,
& l’état fucceffif de dilatation & de contraction par
lequel paffe le '|four , n’altèrent la pofition relative
de fes parties.
D ’autres artiftes fe contentent de commencer Fa-
trempage ; & l’arrêtant, lorfque le.four eft prêt à
rougir , ils laiffent refroidir pour réparer.. Cette
méthode n’a pas les inconvéniens de la première ;
mais toute la retraite de la terre n’a pu avoir lieu ;
toutes les gerçures n’ont pu fe déclarer, & par conféquent
la réparation du four n’eft pas parfaite.
En adoptant cette dernière manière , on perdra
encore moins de temps , fi on répare fans arrêter
l ’atrempage, & qu’on faififfe, pour cette opération,
l'inftant auquel un ouvrier peut encore entrer dans
le four, & auquel il ne pourroit fupporter un degré
de chaleur de plus.
Je préférerois de travailler quelque temps dans
un four neuf, & de ne fonger à réparer les gerçures
qu’après une réveillée * d’environ trois mois , &
même lorfqu’on commenceroit à craindre le mauvais
effet de ces gerçures. A cette époque, la terre
auroit fait toute la retraite, on auroit ménagé un
temps toujours précieux dans les manufactures ;
* Réveillée, exprime le temps pendant lequel on travaille
dans un four fans interruption.
puifqu’on auroit travaillé , en attendant l’înftartt
de la réparation ; & la précaution d’avoir toujours
deux fours de fufion prêts à fe fuccéder dans le
befoin , prévieridroit toute interruption.
La recuiffon des pots-& des cuvettes fe fait dans
les arches, mais elle s’exécute différemment, lorfque
le feu du four'Communique aux arches par des
lunettes, ou lorfque les lunettes font fupprimées.
Dans le premier cas , on commence par boucher
avec foin les lunettes avec un plateau, ou margeoir
qu’on entoure de mortier : la communication du
feu eft interceptée, & l’arche fe refroidit. Dans cet
état, on y place les pots ; leur arrangement n’a
d’autre règle que la connoiffance déjà acquife de
l’opération, par laquelle on les en tire. Il faut, en
général, qu’ils ne foient pas affez joints les uns
contre les autres, pour empêcher la circulation de
la flamme dans l’arche, & on les élève fur des
briquetons, pour que le fond puiffe reffentir immédiatement
Faction du feu.
Après avoir placé les" pots dans l’arche , on laiflfe
celle-ci ouverte pendant quelques heures. Par-là ,
fi elle n’a pas été parfaitement refroidie , les pots
éprouvent cette nouvelle température avec moins .
de danger, que fi l’on concentroit la chaleur en
fermant l’arche. On fait enfuite la glaye de l’arche ,
& l’on a foin, en la conftruifant, de pratiquer quelques
trous qu’on puiffe déboucher à volonté, pour
vérifier l’état des pots dans les progrès de leur
recuiffon ; enfin, on abaiffe la porte de l’arche.
On doit employer les plus grandes précaution»
pour chauffer l’arche, & fur-tout pour les premiers
coups de feu ; diriges fans ménagement, ils détrui-
roient les pots que l’on cherche à recuire. On commence
par faire tomber la partie du mortier qui
retenoit le plateau contre la lunette, & , pour cette
opération, on introduit par le bonard un infiniment
de fer appelé grand’mère, fig. 1 , pl. X IX , qui eft, à
peu près, de la longueur d’un ferret, & dont une
des extrémités forme une efpèce de dent, ou de
crochetOn détache ainfi fucceflivement tout le
mortier qui entoure le margeoir. Lorfque celui-ci
eft entièrement décollé, on l’éloigne peu à peu de
la lunette, & on le place contre la claire-voie, en le
laiflant néanmoins v is -à -v is de la lunette , pour
garantir les pots de la première impreflion de la
flamme. On repouffe enfuite le margeoir de devant
la lunette, & on laiffe agir avec toute fa force le
feu que fournit cette ouverture. Lorfque l’arche eft
aufli chaude qu’elle peut le devenir par Faétion de
la lunette, on place une bûche de gros bois dans le
bonard, & on l’y laiffe s’allumer d’elle - même.
Enfin, on augmente graduellement le feu du bonard,
jufqii’à ce que l’arche & les pots qui y font
contenus , foient parvenus à une température à peu
près femblable à celle du four lui-même.
En fuppofant les lunettes fupprimées, on ne peut
exécuter la recuiffon que par le feu du bonard , &
non-feulement on réuffit aufli bien, mais encore on
ceffe d’être expofé à la première émiflion du feu de
la lunette, qui n’eft jamais fans danger. La manière
de graduer le feu du bonard, confifte à-faire d’abord
un très-petit feu , & à l’augmenter fucceflivement, j
à mefure què chaque nuance a fait tout l’effet qu’elle ;
pouvoit produire. Les rifques de la lunette exigent
des précautions fi minutieufes, qu’en ne chauffant
que par le bonard-, la parfaite recuiffon des creufets
dure à peu près moitié moins de temps. Avec des |
lunettes , elle exijp de cinq à fept jours ; & fans
lunettes , elle s’exécute en trois.
Il eft vrai que dans les arches avec lunettes, on
peut conferver des pots recuits, & qui, dans le
befoin , ne demandent qu’à être réchauffés quelque
temps par le moyen du bonard , pour être auflitôt
prêts à entrer dans le four ; mais, en ramenant la
température de l’arche de fa grande chaleur, à la
fimple aétion des lunettes , les pots qu’on veut
garder font encore expofés à de nouveaux dangers,
fr la diminution de chaleur n’eft pas bien graduée ;
dangers qui fe renouvellent en réchauffant l’arche.
Je fupprimai la lunette de l’arche à matières ,
comme celles des arches à pots ; mais j’y fus déterminé
par une autre raifon. Je me convainquis par
l’expérience, que le fel de verre qui s’élevoit en
fumée des matières en fufion, pénétroit dans l’arche
par la lunette, & imprégnoit les compofitions qui
y étoient dépofées.
La recuiffon des cuvettes eft la même que celle
des pots , & n’exige pas de détails particuliers.
J’obferverai feulement, qu’on pratique dans la glaye
. de' l’arche , & au niveau du pavé , une ouverture
femblable4 un ouvreau à cuvettes , qu’on bouche
de même avec une grande tuile. On tire les cuvettes
recuites par cette ouverture, fans être obligé de
démolir la glaye de l’arche.
Ce n’eft qu’à l’infpe&ion, qu’on juge de l’état
d’un pot qui vient d’éprouver la recuiflon : on tire
aufli des inductions, du fon que rend le vafe en le
frappant légèrement vers le haut, ce qu’on appelle
le fonder; mais cette indication eft affez équivoque.
Un p ot, qui reçoit un coup de feu violent &
fubit, éclate en morceaux par l’expànfion de fes
parties humides. S’il a été feulement mal Conduit
ou trop hâté dans la recuiffon , il eft gerçé ou calciné.
Les gerçures font dirigées de haut en bas, en
fuivant la longueur de la flèche , où elles font
parallèles au cul du pot. Les dernières ont fouvent'
pour caufe le mauvais travail du potier ; elles font
. une démonftration du peu de liaifon qu’il a mis
entre fes pâtons en les pofant. Les calcinures font
dé légères fentes difpofées irrégulièrement fur la
furface du pot. Elles paroiffent être l’effet de l’attouchement
d’un corps froid , & elles pénètrent rarement
l’épaiffeur du vafe. Il eft très-intéreffant d’employer
les pots & les cuvettes parfaitement fains ;
mais ; dans de très-grands befoins , un pot calciné
peut quelquefois faire un affez long ufage.
Dans l’inftant auquel on introduit un pot recuit
dans le four * il eft prudent de diminuer la chaleur
de celui-ci, pour qu’elle correfponde plus aifément
à la température de l’arche. L’on ramène enfuite
le four à fa plus grande chaleur, avec ménagement,
& cette précaution termine en quelque forte la recuiffon
du pot, puifqu’elle achève de lui procurer
une chaleur égale à celle du milieu dans lequel on
vient de l’introduire. Il convient aufli de chauffer
le pot vide à grand feu , pendant quelque temps ,
avant de le remplir de verre , pour qu’il prenne
librement toute la retraite que peut produire en lui
la température du four.
Le tifagei
On entend par tifage, l’aétion de chauffer le four
de l’alimenter de matière combuftible; & l’ouvrier
occupé de ce travail eft appelé tifeur.
Le bois eft la fubftance combuftible la plus favorable
à la fabrication du verre blanc, & par conféquent
des glaces. Dans les contrées dénuées de
forêts, on peut fuppléer à fon défaut, par l’ufage
du charbon ae terre. Cette dernière matière eft principalement
employée dans les manufa&ures de verre
noir ou de verre très-commun. On pourroit aufli
s’en fervir pour des fabrications plus précieufes,
avec quelques précautions, foit en l’employant def-.
foufré , foit en fondant à pots couverts. Les manu-
faâurés de glaces ont plus communément brûlé du
bois-, du moins en France, & c’eft cette efpèce
de tifage que nous nous appliquerons fur - tout à
décrire.
La meilleure efpèce de bois eft celle qui produit
la flamme la plus a&ive, & qui donne , à la com-
buflion, le moins de braifes & de cendres. Le hêtre,
connu aufli fous le nom de foyard, remplit exactement
ces deux conditions. Les bois blancs & légers,
tels que le tremble , le peuplier, le faule, four-
niffent une flamme blanche à la vérité, très-abondante^
mais peu aétive. Les bois réfineux , tels que
, le pin, le fapin , brûlent très-bien, mais produifent
beaucoup de fumée. Les différences efpèces de
chênes engorgent d’une grande quantité de braifes
le tifar & les foupiraux de la glaye : ils font aufli
fujets à pétiller, quelquefois avec affez de force,
pour porter des charbons jufques fur la furface du
verre. On peut cependant employer affez avanta-
geufement les jeunes chênes, lorfqu’on en a enlevé
l’écorce pour l’ufage des tanneurs.
Après le hêtre , les meilleurs bois font le frêne ,
l’érable, & les arbres fruitiers fauvageons que l’on
trouve affez communément dans les forêts. Au refte,
on renchériroit beaucoup le tifage, fi Fon portoit
jufqu’à un fcrupule minutieux l’attention de ne fe
fervir que d’une efpèce de bois déterminée. On
aura en général un excellent aliment pour le feu,
en employant tout le produit des forêts, où cependant
le hêtre eft l’effence dominante.
Le bois, de plant, ou le tronc, chauffe mieux que
les branches : les jeunes taillis, de 25 ou 30 ans ,
fourniffent de bon bois à brûler ; mais le coeur des
vieilles écorces paroît encore préférable.
Quelque efpèce'dé bois qu’on emploie, comme