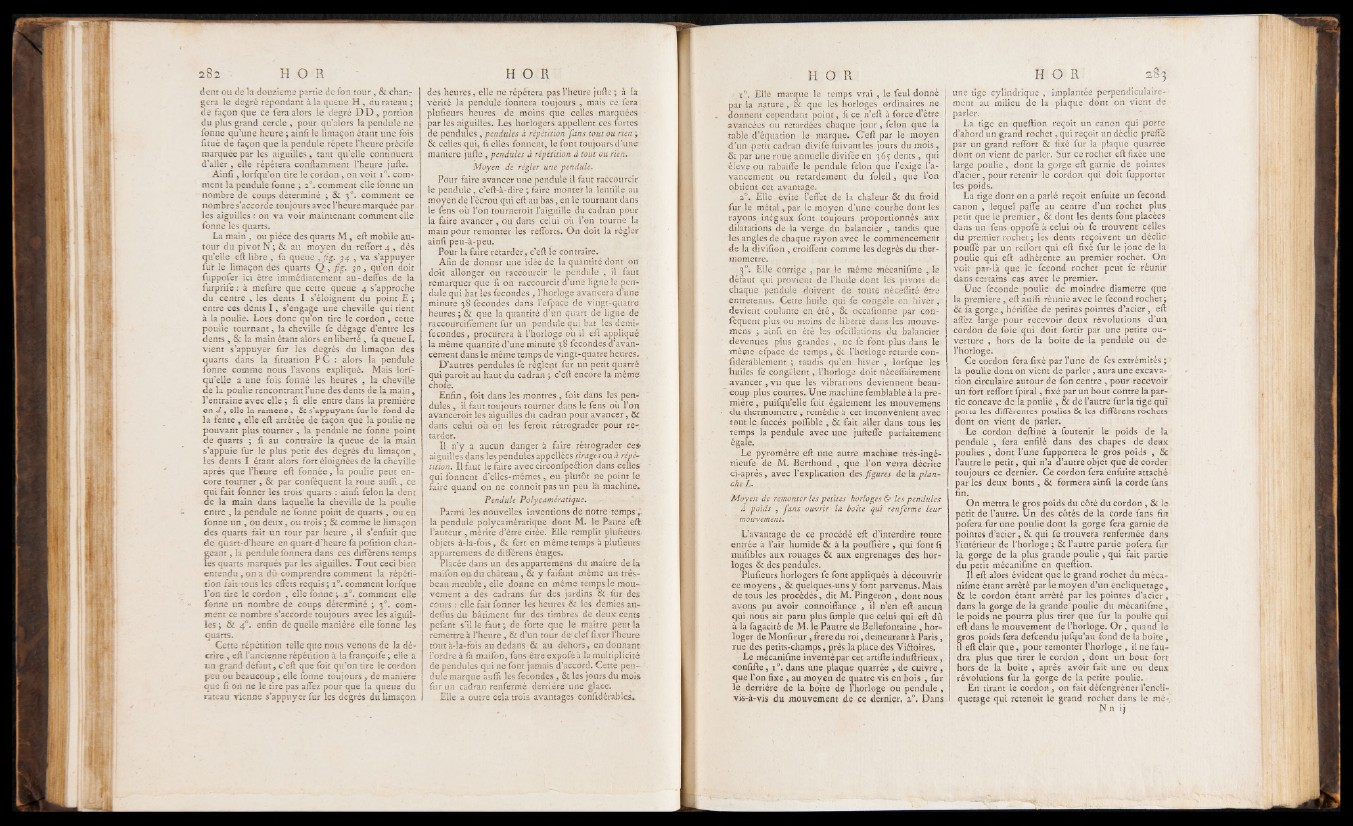
dent ou de la douzième partie de fon tour, & chanr
géra le degré répondant à la queue H , du rateau ;
de façon que ce fera alors le degré D D , portion
du plus grand cercle , pour qu’alors la pendule ne
fon ne qu’une heure ; ainfi le limaçon étant une fois
fitué de façon que la pendule.répété l’heure précife
marquée par les aiguilles , tant qu’elle continuera
d’aller, elle répétera conftamment l’heure jufte.
A in fi, lorsqu’on tire le cordon , on voit i°. comment
la pendule fonne ; 2°. comment elle fonne un
nombre de coups déterminé ; & 30. comment ce
nombre s’accorde toujours avec l’heuremarquée par
les aiguilles : on va voir maintenant comment elle
fonne les quarts.
La main , ou pièce des quarts M , eft mobile autour
du pivot N ; & au moyen du reffort 4 , dès
qu’elle eft libre , fa queue , fig. 34 , va s’appuyer
fur le limaçon des quarts Q , fig. 30 , qu’on doit
fuppofer ici être immédiatement au-deffus de la
furprife : à mefure que cette queue 4 s’approche
du centre , les dents I s’éloignent du point E ;
entre ces dents I , s’engage une cheville qui tient
à la poulie. Lors donc qu’on tire le cordon, cette
poulie tournant, la cheville fe dégage d’entre les
dents , & la main étant alors en liberté , fa queue L
vient s’appuyer fur les degrés du limaçon des.
quarts dans la fituation PG : alors la pendule
fonne comme nous l’avons expliqué. Mais lorf-
qu’elje a une fois fonné les heures , la cheville
de la poulie rencontrant l’une des dents de la main,
l’entraîne avec elle ; fi elle entre dans la première
en d , elle la ramene, & s’appuyant fur le fond de
la fente , elle eft arrêtée de façon que la poulie ne
pouvant plus tourner, la pendule ne fonne point
de quarts ; fi au contraire la queue de la main
s’appuie fur le plus petit des degrés du limaçon,
les dents I étant alors fort éloignées de la cheville
après que l’heure eft fonnée, la poulie peut encore
tourner , & par conféquent la roue aufli , ce
qui fait former les trois' quarts^: ainfi félon la dent
de la main dans laquelle la cheville de la poulie
entre , la pendule ne fonne point de quarts , ou en
fonne un , ou deux, ou trois ; & comme le limaçon
des quarts fait un tour par heure , il s’enfuit que
de quart-d’heure en quart-d’heure fa pofition changeant
, la pendule fonnera dans ces différens temps
les quarts marqués par les aiguilles. Tout ceci bien
entendu , on a dû-comprendre comment la répétition
fait tous les effets requis ; i° . comment lorfque
l’on tire le cordon , elle lonne ;-^Vçomment elle
fonne un nombre de coups déterminé \ 30. comment
ce nombre s’accorde toujours avec les aiguilles
; & 40. enfin de quelle manière elle fonne les
quarts.
Cette répétition telle que nous venons de la décrire
, eft l’ancienne répétition à la françoife ; elle a
un-grand défaut,, c’eft que foit qu’on tire le cordon
peu ou beaucoup ; elle fonne toujours, de manière
que fi on ne le tire pas affez pour que la queue du
rateau vienne s’appuyer fur les degrés du limaçon
des heures, elle ne répétera pas l’heure jufte ; à la
vérité la pendule fonnera toujours , mais ce fera
plufieurs heures de moins que celles marquées
par les aiguilles. Les horlogers appellent ces fortes
de pendules , pendules à répétition fans tout ou rien ;
& celles qui, u elles fonnent, le font toujours d’une'
maniéré jufte , pendules à répétition à tout ou rien.
Moyen de régler une pendule.
Pour faire avancer une pendule il faut raccourcir
le pendule , c’eft-à-dire ; faire monter la lentille au
moyen de l’écrou qui eft au bas, en le tournant dans
le fens ou l’on tourneroit l’aiguille du caaran pour
la faire avancer , ou dans celui où l’on tourne la
main pour remonter les refforts. On doit la régler
ainfi peu-à-peu.
Pour la faire retarder, c’eft le contraire.
Afin de donner une idée de la quantité dont oit
doit allonger ou raccourcir le pendule , il faut
remarquer que fi on raccourcit d’une ligne le pendule
qui bat les fécondés , l’horloge avancera d’une
minute 38 fécondés dans l’efpace de vingt-quatre
heures ; & que la quantité d’un quart de ligne de
raccourciffement fur un pendule qui bat les demi-
fécondés, procurera à- l’horloge où il eft appliqué
la même quantité d’une minute 3.8 fécondés d’avancement
dans le même temps de vingt-quatre heures.
D’autres pendilles-fe règlent fur un petit quarré
qui parok au haut du cadran 3 c’eft encore là même?
choie;
Enfin, foit dans les montres, foit dans les pendules
, il faut toujours tourner dans le fens où l’on
avancerait les aiguilles du cadran pour avancer, &
dans celui où on les feroit rétrograder pour re-;
tarder.
Il n’y a aucun danger à faire rétrograder ce»
aiguilles dans les pendules appellées tirages ou à répétition.
Il faut le faire avec circonfpeôion dans celles
qui fonnent d’elles-mêmes, eu plutôt ne point le
faire quand on ne connoîtpasun peu la machine.
Pendule Polycamératique.
Parmi les nouvelles inventions de notre tempsv
la pendule polycamératique dont M. le Paute eft:
l’auteur , mérite d’être citée. Elle remplit plufieurs
objets à-la-fois, & fert en même temps à plufieurs
appartemens de différens étages-
Placée dans un. des appartemens du maître de la
maifon ou du château , & y faifànt même un très-
beau meuble, elle donne en même temps le mouvement
à des cadrans fur des jardins & fur des
cours : elle fait fonner les heures & les demies au-
deffus du bâtiment fur des timbres de deux cents
pefant s’il le faut; de. forte que le maître peut la
remettre à l’heure, & d’un tour de*clef fixer l’heure
tout à-la-fois au dedans & au dehors, en donnant
l’ordre à fa maifon, fans être expoféà la multiplicité
de pendules qui ne font jamais d’accord. Cette pendule
marque auffi les fécondés, 6c les jours du mois
fur un cadran renfermé derrière une glace.
Elle a outre cela trois avantages ConfidèrablesU.
i°. Elle marque, le temps vrai , le feul donné I
par la nature, & que les horloges ordinaires ne
donnent* cependant point, fi ce n’eft à force d’être
avancées ou retardées chaque jour, félon que la
table d’équation le marque. C’eft par le moyen
d’un petit cadran divifé fuivant les jours du mois ,
& par une roue annuelle divifée en 365 dents, qui
-éjeve pu rabaiffe le pendule félon que l’exige l’a- ■
vancement ou retardement du foleil, que l’on
obtient cet avantage.
20. Elle évite l’effet de la chaleur & du froid
fur le métal, par le moyen d’une courbe dont les
rayons inégaux font toujours proportionnés aux
dilatations de la verge du balancier , tandis que
les angles de chaque rayon avec le commencement
de la divifion, croiffent comme les degrés du thermomètre.
3°. Elle corrige , par le même mécanifme , le
défaut qui provient de l’huile dont lés pivots de
chaque pendule doivent de toute néceffité être
entretenus. Cette huile, qui fe congèle en. hivèr,
devient coulante en été, & oççafionne par conféquent
plus ou moins de liberté dans les mouve-
mens ; ainfi en été les ofcillations du balancier
devenues plus grandes , ne fe font plus dans le
même efpace de temps, .& l’horloge retarde con-
fidérâblement ; tandis qu’en hiver , lorfque les
huiles fe congèlent, l’horloge doit néceffairement
avancer , vu que les vibrations deviennent beaucoup
plus courtes. Une machine femblable à la première
, puifqujelle fuit également les mouvemens
du thermomètre , remédie à cet inconvénient avec
tout le, fuccès polfible , 8c fait aller dans tous les
temps la pendule avec une jufteffe parfaitement
égale.
Le pyromètre eft une autre machine très-ingé-
nieufe de M. Berthoud , que l’on verra décrite
ci-après, avec l’explication des figures de la planche
h.
Moyen de remonter les petites horloges & les pendules
à poids , fans ouvrir la boîte qui renferme leur
mouvement.
L’avantage de ce procédé eft d’interdire toute
entrée à l’air humide & à la pouffière , qui font fi
nuifibles aux rouages 8c aux engrenages des horloges
8c des pendules.
Plufieurs horlogers fe font appliqués à découvrir
ce moyens, & quelques-uns y font parvenus. Mais
de tous les procédés, dit M. Pingeron , dont nous
avons pu avoir connoiffançe , il n’en eft aucun
qui nous ait paru plus fimple que celui qui eft dû
à la fagacité de M. le Pautre de Bellefontaine , horloger
de Monfieur, frere du roi, demeurant à Paris,
rue des petits-champs, près la place des Victoires.
Le mécanifme inventé par cet artifte induftrieux,
confifte , i ° . dans une plaque quarrée , de cuivre ,
que l’on fix e, au moyen de quatre vis en bois , fur
le derrière de la boîte de l’horloge ou pendule,
vis-à-vis du mouvement de ce dernier, z°. Dans
une tige cylindrique , implantée perpendiculairement
au milieu de la plaque dont on vient de
parler.
La tige en queftion reçoit un canon qui porte
d’abord un grand rochet, qui reçoit un déclic preffé
par un grand reffort 8c fixé fur la plaque quarrée
dont on vient de parler. Sur ce rochet eft fixée une
large poulie, dont la gorge eft garnie de pointes
d’acier, pour retenir le cordon qui doit fupporter
les poids.
La tige dont on a parlé reçoit enfuite un fécond
canon , lequel paffe au centre d’un rochet plus
petit que le premier, & dont les dents font placées
dans un fens oppôfé à celui où fe trouvent celles
du premier rochet.; les dents reçoivent un déclic
pouffé par un reffort qui eft fixé fur le jonc de la
poulie qui eft adhérente au premier rochet. On
voit par-là que le fécond rochet peut fe réunir
dans certains cas avec le premier.
Une fécondé poulie de moindre diamètre que
la première , eft auffi réunie avec le fécond rochet ;
& fa gorge, hériffée de petites pointes d’acier, eft
affez large -pour recevoir deux révolutions d’un
cordon de foie qui doit fortir par une petite ouverture
, hors de la boîte de la pendule ou de
l’horloge.
Ce cordon fera fixé par l’une de fes extrémités ; ’
la poulie dont on vient de parler, aura une excavation
circulaire autour de fon centre , pour recevoir
un fort reffort fpiral, fixé par un bout contre la partie
concave de la poulie , & de l’autre fur la tige qui
porte les différentes poulies 8c les différens rochets
dont on vient de parler.
Le cordon deftiné à foutenir le poids de la
pendule , fera enfilé dans des chapes de deux
poulies , dont l’une fupportera le gros poids , 8c
l’autre le petit, qui n’a d’autre objet que de corder
toujours ce dernier. Ce cordon fera enfuite attaché
par les deux bouts , 6c formera ainfi la corde fans
fin.O
n mettra le gros poids du côté du cordon, & le
petit de l’autre. Un des côtés de la corde fans fin
pofera fur une poulie dont la gorge fera garnie de
pointes d’acier, 8c qui fe trouvera renfermée dans
l’intérieur de l’horloge ; & l’autre partie pofera fur
la gorge de la plus grande poulie, qui fait partie
du petit mécanifme en queftion.
Il eft alors évident que le grand rochet du mécanifme
étant arrêté par le moyen d’un encliquetage,
6c le cordon étant arrêté par les pointes d’acier,
dans la gorge de la grande poulie du mécanifme,
le poids ne pourra plus tirer que fur la poulie qui
eft dans le mouvement de l’horloge. O r , quand le
gros poids fera defeendu jufqu’au fond de la b oîte,
il eft clair que, pour remonte'r l’horloge , il ne faudra
plus que tirer le cordon , dont un bout fort
hors de la boîte , après avoir fait une ou deux
révolutions fur la gorge de la petite poulie.
En tirant le cordon, on fait défengréner l’encliquetage
qui retenoit le grand rochet dans le mé»
H n ij