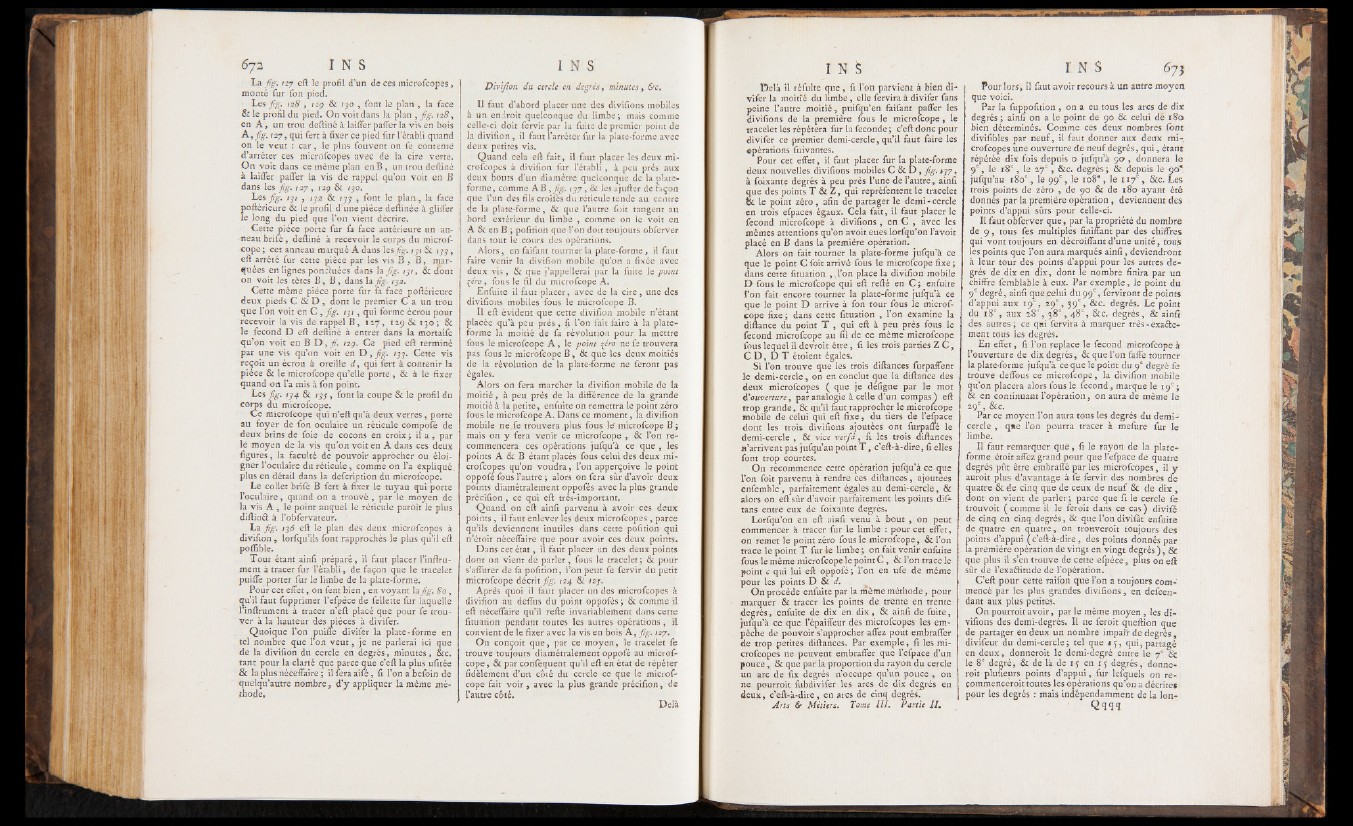
La Jîg. 127 eft le profil d’un de ces microfcopes,
monté fur fon pied.
Les fig. 128 , 129 & 130 , font le plan , la face
& le profil du pied. On voit dans la plan , fig. 128,
en A , un trou deftiné à laifler pafler la vis en bois
A y fig. 127, qui fert à fixer ce pied'fur l’établi quand
on le veut : ca r , le plus fou vent on fe contenté
d’arrêter ces microfcopes avec de la cire verte.
On voit dans ce même plan en B , un trou deftiné
à laifler pafler la vis de rappel qu’on voit en B
dans les fig. 127, 129 & 130.
Les fig. iyi , 132 & 133 , font le plan, la face
poftérieure & le profil d’une pièce deftinée à gliffer
le long du pied que l’on vient décrire.
Cette pièce porte fur fa face antérieure un anneau
brifé, deftiné à recevoir le corps du microfcope;
cet anneau marqué A dans les fig* 131 & 133,
eft arrêté fur cette pièce par les vis B , B , marquées
en lignes ponctuées dans la fig. 131, & dont
on voit les têtes B , B , dans la Jîg. 132.
Cette même pièce porte fur fa face poftérieure
deux pieds C & D , dont le premier C a un trou
que l’on voit en C , Jîg. 131 , qui forme écrou pour
recevoir la vis de rappel B , 12 7, 1 2 9 & 1 3 0 ; &
le fécond D eft deftiné à entrer dans la mortaife
qu’on voit en B D , Ji, 12p. Ce pied eft terminé
par une vis qu’on voit eii D , Jîg. 133. Cette vis
reçoit un écrou à oreille d , qui lèrt à contenir la
pièce & le microfcope qu’elle porte, & à le fixer
quand on l’a mis à fon point.
Les Jîg. 134 & 133, font la coupe & le profil du
corps du microfcope.
Ce microfcope qui n’eft qu’à deux verres, porte
au foyer de fon oculaire un réticule compofé de
deux brins de foie de cocons en croix ; il a , par
le moyen de la vis qu’on voit en A dans ces deux
figures, la faculté de pouvoir approcher ou éloigner
l’oculaire du réticule, comme on l’a expliqué,
plus en détail dans la defcription du microfcope.
Le collet brifé B fert à fixer le tuyau qui porte
l’oculaire, quand on a trouvé, par le moyen de
la vis A , le point auquel le réticule paroît le plus
diftinéf à l’obfervateur.
La Jîg. 136 eft le plan des deux microfcopes à
divifion, lorfqu’ils font rapprochés le plus qu’il eft
polfible.
Tout étant ainfi préparé, il faut placer l’inftru-
ment à tracer fur l’établi, de façon que le tracelet
puifle porter fur le limbe de la plate-forme.
Poiir cet effet, on fent bien, en voyant la fig. 80,
qu’il faut fupprimer l’efpèce de fellette fur laquelle
l’inftrument à tracer n’eft placé que pour fe trouver
à la hauteur des pièces à divifer.
Quoique l’on puifle divifer la plate-forme en
tel nombre que l’on v e u t, je ne parlerai ici que
de la divifion du cercle en degrés, minutes, &e.
tant pour la clarté que parce que c’eft la plus ufitée
& la plus néceflaire ; il fera aifé, fi l’on a befoin de
quelqu’autre nombre, d’y appliquer la même méthode.
Divifion du cercle en degrés, minutes, &c.
Il faut d’abord placer une des divifions mobiles
à un endroit quelconque du limbe; mais comme
celle-ci doit fervir par la fuite de premier point de
la divifion, il faut l’arrêter fur la plate-forme avec
deux petites vis.
Quand cela eft fait, il faut placer les deux microfcopes
à divifion fur l’établi , à peu près aux
deux bouts d’un diamètre quelconque de la plateforme,
comme A B , Jîg. 137, & les ajufter de façon
que l’un des fils croifés du réticule tende au centre
de la plate-forme, & que l’autre foit tangent au
bord extérieur du limbe , comme on le voit en
A & en B ; pofition que l’on doit toujours obferver
dans tout le cours des opérations.
Alors, en faifant tourner la plate-forme, il faut
faire venir la divifion mobile qu’on a fixée avec
deux v is , & que j’appellerai par la fuite le point
zfiro, fous le fil du microfcope A.
Enfuite il faut placer, avec de la cire, une des
divifions mobiles fous le microfcope B.
Il eft évident que cette divifion mobile n’étant
placée qu’à peu près , fi l’on fait faire à la plateforme
la moitié de fa révolution pour la mettre
fous le microfcope A , le point %éro ne fe trouvera
pas fous le microfcope B , & que les deux moitiés
de la révolution de la plate-forme ne feront pas
égales.
Alors on fera marcher la divifion mobile de la
moitié, à peu près de la différence de la grande
moitié à la petite, enfuite on remettra le point zéro
fous le microfcope A. Dans ce moment, la divifion
mobile ne,fe trouvera plué fous le' microfcope B ;
mais on y fera venir ce microfcope , & l’on recommencera
ces opérations jufqu’à ce que , les
points A & B étant placés fous celui des deux microfcopes
qu’on voudra, l’on apperçoive le point
oppofé fous l’autre ; alors on fera sûr d’avoir deux
points diamétralement oppofés avec la plus grande
précifion, ce qui eft très-important.
Quand on eft ainfi parvenu à avoir ces deux
points , il faut enlever les deux microfcopes , parce
qu’ils deviennent inutiles dans cette pofition qui
n’étoit néceflaire que pour avoir ces deux points.
Dans cet état, il faut placer un des deux points
dont on vient de parler, fous le tracelet; & pour
s’aflurer de fa pofition, l’on peut fe fervir du petit
microfcope décrit ƒ£'. 124 & 123.
Après quoi il faut placer un des microfcopes à
divifion au deffus du point oppofés ; & comme il
eft néceflaire qu’il refte invariablement dans cette
fituation pendant toutes les autres opérations , il
convient de le fixer avec la vis en bois A , Jîg. 127.
On conçoit que, par ce moyen, le tracelet fe
trouve toujours diamétralement oppofé au microfcope
, & par conféquent qu’il eft en état de répéter
fidèlement d’un côté du cercle ce que le microfcope
fait v o ir , avec la plus grande précifion, de
l’autre côté.
Delà
Delà il réfulte q ue , fi l’on parvient à bien divifer
la moitié du limbe, elle fervira à divifer fans
peine l’autre moitié, pnifqu’en faifant pafler les
divifions de la première fous le microfcope, le
tracelet les répétera fur la fécondé ; c’eft donc pour
divifer ce premier demi-cercle, qu’il faut faire les
opérations fuivantes.
Pour cet effet, il faut placer fur la plate-forme
deux nouvelles divifions mobiles C & D , Jîg. §37,
à foixante degrés à peu près l’une de l’autre, ainfi
que des points T & Z , qui reprêfentent le tracelet
©c le point zéro, afin de partager le demi-cercle
en trois efpaces égaux. Cela fait, il faut placer le
fécond microfcope à divifions, en C , avec les
mêmes attentions qu’on avoit. eues lorfqu’on l’avoit
placé en B dans la première opération.
Alors on fait tourner la plate-forme jufqu’à ce
que le point C foit arrivé fous le microfcope fixe ;
dans cette fituation , ^l’on place la divifion mobile
D fous le microfcope qui eft refté en C ; enfuite
Ton fait encore tourner la plate-forme jufqu’à ce
gué le point D arrive à fon tour fous le microfcope
fixe ; dans cette fituation , l’on examine la
diftance du point T , qui eft à peu près fous le
fécond microfcope au fil de ce même microfcope
fous lequel il devroit être, fi les trois parties Z C ,
C D , D T étoient égales.
Si l’on trouve que les trois diftances furpaffent
le demi-cercle, on en conclut que la diftance des jjj
deux microfcopes ( que je défigne par le mot
d'ouverture, par analogie à celle d’un compas^ eft
trop grande, & qu’il faut rapprocher le microfcope
mobile de celui qui eft fixe, du tiers de l’efpace
dont les trois divifions ajoutées ont furpaué le
demi-cercle , & vice verfâ y fi les trois diftances
H’arrivent pas jufqu’au point T , c’eft‘ à-dire, fi elles
font trop courtes.
On recommence cette opération jufqu’à ce que
l’on foit parvenu à rendre ces diftances, ajoutées
enfemhle, parfaitement égales au demi-cercle, &
alors on eft sûr d’avoir parfaitement les points di(*
tans entre eux de foixante degrés.
Lorfqu’on en eft ainfi venu à bout , on peut
commencer à tracer fur le limbe : pour cet effet,
on remet le point zéro fous le microfcope, & l’on
trace le point T fur le limbe ; on fait venir enfuite
fous le même microfcope le point C , & l’on trace le
point c qui lui eft oppofé ; l’on en ufe de même
pour les points D & d.
On procède enfuite par la même méthode, pour
marquer & tracer les points de trente en trente
degrés, enfuite de dix en d ix , & ainfi de fuite,
jufqu’à ce que l’épaiffeur des microfcopes les empêche
de pouvoir s’approcher affez pout embrafler
de trop petites diftances. Par exemple, fi les microfcopes
ne peuvent embrafler que l’efpace d’un
pouce, & que par la proportion du rayon du cercle
un are de fix degrés n’occupe qu’un pouce , on
ne pourroit fubdivifer les arcs de dix degrés en
deux, c’eft-à-dire, en arcs de cinq degrés.
Arts & Métiers. Tome III. Partie IL
I Pour lors, il faut avoir recours à un autre moyen
que voici.
Par la fuppofition , on a eu tous les arcs de dix
degrés ; ainfi on a le point de 90 & celui dè 18a
bien déterminés. Comme ces deux nombres font
divifibles par neuf, il faut.donner aux deux microfcopes
une ouverture de neuf degrés, qui, étant
répétée dix fois depuis o jufqu’à 9 0 , donnera le
9e , le 18e , le 27e , &c. degrés; & depuis le 90*
jufqu’au 180e , le 99e , le 1088, le 1 17e , &c. Les
trois points de zéro , de 90 & de 180 ayant été
donnés par la première opération , deviennent des
points d’appui sûrs pour celle-ci.
Il faut obferver que, par la propriété du nombre
de 9 , tous fes multiples finiflant par des chiffres
qui vont toujours en décroiffant d’une unité, tou!s
les points que l’on aura marqués ainfi, deviendront
à leur tour des points d’appui pour les autres degrés
de dix en dix, dont le nombre finira par un
chiffre femblable à eux. Par exemple, le point du
9e degré, ainfi que celui du 99e, ferviront de points
d’appui aux 19e, 29e , 39e, &c. degrés. Le point
du 18e , aux 28% 38e , 48e, &c. degrés, & ainfi
des autres ; ce qui fervira à marquer très - exactement
tous les degrés.
En effet, fi l’on replace le fécond microfcope à
l’ouverture de dix degrés, & que l’on fafle tourner
la plate-forme jufqu’à ce que le point du 9e degré fe
trouve deflbus ce microfcope, la divifion mobile
qu’on placera alors fous le fécond, marque le 19e;
& en continuant l’opération, on aura de même le
29e , &c.
Par ce moyen l’on aura tous les degrés du demi-
cercle , que l’on pourra tracer à mefure fur le
limbe.
Il faut remarquer que, fi le rayon de la plateforme
étoit aflez grand pour que l’efpace de quatre
degrés pût être embraffé par les microfcopes, il y
auroit plus d’avantage à fe fervir des nombres de
quatre & de cinq que de ceux de neuf & de dix ,
dont on vient de parler; parce que fi le cercle fe
trouvoit ( comme il le feroit dans ce cas ) divifé
de cinq en cinq degrés, & que l’on divifât enfuite
de quatre en quatre, on trotiveroit toujours des
points d’appui (c ’eft-à-dire, des points donnés par
la première opération de vingt en vingt degrés ) , &
que plus il s’en trouve de cette efpèce, plus on eft
sûr de l’exaâitude de l’opération.
C ’eft pour cette raîfon que l’on a toujours commencé
par les plus grandes divifions, en defcen-
dant aux plus petites.
On pourroit avoir, par le même moyen, les divifions
des demi-degrés. Il ne feroit queftion que
de partager en deux un nombre impair de degrés,
divifeur du demi-cercle; tel que 13 , qui, partagé
en deux, donneroit le demi-degré entre le 7 e 6c
le 8e degré, & de là de 15 en 15 degrés, donneroit
pluueurs points d’appui, fur lefquels on re-
çpmmencèroit toutes les opérations qu’on a décrites
pour les degrés : mais indépendamment de la Ion-
Q q q q