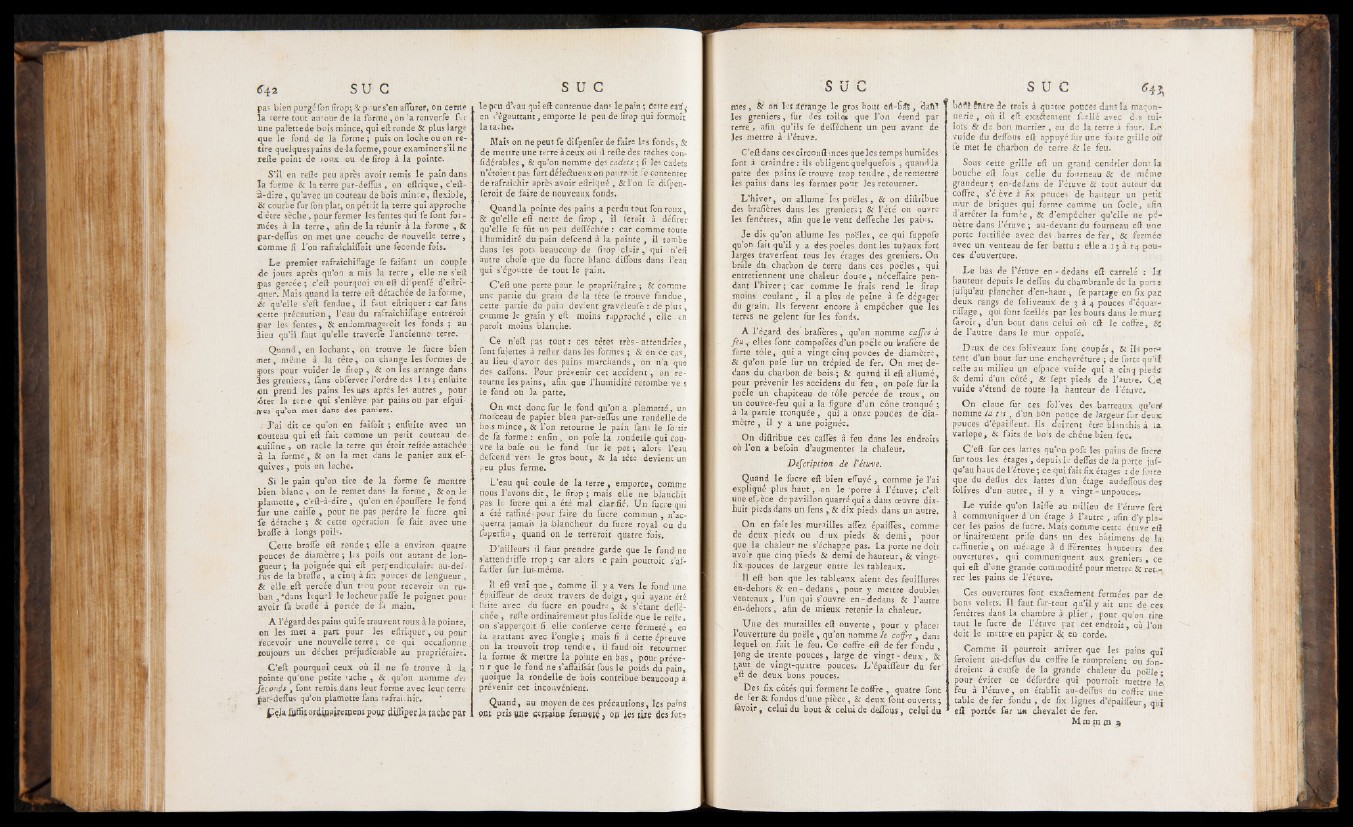
<?42 S U C
pas bien purgé fon firop; Sc pour s’en a la lerre tout aurour de la forme,on f'faurreenr,v oenrf ec erfnuer i quunee plea leftoten dd e dbeo ilsa m fionrcme,e q; upi ueifst roonn dloec &he p oluu so lna rrgee- ;' trierfeie q upeoliqnut esd ep aiînosu xd eloàu f odrem feir,o ppo uàr leax apmoiinneter. s’il ne ,
la Sfo'irlm een &re fliae teprerue apparrè-sd eafvîùosi r, roemn ise fllrei qpuaei,n cd’eainls- i&a- dcioruer b, eq ufu’arv feocn upnl acto, uotne paué tdriet blao itse rmrei nqcuei , afplpexroibclhee, !! m<1 éêetrse às èlcah ete, rproeu ,r faefrinm dere lleas rféeunnteisr qàu lia l ef oformnte f.o, r&- , pcaorm-dmefef ufsî lo'onn m raeftr auînceh ilcfoouitc huen ed efé cnoonudvee lfleo ist.erre ,
:de Ljeo urpsr eamprièesr rqauf’roanîc hai fmlaigse lafe tfearifraen ,c eullne nceo usp’elfel .jq>uase rg. eMrcaéies ;q uca’enfdt lpao tuerrqreu oeif lo dné etfalc hdéfle- pdeen fléa fdo’ermftrei -, :c&e ttqeu ’eplrléec asu’etifot nf e; nld’euaeu, dilu fraauftr aeîcfhlriifqlaugeer : ecnatrr efraonist fpiaeru lqeus ’ifle fnatuets ,q u&’e lelne Jotrmavmearfgee rlo'aitn cleies nnfoen dtes rr; e.au
meQt, umanêdm, ee nà lolac htaêntte, , oonn trcohuavneg e lele s ffuocrrme esb iedne lpeost sg rpeonuire rvs,u ifdaenrs loeb ffeirrovepr, l’&or dorne ldeess a1r rtasn ;g een fduaintes '?,oénte rp rlean dte rlrees pqauiin ss,’ elnelsè uvpes paaprr èpsa lienss oauu trpeasr efpqouui-r
Br es qu’on met dans des paniers.
c.o uJt’aeia ud iqtu ci ee fql uf’oanit ecno mfmaief ouitn ; peentfiut iteco uatveeacu udne - càü ilfain efo ,r moen , r&ac loen lala t emrreet qduain és toleit preafntéieer- aattuaxc heéfe- j quives , puis on loche.
.bieSni lbel apnacin, oqun’ olne rteirme etd dea nlas lafo rfmorem efe, &m oonnt rlee - fjpulra tunnoett ec,a icf’leef l,- àp-doiurre n, eq pua’osn peenr dérpeo ulefl ètfeu clree foqnudi bfero fdféet aàc hleo n;g s& p ocielstt.e opération fe fait avec une
pouCceetst ed eb rdofiafem èetfrle r; olnesd ep; oeillsl e ona t eanuvtiaronnt dqeu laotnre
iguuse udre ; lal ab rpoofifgen, éae cqiuniq efl perpendiculaire au-def- à fîx pouces de longueur,
8bca ne l,l e‘d_a£nlls pleeqrcuéeel dle’u lno cthroeuur ppoauflre rleec epvooigirn eutn p oruu*r, avoir fa brode à portée de fâ main.
onA l els’é gmaredt dàes ppaairnts qpuoiu fre trloeusv eenftl rrioquuxe rà l, ao puo ipnoteu,r" troeucjeovuorisr uunn ed éncohuevte lpler étjeurdreic ;i abclee aquu i proocpcraiéfitoanirnee. j
poÇin’teef tq up’ouunreq upoeit ictee utxa choeù , il& n eq u’foen trnooumvem eà la j des j
nf éacro-dnedfsl u,s f oqnut’ orne mpliasm.daonttse lfeaunrs froarfmraeîc ahvire.c leur terre
’ fei» üiffif otdia wé»ent P°ui diflîperia tache pas:.
S U C
le peu d\-au qui efl contenue dans le pain; Cette eau*,-
en s’égouttant, emporte le peu de firop qui formoit
la tache.
Mais on ne peut fe difpenfer de faire 1rs fonds, &
de mettre une terre à ceux où il refle des taches con-
fîdérables , & qu’on nomme des cadets ; fi les cadets
n’étoient pas fort défedueux ©n pourroit fe contenter
de rafraîchir après avoir eflriqtié , 8c l ’on fe difpen-
feroit de faire de nouveaux fonds.
Quand la pointe des pains a perdu tout fon roux,
& qu’elle efl nette de firop , il feroit à délirer
qu’elle fe fût un peu deflechée : car comme toute
l ’humidité du pain defeend à la pointe , il tombe
dans Jes pots beaucoup de firop cla ir, qui n’efl
autre chofe que du fucre blanc diflous dans l’eau
qui s’égoutte de tout le pain.
C ’efl une perte pour, le propriétaire ; 8c comme
une partie du- grain de la tête fe trouve fondue,
cette partie du pain devient graveleufè : de plus,
comme le grain y eft moins rapproché , elle .cn
paroît moins blanche.
Ce n’eft pas tout : ces têtes très - attendries ,
font fujettes à relier dans les formes ; Sc en ce cas *
au lieu d’avoir des pains marchands, on n’a que
des caffons. Pour prévenir cet accident, on retourne
les pains, afin que l ’humidité retombe ve: s
le fond ou la patte.
On met donc fur le fond qu’on a plamotté, un
morceau de papier bleu par-delfus une rondelle de
bo.s mince, & l’on retourne le pain fans le fortir
de fa forme : enfin, on pofe la rondelle qui couvre
la bafe ou le fond fur le pot ; alors l’eau
defeend vers le gros bout, & la tête devient un
peu plus ferme.
L’eau qui coule de la terre, emporte, comme
nous l’avons dit, le firop ; mais elle ne blanchit
pas le fucre qui a été mal clarifié. Un fucre qui
a été raffiné*pour faire du fucre commun , n’acquerra
jamais la -blancheur du fucre royal ou du
fuperfin, quand on le terreroit quatre fois.
D ’ailleurs il faut prendre garde que le fond ne
s’attend liffe trop ; car alors e pain pourroit s’af-
faifler fur lui-même.
Il efl vrai que , comme il y a vers le fond une
épaiffeur de deux travers de doigt, qui ayant été
faite avec du fucre en poudre , & s’é{ant deflechée
, refle ordinairement plus foiide que le refle,
on s’apperçoît fi elle conlerve cette fermeté , en
la grattant avec l ’ongle ; mais fî à cette épreuve
on la trouvoit trop tendre, il faud' oit retourner
la forme & mettre la pointe en bas, pour préve-
n r que le fond ne s’affaifsât fous le poids du pain,
quoique la rondelle de bois contribue beaucoup à
prévenir cet inconvénient.
Quand, au moyen de ces précautions, les pains
Qflt p r i s s e Setfaiop ferme;?, oo fes tire desfpr-s
S u kj
mes, &? ort les àffà'nge le gros bout ert-bÆ5, Üafi*
les greniers, fur des.toiles que l ’on étend par
terrai afin qu’ils fe delféchent un peu avant de
les mettre à 'l ’étuve.
C’eftdans cescirconfl mces que les temps humides'
font à craindre: ils obligent quelquefois , quand la
patte des pains fe trouve trop tendre , de remettre
les pains dans les formes pour les retourner.
L ’hiver, on allume les poêles , & on diftribue
des brafières dans les greniers; & l’été on ouvre
les fenêtres, afin que le vent deiïèche les pains.
Je dis qu’on allume les poêles, ce qui fuppofe
qu’on fait qu’il y a des poêles dont les tuÿ aux fort
larges traverfent tous les étages des greniers. On
brûle du charbon de terre dans ces poeles, qui
entretiennent une chaleur douce, néceflaire pendant
l’hiver ; car comme le frais rend le firop
moins coulant, il a plus de peine à fe dégager
du grain. Ils fervent encore à empêcher que les
terres ne gelent fur les fonds.
A l ’égard des brafières , qu’on nomme cajjes a
feu. elles font compofées d’un poêle ou brafîère de
forte tôle, qui a vingt cfnq pouces de diamètre,
& qu’on pofe fur un trépied de fer. On met dedans
du charbon de bois-; & quand il eft allumé,
pour prévenir les accidens du feu, on pôle fur la
poêle un chapiteau de tôle percée de trous , ou
un couvre-feu qui a la figure d’un cône tronqué ;
À la partie tronquée, . qui a onze pouces de diamètre
, il y a une poignée.
On diflribue ces çaiïès à feu dans les endroits
où l ’on a befoin d’augmenter la chaleur.
Defcription de Vétuve.
Quand le fucre efl bien effùyé, comme je l’ai
expliqué plus haut, on le "porte à l ’étuve; c’ell
une efpèce de pavillon quarré qui a dans oeuvre dix-
huit pieds dans, un fens , & dix pieds dans un autre.
On en fait les murailles allez épaifles, comme
de deux pieds ou d;ux pieds & demi, pour
que la chaleur ne s’échappe pas. La porte ne doit
avoir que cinq pieds & demi de hauteur, & vingt-
lîx ^pouces de largeur entre les tableaux.
Il eft bon que les tableaux aient des feuillures
en-dehors & en - dedans , pour y mettre doubles
Venteaux, l ’un qui s’ouvre en-dedans & l’autre
en-dehors, afin de mieux retenir la chaleur.
Une des murailles eft ouverte , pour y placer
l’ouverture du poêle , qu’on nomme le coffre , dans
lequel on fait le feu. Ce coffre eft de fer fondu ,
long de trente pouces , large de vingt - deux , &
haut de vingt-quatre pouces.- L ’épailfeur du fer'
eft de deux bons pouces.
Des fîx côtés qui forment le coffre , quatre font
de fer & fondus d’une pièce, & deux font ouverts ;
&Yoir, celui du bout & celui de delfoiw, celui du
S U C 6 4%
DÔfll êfitre de trois à quatre pouces dans la maçonnerie
* où il efl exadement fccllé avec d.s tui-
lots & de bon mortier , ou de la terre à four. Le
Vuide du dclfous eft appuyé fur une foi te grille oi?
fè met le Charbon de terre & le feu.
Sous cette grille eft un grand cendrier dont la
bouche eft fous celle du fourneau & de même
grandeur^ en-dedans de l ’étuve & tout autour du
coffre, s’é ève à fîx pouces de hauteur un petit
mur de briques qui forme comme un focle, afin
d’arrêter la fum?e, & d’empêcher qu’elle ne pénètre
dans l ’étuve ; au-devant du fourneau eft une
porte fortifiée avec des barres de fe r , & fermée
avec un venteau de fer battu : elle a 13 à 14 pouces
d’ouverture.
Le bas de l’étuve en - dedans eft carrelé : I ï
hauteur depuis Je delfus du chambranle de la porte
jufqu’au plancher d’en-haut -y fe partage en fîx pag
deux rangs de foliveaux de 3 à 4 pouces d’équar-
riffage, qui font fcellés par les bouts dans le mur;
lavoir, d’un bout dans celui où eft le coffre, 8C
de l ’autre dans le mur oppofé. -
D:ux de ces foliveaux font coupés , & ils por-»
tent d’un bout fur une enchevrêture ; de forte qu’if
relie au milieu un efpace vuide qui a cinq pieds
& demi d’un côté, & fept pieds de l ’autre.
vuide s’étend de toute la hauteur de l ’étuve.
On cloue fur ces fol.'ves des barreaux qu’ortf
nomme la. t i s } d’un bon pouce de largeur lur deux
pouces d’épaiffeur. Ils doivent être blanchis à la
varlope, & faits de bois de chêne bien fec.
C ’eft fur ces lattes qu’on pofe les pains de fucre
fur tous les étages , depuis le deflus de la porte juf-
qq’au haut de letuve ; ce qui fait fîx étages : de forte
que du deffus des lattes d’un étage audelfous des
folives d’un autre, il y a vingt - unpouces.
Le vuide qu’on laifle au milieu de l ’étuve fert
à communiquer d’un étage à l’autre , afin d ép lacer
les pains de fucre. Mais comme cette étuve eft
or iinairement prife dans un des bâtimens de la
raffinerie, on ménage à d-fferentes hauteurs des
ouvertures, qui communiquent aux greniers, ce
qui eft d’une grande commodité pour mettre & reti-,
rer les pains de l ’étuve.
Ces ouvertures font exa&ement fermées par de
bons volets. Il faut fur-tout qu’il y ait une de ces
fenêtres dans la chambre à plier, pour qu’on tire
tout le fucre de l ’étuve par cet endroit, où l ’on
doit le mettre, en papier 8c en corde.
Comme il pourroit arriver que les pains qui
feroient aù-delfus du coffre fe romproient ou fon-
droient à caule de la grande chaleur du poêle *
pour éviter ce défordre qui pourroit mettre le
feu à l’étuve, on établit au-deiïùs du coffre une
table de fer fondu , de fîx lignes d’èpailfeur, qui
eft portée fur u« chevalet de fer.
Mm ni a i 3