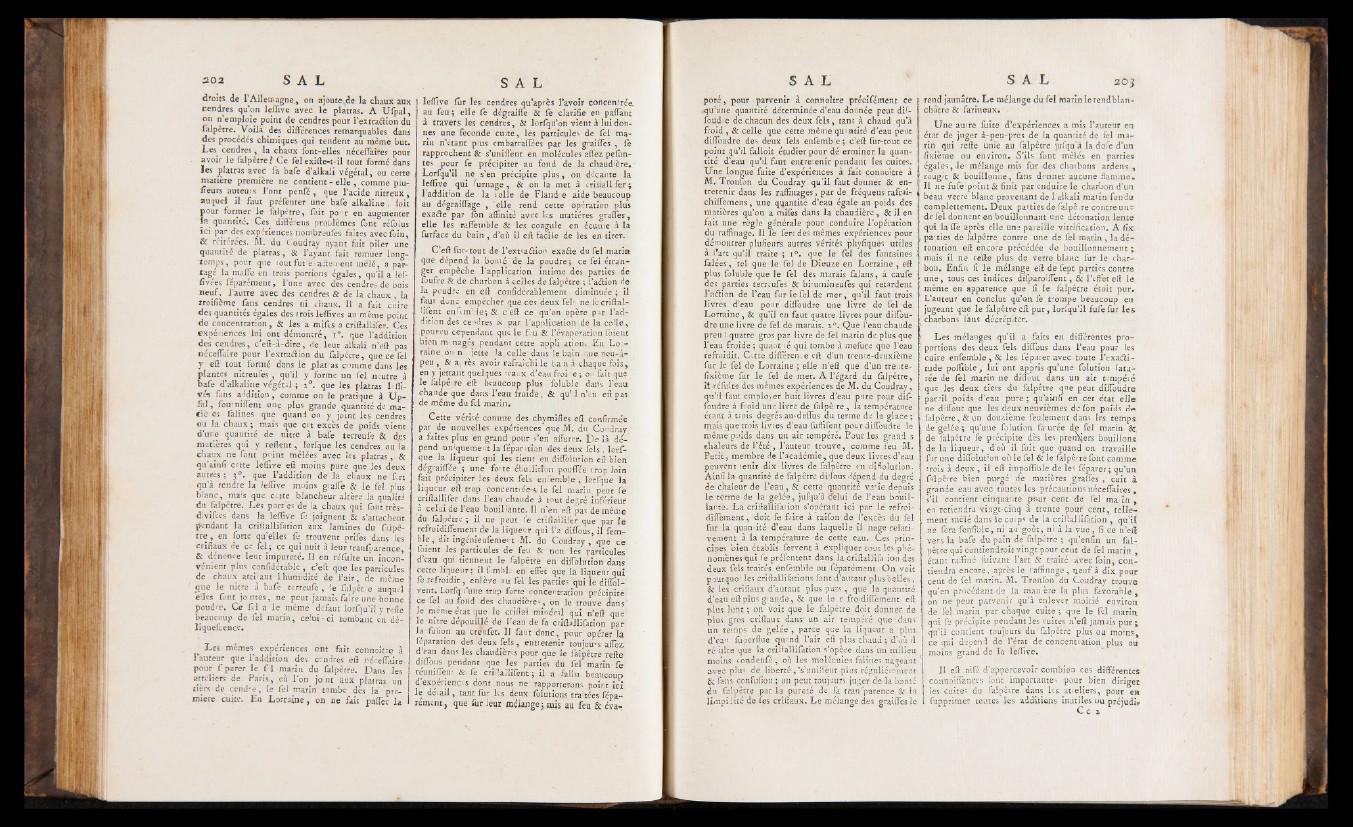
droits de 1 Allemagne, on ajoute,de la chaux aux
cendres quon leffive avec le platras. A Ufpal,
on n’emploie point de cendres pour l’extradion dü
•falpêtre. Voilà des différences remarquables dans
des procédés chimiques qui tendent au même but.
Les^ cendres , la chaux font-elles néceflaires pour
avoir le lalpetre? Ce fel exifte-t-il tout formé dans
les platras avec fa bafe d’alkali végétal, ou cette
matière première ne contient - elle , comme plu-
iîeurs auteurs l'ont penfé, que l’acide nitreux,
auquel il faut préfenter une bafe alkaline, loit
pour former le falpêtre, (oit po’tr en augmenter
■fa quantité. Ces differens problèmes (ont réfolus
ici par des expériences nombreufes faites avec foin,
& reiterees. M. du Coudray ayant fait piler une
quantité de platras, & l’ayant fait remuer longtemps,
pour que tout fut exactement mêlé, a partagé
la maire en trois portions- égales, qu’il a lef-
fivées féparément, l ’une avec des cendres de bois
neuf, l’àutre avec des cendres & de la chaux , la
troifîème fans cendres ni chaux. Il a fait cuire
des quantités égales des trois leffives au même point
de concentration, & les a miles à criftallifer. Ces
expériences lui ont démontré, 1°. que l ’addition
des cendres, c’eft-à-dire, de leur alkali n’eft pas
néceflaire pour l’extraéKon du falpêtre, quecefel
y eff tout formé dans le platras comme dans les
plantes nitreufes , qu’il y forme un lèl neutre à
bafe d’alkaline végétal ; 20. que les platras I ffi-
vas fans addition, comme on le pratique à Up-
ia l, fourniffent une plus grande quantité de ma-
«iè-es falines que quand on y joint les cendres
ou la chaux ; mais que cet excès de poids vient
d’une quantité de nitre à bafe terreufe & d,es
matières qui y re len t, lorfque les cendres ou Ja
chaux ne font point mêlées avec les platras, &
qu’ainlî cette leffive eff moins pure que les deux
autres: 30. que l’addition de là cliaux neriirt
qu’à rendre la ieffive moins gralTe & le fel plus
blanc, mais que cette blancheur altère la qualité
du falpêtre. Les partes de la chaux qui font très-
dîvifées dans la leffive fo joignent & s’attachent
pendant la criftallifation aux lamines du foipê-
tr e , en forte qu’elles fe trouvent prifes dans les
criftaux de ce fel; ce qui nuit à leur tranlparençe,
& dénonce leur impureté. Il en réfulte un inconvénient
plus confidérable , c’eft que les particules!
de chaux attirant 1 humidité de l’air, de même
<jue le nitre à bafe . terreufe, le falpête auquel
elles font jo ntes, ne peut jamais faire une bonne
poudre. Ce f l a le même défaut lorfju’il y rafle
beaucoup de fel marin, celui-ci tombant en dé-
liquefcence.
Les mêmes expériences ont fait connoître à
l’auteur que l ’addition des cendres eft néceflaire
pour fparer le f l marin du falpêtre. Dans les
atteliers de Paris-, où l'on jouit aux platras un
tiers de cendre , le fol marin tombe dès la première
cuite. Eu Lorraine, on ne fait palfer la
leffive for les cendres qu’après l’avoir concentrée,
au feu ; elle fo dégraifle & fe clarifie en paflant
à travers les cendres, & lorlqu’on vient à lui donnes
une fécondé cuite, les particules de fel marin
n’étant plus embarraflees par les grailfes , fo
rapprochent & s’unifient en molécules aflez pelantes
pour fe précipiter au fond de la chaudière.
Lorfqu’il ne s’en précipite plus, on decante la
leffive qui fumage , & 011 là met à criflallfer;
l ’addition de la colle de Flandre aide beaucoup
au dégraiflage , 'elle rend cette opération plus
exa<ffe par fo n affinité avec les matières graffes,
elle les raflemble & les coagule en écume à la
furface du bain, d’ou il eft facile de les en tirer.
C ’ e ft f o r - t o u t d e l ’ e x t r a d io n e x a d e d u f e l m a r in
q u e d é p e n d l a b o n t é —d e l a p o u d r e ; c e f e l é t r a n g
e r em p ê c h e l 'a p p l i c a t io n in t im e d e s p a r t ie s d e
fo u f r e & d e c h a r b o n à c e l l e s d e fa lp ê t r e ; l ’ a d io n d e
l a p o u d r e e n e f t c o n f id é r a b lem e n t d im in u é e ; i l
fa u t d o n c em p ê c h e r q u e c e s d e u x fe l '' n e f e ç r i f t a l -
l i f e n t e n f i n i ' ‘l e ; & c ’e f t c e q u ’o n o p è r e p a r l ’a d d
i t io n d e s c e n d r e s & p a r l ’ a p p l i c a t io n d e l a c o l l e ,
p o u r v u c e p e n d a n t q u e l e fo u & l ’ é v a p o r a t io n fo ie n t
b i e n m é n a g é s p e n d a n t c e t t e a p p l i a t io n . E n L o r r
a in e o n n e je t te l a c o l l e d an s l e b a in q u e p e u - à -
p e u , & a-j rè s a v o i r r a f r a î c h i l e b a n à c h a q u e f o i s ,
e n y je t t a n t q u e lq u e s u’ar.-x d ’ e a u f r o i l e ; on fa i t q u e
l e f a lp ê t r e e ft b e a u c o u p p lu s fo lu b le d an s l ’ e a u
c h a u d e q u e d a n s l ’ e a u f r o i d e , & q u ’ . l n ’e n e f t pas.,
d e m êm e d u f e l m a r in .
C e t t e v é r i t é c o n n u e d e s c h ym i f t e s e ft c o n f irm é e
p a r d e n o u v e l l e s e x p é r ie n c e s q u e M . d u C o u d r a y
a f a i t e s p lu s e n g r a n d p o u r s’ e n a f lu r e r . D e l à d é p
e n d u n iq u em e n t l a f é p a r u i o n d e s d e u x f e l s , l o r f q
u e l a l iq u e u r q u i le s t ie n t e n d ifT o lu t io n e f t b i e n
d é g r a i lf é e ; u n e f o r t e é b u l l i t f o n p o u f fé e t r o p l o in
f a i t p r é c ip i t e r l e s d e u x fe l s e n f em b l e , Ib r fq u e l a
l iq u e u r e f t t ro p c o n c e n t r é e s l e f e l m a r in , p e u t f e
c r i f t a l l i f e r d an s l ’ e a u c h a u d e à to u t d e g r é in f é r i e u r
à c e l u i d e l ’ e a u b o u i l l a n t e . I l n ’e n e ft p a s d e m êm e
d u fa lp e t r e ; i l n e p e u t fe c r i f t a l l i f e r q u e p a r l e
r e f r o id i f lem e n t d e l a l iq u e u r q u i l a d i f lo u s , i l f em -
b l p , d i t in g é n ie u f em e t 't M . d u C o u d r a y , q u e c e
f o ie n t l e s p a r t ic u le s d e f e u & n o n l e s p a r t ic u le s
d ’e a u qu i t ie n n e n t l e fa lp ê t r e en d ifT o lu t io n d a n s
c e t t e l i q u e u r ; i l f cm b l c e n e f fe t q u e l a l iq u e u r q u i
fo r e f r o i d i t , e n lè v e au f e l le s p a r t ie s q u i l e d i f f o l -
v e n t . L o r fq u ’ u n e t ro p fo r t e c o n c e n t r a t io n p r é c ip i t e
c e f e l a u f o n d d e s c h a u d i è r e s , o n l e t r o u v e d a n s
l e m êm e é t a t q u e l e c r i f t a l m in é r a l q u i n ’ e ft q u e
l e n i t r e d é p o u i l l é d e l ’ e a u d e fa c r i f t a l l i f a t io n p a r
l a fü fio n au c r ê u fo t . I l f a u t d o n c , p o u r o p é r e r l a
fé p a r a r io n d e s d e u x f e l s , e n t r e t e n i r to u jo u r s a f l e z
d ’e a u d a n s l e s c h a u d iè r t s p o u r q u e l e fa lp ê t r e r e f t e
d i f lo u s p e n d a n t q u e l e s p a r t ie s d u f o l m a r in f e
r é u n i f ie n t &- fe c r i f f a l l i f e n t ; i l a f a l lu b e a u c o u p
d ’ e x p é r ie n c e s d o n t n o u s n e r a p p o r t e r o n s p o in t i c i
l e d é t a i l , t a n t fu r le s d e u x f o lu t io n s t r a c é e s f é p a -
rément,. que for leur mélange; mis au feu & évapore,
pour parvenir à connoître précifément Cè
.qu’une quantité déterminée d’eau donnée peut dif-
foud: e de chacun des deux fejs, tant à chaud qu’à
froid , & celle que cette même quantité d’eau peut
diffoudre des deux fels enfemble ; c’eft for-tout ce
point qu’il falloit étudier pour déterminer la quantité
d’eau qu’il faut entretenir pendant les cuites.
Une longue fuite d’expériences à fait connoître à
M. Tronfon du Coudray qu’il faut donner & entretenir
dans les raffinages, par de fréquens rafraî-
chiffemens, une quantité d’eau égale au poids des
matières qu’on a mifes dans la chaudière, & il en
fait une règle générale pour conduire l ’opération
du raffinage. Il fe fore des mêmes expériences pour
démontrer plufîeurs autres vérités phyfîques utiles
à l’art qu’il traite ; i° . que le fol des fontaines
falées, tel que le fel de Dieuze en Lorraine, eft
plus foluble que Je fol des marais làlans, à caufe
des parties terrsufes & bitumineùfos qui retardent
l’adion de l ’eau fur'le fel de mer, qu’il faut trois
livres d’eau pour diffoudre une livre de fel de
Lorraine, & qu’il en faut quatre livres pour diffou-
dre une livre de fel de marais. 2G, ;Que l'eau chaude
preni quatre gros par livre de fel marin de plus que
l ’eau froide ; quantiié qui tombe à mefure que l’eau
refroidit. Cette différence eft d’un trente-deuxième
fur le fel de Lorraine ; elle n’eft que d’un treute-
fixième for le fel de mer. A l ’égard du falpêtre,
il réfulte des mêmes expériences de M. du Coudray ,
qu’il‘ faut employer huit livres d’eau pure pour diffoudre
à froid Une livre de Ialpê:re, la température
étant à trois degrés au-deffos du terme de la glace ;
mais que trois livres d’eau foffifent pour diffoudre le
même poids dans, un air tempéré. Pour les grand s
chaleurs de l’été, l ’auteur trouve, comme feu M.
Petit, membre de l’académie, que deux livres d’eau
peuvent tenir dix livres de falpêtre en diflolution.
Ainfi la quantité de falpêtre diflous dépend du degré
de chaleur de l’eau, & cette quantité varie depuis
le terme de la gelée, jufqu’à cfelui de'l’eau bouillante.
La criftallifation s’opérant ici par le refroi-
diffement, doit fe foiré à raifon de l’excès du fel
for la quantité d’eau dans laquelle il nage relativement
à la température de cette eau. Ces principes
bien établis fervent à ëxpliquer tous les phénomènes
qui fe préfentent dans la criftallifarion des
deux fols traités enfemble ou féparément On voit
pourquoi les criftallifation s font d’autant plus belles,
& les criftaux d’autant plus purs , que la quantité
d^au eft plus grande, & que le r frotdiffement eft
plus lent ; on voit que le falpêtre doit donner de
plus gros criftaux dans' un air tempéré quedans
un temps dé gelée , parce que la liqueur a plus,
d’eau foperflue qu?nd l ’air eft plus chaud ; d’où il
résulte que la criftallifation s’opère dans un milieu
moins condenfé, où les molécules falines nageant
avec plus de liberté ,Vuniffent plus régulièrement
& fans confufion ; on peut toujours juger de la bonté
du falpêtre par la pureté de fa transparence & la
limpidité de fes criftaux. Le mélange des graiffesle
rend jaunâtre. Le mélange du fel marin le rend blanchâtre
& farineux.
Une autre fuite d’expériences a mis l’auteur en
état de juger à-peu-près de la quantité de fel marin
qui refte unie au falpêtre jufqu’à la dofe d’un
fîxième ou environ. S ’vils font mêlés en parties
égales, le mélange mis for des charbons ar_dens ,
rougit & bouillonne, fans donner aucune flamme.
Il ne fufe point & finit par enduire le charbon d’un
beau verre blanc provenant de l ’alkali mai in fondu
complettement. Deux parties de falpêire contre une
de.fel donnent en bouillonnant une détonation lente
qui la fle après elle une pareille vitrification. A fix
parties de falpêtre contre une de fel marin , la détonation
eft encore précédée de, bouillonnement ;
mais il ne refte plus de verre blanc fur le charbon.
Enfin fi lé mélange eft de fept parties contre
une, tous ces indices dilparoiffent, & l ’effet eft le
même en apparence que fi le falpêtre étoit pur.
L’auteur en conclut qu’on fe trompe beaucoup en
jugeant que le falpêtre eft pur, lorfqu’il fuie fur le s
charbons fans décrépiter.
Les mélanges quil a faits en differentes proportions
des deux fels diflous dans l’eau pour les
cuire enfemble, & les féparer avec toute l ’cxa&i-
tude poflible, lui ont appris qu’une folution latu-
rée de fol marin 11e diffout. dans un air tempéré
que les deux tiers du falpêtre que peut diffoudre
pareil .poids d’eau pure ; qu’awifi en cet état elle
ne diffout que les deux neuvièmes de fon poids de
falpêtre, & un douzième feulement dans les temps
de gelée ; qu’une folution famrée de fel marin &
de falpêtre fe précipite dès les prerr^ers bouillons
de la liqueur, d’où il fuît que quand on travaille
for une diffolution où le fel & le falpêrrefont comme
trois à deux , il eff impoflible de les féparer; qu’un
falpêtre bien purgé de matières graffes , cuit à
grande eau avec toutes les précautions néceflaires ,
's ’il contient cinquante ptuir cent de fel marin ,
en retiendra vingt-eïnq à trente pour cent, tellement
mêlé dans le corps de la criftallilàtion , qu’il
ne fera fenfîble, ni au goût, ni à la vue, fi ce n’eft
vers la bafe du pain de falpêtre ; qu’enfin un falpêtre
qui contiendroit vingt pour cent de fel marin ,
étant raffiné fuivant l’art & traité avec foin, contiendra
encore, après le raffinage, oeuf à dix pour
cent de fel marin. M. Tronfon du Coudray trouve
qu’en procédant'de la m.an ère la plus favorable ,
• on né peut parvenir qu’à enlever moitié environ
de fel marin par chaque cuite; que le fel marin
qui fe précipite pendant les cuites n’eft jamais pur ;
qu’il contient toujours du falpêtre plus ou moins,
ce qui dépend de l’état de concentration plus ou
moins grand de la leffive.
Il eft aifé d’appercevoir combien ces differentes
connoitTanees font importantes pour bien diriger
les cuites' du falpêtre dans les atteliers, pour en
fupprimer toutes les additions inutiles ou préjudir
C e x