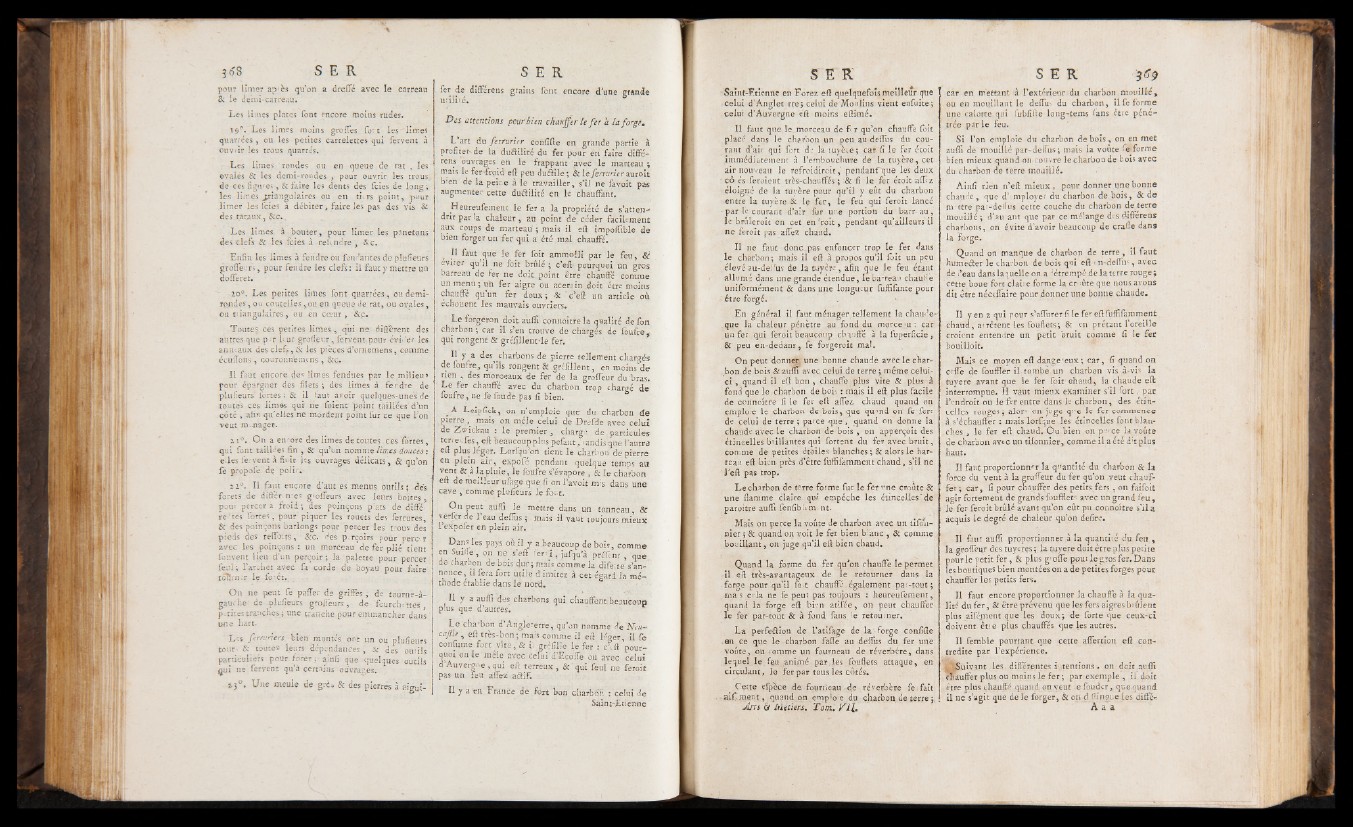
pour limer ap’ cs qu’on a drefle avec le carreau
& ie demi-carreau.
Les limes plates font encore moins rudes.
19°. Les limes moins grofles fort les ' limes
quarrées, ou les petites carrelettes qui fervent à
ouvtir les trous quarrés.
Les limes rondes ou en queue de rat , les-
©valés & les demi-rondes , pour ouvrir les trous;
de ces figures, & faire les dents des fcies de long;
les limes triangulaires ou en tkrs point, pour
limer les fcies à débiter, faire les pas des vis &
des tacaux., &c..
Les limes à bouter , pour limer les panetons
des clefs & les fcies à retendre , &c.
Enfin les limes à fendre ou fendantes de plufîeurs
groflerrs, pour fendre les clefs: il faut y mettre un
dofleret.
2o°. Les petites limes font quarrées, ou demi-
rondes , ou coutelles, ou en queue de rat, ou ovales J
ou triangulaires, ou en coeur , &p.
Toutes ces petites limes , qui ne different des
autres que p r Uur grofleur, fervent pour éyiuer les
ami-aux des clefs., & les pièces d’ornemens, comme
écuffons , couronn*em,ens , &c.
Il faut encore des limes fendues par le.milieu»
pour épargner des filets; dès limes à fendre de
plufîeurs fortes; & il faut avoir quelques-unes de
toutes ces limes qui rie foient j>oint taillées d’un
coté , afin qu’elles ne mordent point fur ce que l ’on
veut m-nager.
2. i° . On a encore des limes de toutes ces 'fortes,
qui font taillées fin , & qu’on nomme limes douces:
eiles fervent à finir- jcs ouyrages délicats , & qu’on
le propofe dç polir.-
z i° . Il faut encore d’aut es menus outils; dés
forets de différentes groffeurs avec leurs boîtes,
pour percer à froid ; des poinçons plats de diffère:
1 tés fortes, pour piquer les rouets des ferrures,
& des poinçons barlongs pour peçcer les trous des
pieds des refiorts, &c. des p-rçôirs pour perc- r
avec les poinçons : un morceau de fer plié tient
fouvent lieu d'on perçoir; la palette pour percer
feul ; l’archet avec fa corde de boyau pour faire
toftin-T le forêt.
. On ne peut fe paffer de griffes ; de tourne-à-
gauche de plufîeurs grofièurs, de fcurcht ttes ,
p-tices tranches-; une tranche pour emmancher dans
une hart.
Les fermiers bien montés ont un ou plufîeurs
tour’ & toutes leurs dépendances, &c des ouriis
particuliers pour forer ; ainfi que quelques outils
oui ne fervent qu’à certains ouvrages.
*3°. Une meule de grès & des pierres à aiguifer
de differens grains font encore d’une grande
utilité«
Des attentions pour bien chauffer le fer a la forge«
L art du ferrurier corifîffe en grande partie à
profiter'de la duâilité du fer pour en faire différents
ouvrages en le frappant avec le marteau;
mais le fer-froid eff peu duûile ; èc le ferrurier auroit
b;en de la peir.e à le travailler, s’il ne favoit pas
augmenter cette duéiïlité en le chauffant.
Heureufement le fer a la propriété de s’attendrir
par la chaleur, au point de céder facilement
aux coups de marteau ; mais il eff impoffible de
bien forger un fer qui a été mal chauffe.
Il faut que le fer foit ammoîli par le feu, 8C
evirer qu il ne foit brûlé ; c’eft pourquoi un gros
barreau de fer ne doit point être chauffe comme
un menu ; un fer aigre ou acerain doit être moins
chauffé qu’un fer doux ; & ' c’eff un article où,
échouent les mauvais ouvriers.
Le forgeron doit auffi- connoître la qualité de fort
charbon; car il s’en trouve de chargés de foufre,•
qui rongent & gré/îllent-le fer.
Il y a des charbons de pierre tellement chargés
de foufre, qu’ils rongent & grc fil lent, en moins de
rien , des morceaux de fer de la grofleur du bras.
Le fer chauffe avec du charbon trop chargé de
foufre, ne fe foude pas fi bien.
. A Leipfick, on n’emploie que du charbon de
pierre , mais on mêlecelui de Drefde avec celui
de Zwickau : le premier, chargé de .particules
terreefès, eff beaucoup plus pefant, tandis que J’autre
eff plus léger. Lorfqu’on tient le charbon de pierre
en plein air, expofé pendant quelque temps au
vent & à la pluie , le foufre s’évapore , & le charbon
eff de meilleur ufage que fi on l’avoit mis dans une
cave, comme plufîeurs le font.
On peut auffi le mettre dans un tonneau, &
verfer de 1 eau deflus ; mais il vaut toujours mieux
1 expofer en plein air*
Dans les pays où il y a beaucoup de bois, comme
en Suilïe , on ne_ s’eft fer i , jufiqu’à préfent , que
de charbon de bois dur; mais comme la dife te s’an-
nonce, il fera fort utile d imiter à cet égard la méthode
établie dans le nord.
Il y a auffi des charbons qui, chauffent, beaucoup
plus que d’autres^
Le cha-bon d’Angleterre, qu’on nomme de Neu-
caflle , eff très-bon; mais comme il eff léger, il fe
confume.fort vite, & i; gréfilie lé fer': c-.ft’pour-
quoi on le meie avec Celui d’Ecofle ou avec celui
d’Auvergne, qui eff terreux, & 'qui feul ne feroit
pas un feu àffez aêfif.
Il y a en France de fort bon charbon ; celui de
Sain t-£ tienne
S a ïn t - F t ie n n e e n F o r e z e f f q u e lq u e fo is m e i l l e u r q u e
c e l u i d ’A n g l e t r r e ; c e lu i d e M o u lin s v i e n t e n fu i t e ;
c e lu i d ’A u v e r g n e é ft m o in s e f f im é .
I l f a u t q u e l e m o r c e a u d e fu r q u ’ o n c h a u f fe ( o i t
p l a c é d an s l e c h a r b o n u n p e u a u d e f lu s d u c o u r
a n t d ’ a i r q u i fo r t de l a t u y è i e ; c a r fi l e f e r é t o i t
im m é d ia t em e n t à l ’ em b o u c h u r e d e l a t u y è r e , c e t
a i r n o u v e a u l e r e f r o i d i r c i t ,' p e n d a n f q u e l e s d e u x
cô es f e r o ie n t t r è s - c h a u f fe s ; & fi l e f e r é t o i t a (Fez
é lo ig n é d e l a tu y è r e p o u r q u ’ i l y e u t d u c h a r b o n
e n t r e l a tu y è r e & l e f e r , l e f e u q u i f e r o i t l a n c é
p a r lé c o u r a n t d ’ a i r fu r ur.e p o r t io n d u b a r r a u ,
l e b r û l e r o i t e n c e t e n ' r o i t , p e n d a n t q u ’ a i ll e u r s i l
n e f e r o i t pas a f le z c h a u d .
I l n e f a u t d o n c „ p a s e n f o n c e r t r o p l e f e r d ans
l e c h a r b o n ; m a is i l e f f à p ro p o s q u ’i l f o i t u n p eu
é le v é ? .u -de !fu s d e l a t u y è r e , a f in q u e l e f e u é t a n t
a l lu m é d an s u n e g r a n d e é t e n d u e , l e b a - r e a u c h a u f f e
u n i f o rm ém e n t & d an s u n e lo n g u e u r fu f f ifa n te p o u r
ê t r e f o r g é . - . . v -
E n g é n é r a l i l fa u t m é n a g e r t e l l e m e n t l a c h a u d e» '
q u e l a c h a le u r p é n ç t r e au f o n d d u m o r c e m ; c a r
u n f e r q u i fe r o i t b e a u c o u p c h a u f fé à l a fu p e r n e ie ,
& p e u e n - r d e d a n s , fe f o r g e r o i t m a l.
O n p e u t donner^ u n e b o n n e c h a u d e a v e c l e c h a r b
o n d e b o is & a u f f i a v e c c e lu i d e te r r e ; m êm e c e lu i -
c i , q u a n d i l e f f b o n , c h a u f fe p lu s v i t e 8c p lu s à
fo n d q u e l e « ch a rb o n d e b o is : m a is i l e f f p lu s f a c i l e
d e c o r in o î t r é fi l e f e r eff: a f le z c h a u d q u a n d o n
em p lo ie l e c h a rb o n d e b o i s , q u e q u m d o n f e fe r r
d e c e lu i d e te r r e ; p a r c e q u e , q u a n d o n d o .h n e l a
c h a u d e a v e c l e c h a r b o n d e b o is , o n a p p e r ç o i t d e s
é t in c e l l e s b r i l l a n t e s q u i fo r t e n t d u f e r a v e c b r u i t ,
c om m e d e p e t i t e s é t o i le s b l a n c h e s ; & a lo r s l e b a r r
e a u e f f b i e n p r è s d’ ê t r e fu f f ifam m e n t c h a u d , s’ i l n e
J’ e ft p a s t r o p .
L e c h a r b o n d e t e r r e fo rm e fu r l e f e r m e c r o û t e &
u n e f lam m e c l a i r e q u i em p ê c h e le s é t in c e l l e s ‘ d e
p a r o î t r e a u ff i fe n f îb iem . n t .
M a is o n p e r c e l a v o û t e d e c h a r b o n a v e c u n l i f o n -
n i e r ; & q u a n d o n v o i t l e f e r b i e n b ’a n c , & c om m e , ,
b o u i l l a n t , o n ju g e q u ’ i l e f f b i e n c h a u d .
Q u a n d l a fo rm e d u f e r q u ’ o n c h a u f fe l e p e rm e t
i l e f f t r è s - a v a n t a g e u x d e l e r e to u r n e r d an s l a
fo r g e p o u r qu ’ i l fo i t c h a u f f é ; é g a le m e n t p a r - t o u t ;
m a s c î’ l a n e fe p e u t p a s to u jo u r s : h e u r e u f e m e n t ,
q u an d l a fo r g e e f f b L n a t i f é e , o n p e u t c h a u f f e r 1
l e f e r p a r t o u t & à f o n d fa n s !e r e to u r n e r ,
L a p e r f e d i o n d e l ’ a t i f a g e d e l a ' fo r g e c o n f if f e
.o n c e q u e l e c h a rb o n fa f f è a u d e f lu s d u f e r u n e
v o û t e , o u c om m e u n fo u rn e a u d e r é v e r b è r e , d ans
l e q u e l l e fe u a n im é p a r le s fo u f le t s a t t a q u e , e n
c i r c u l a n t , l e f e r p a r to u s le s c ô t é s .
^ C e t t e e fp è c e d e fo u n ie a u d e r é v e r b è r e fe fa i t
a i C m ô n t , , q u a n d ;o n em p lo ;e .d u c h a r b o n d e .terre
Arts 6? Métiers, Tom, Kll*
car en mettant à l’extérieur du charbon mouillé %
ou en mouillant le deflîiv du charbon, il fe forme
une calotte qui fubfîffe long-tems (ans être pénétrée
par le feu.
Si l’on emploie du charbon de bois, on en met
auffi de mouillé par-deflus; mais la voûte fe; forme
bien mieux quand on couvre le charbon de bois avec
du. charbon de terre mouillé.
Ainfi rien n’eft mieux, pour donner une bonne
chaude, que d' mployer du charbon de bois, & de
mettre par-deilus cette couche du charbon de terre
mouillé; d’au ant que par ce mélange des differens
charbons, on évite d’avoir beaucoup de crafle dans
la forge.
Quand on manque de charbon de terre, il faut
. humeéter le charbon de bois qui eff < n-deflu*, avec
de deau dans laquelle on a -étrempé de la terre rouge ;
cette boue fort claire forme la cr ûte que nous avons
dit être néccffaire pour donner une bonne chaude.
Il y en a qui pour s’affurer fi le fer eff fuffifamment
chaud, arrêtent les fouflets; & en prêtant l’oreille
croient entendre un petit bruit comme fi le fer
bouilloit.
Mais ce moyen eff dangereux; car, fi quand on
ceffe de fouffler il tombe un charbon vis à-vis la
tuyere avant que le fer foit'chaud, la chaude eft
interrompue. Il vaut mieux examiner s’i l fort, par
l’endroit ou le fer entre dans le charbon, des étincelles
rouges ; alors on juge que le fer commence
à s’échauffer : mais lorfque . les étincelles font blanches
, le fer eft chaud. Ou bien on pe>ce la voûte
de charbon avec un tifonnier,, comme il a été dit plus
haut.
Il faut proportionner la quantité du charbon & la
force du vent à la groffeur du fer qu’on veut chaufi-
fer;.car, fî pour chauffer des petits.fers , on faifoit
agir fortement de grands'foufflets avec un grand feu ,
le fer feroit brûlé avant qu’on eût pu connoître s’ila
acquis le degré de chaleur qu’on defire.
Il faut auffi proportionner à la quantité du feu ,
la grofleur des tuyeres; la tuyere doit être plus petite
pour le petit fer, & plus g' ofîe poui le gros fer. Dans
les boutiques bien montées on a de petites forges pour
chauffer les petits fers.
Il faut encore proportionner la chauffe à la qualité
du fer, & être prévenu que les fers aigresh lûlent
plus aifément que les doux; de forte que ceux-ci
doivent ètie plus chauffes que les autres.
Il femble pourtant que cette affertion eff contredite
par l’expérience.
^Suivant les • différentes intentions . on doit auffi
chauffer plus pu moins le fer ; par exemple , il doit
être plus chauffé quand, on veut e fouder, que.quand
il né s’agit que de le forger, & on .d flingue les diffe-:
À a a