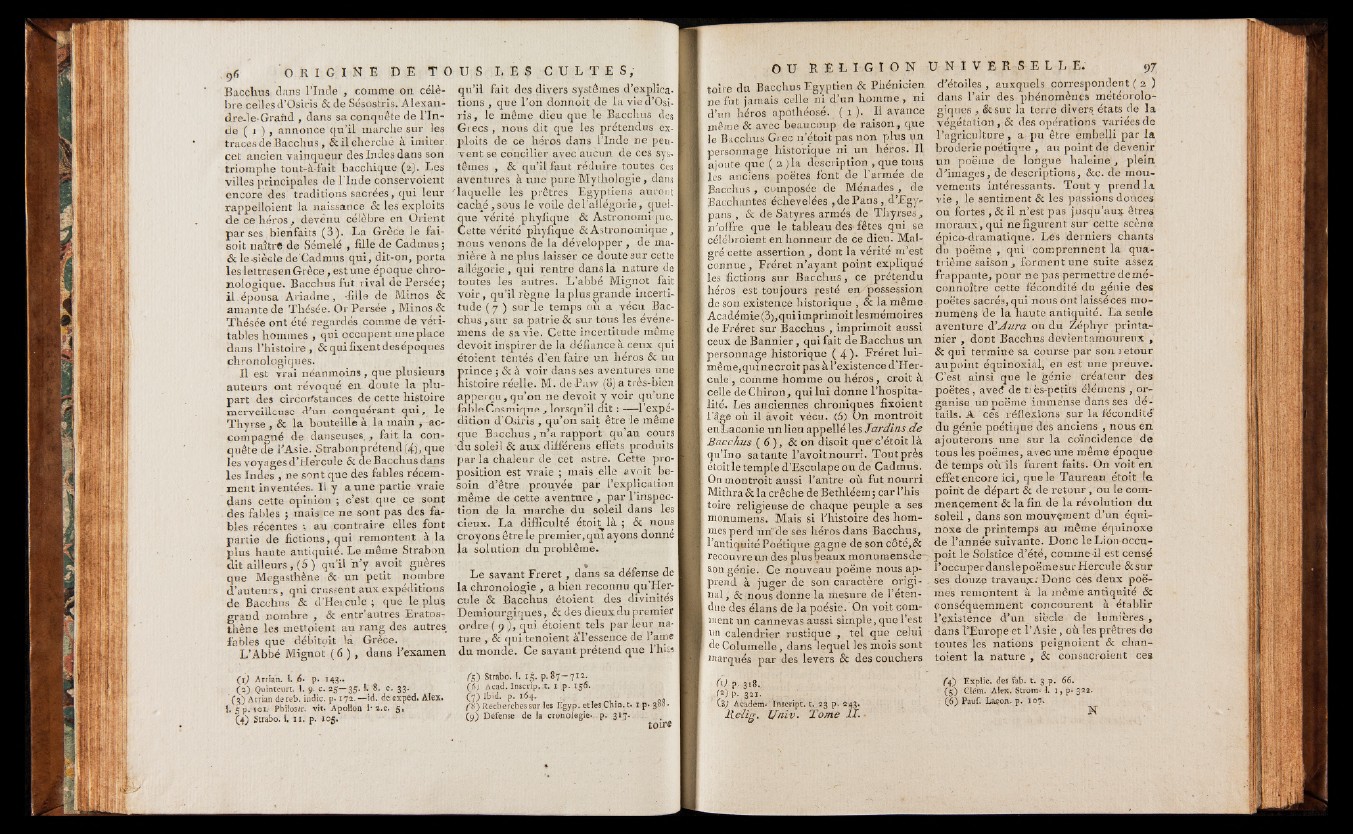
Bacchus clans l’Inde , comme on célèbre
ceilesd’Osiris 6c de Sesostris. Alexan-
dre-le-Graiid , dans sa conquête de l ’Inde
( i ) , annonce qu’il marche sur les
traces de Bacclius, & il cherché à imiter
cet ancien vainqueur des Indes dans son
triomphe tout-à fait bacchique (2). Les
villes principales de l lnde conservoient
encore des traditions sacrées, qui leur
rappelloient la naissance 6c les exploits
de ce héros, devenu célèbre en Orient
par ses bienfaits (3). La Grèce le fai-
soit naître de Sémelé , fille de Cadmus ;
& le-siècle de Cadmus qui, dit-on, porta
les lettr.esen Grèce, est une époque chronologique.
Bacchus fut rival de Persée;
il épousa Ariadne , -fille de Minos &
amante de Thésée. Or Persée , Minos &
Thésée ont été regardés comme de véritables
hommes , qui occupent une place
dans l ’histoire, & qui fixent des époques
chronologiques.
Il est vrai néanmoins , que plusieurs
auteurs ont révoqué en doute la plupart
des circonstances de cette histoire
merveilleuse d’un conquérant qui, le
Thyrse , & la bouteille à la main , accompagné
de danseuses. , fait la conquête
de l’Asie. Strabonprétend (4), que
les voyages dTIercule 6c de Bacchus dans
les Indes , ne sont que des fables récemment
inventées. Il y a une partie vraie
dans cette opinion ; c’est que ce sont
des fables ; mais; ce ne sont pas des fables
récentes -, au contraire elles font
partie de fictions, qui remontent à la
plus haute antiquité. Le même Strabon
dit ailleurs, (5 ) qu’il n’y avoit guères
que Megasthène & un petit nombre
d’auteurs, qui crus.-ent aux expéditions
de Bacchus 6c d Hercule ; que le plus
grand nombre , 6c entr’autres Eratos-
thène les mettoient au rang des autres,
fables que débitoit là Grèce.
L ’Abbé Mignot ( 6 ) , dans l’examen
(\) Arrian. I. .6* p. I 43**
(a ) Quintcurt. I. 9- c. 25— 35. 8. c. 33.
(3 ) Arrian de reb. indic. p. 172.— id. de exped. Alex. 1. 5 p. ïo l Philosfr. vit* Apollon 1- 2.c. 5,
(4) Strabo. L 11. p. 105.
qu’il fait des divers systèmes d’explica-
tions , que l ’on donnoit de la vied’Osi-
ris, le même dieu que le Bacchus des
Grecs , nous dit que les prétendus exploits
de ce héros dans l’Inde ne peuvent
se concilier avec aucun de ces systèmes
, 6c qu’il faut réduire toutes ces
aventures à une pure Mythologie, dans
laquelle les prêtres Egyptiens auront
caché,sous le voile del’allégorie, quelque
vérité phyfique 6c Astronomique.
Cette vérité phyfique ôe Astronomique,
nous venons de la développer , de manière
à ne plus laissér ce doute sur cette
allégorie, qui rentre dans la nature de
toutes les autres. L ’abbé Mignot fait
voir, qu’il règne la plus grande incertitude
(7 ) sur le temps ou a vécu Bac-
chuSjSur sa patrie 6c sur tous les événe-
mens de sa vie. Cette incertitude même
devoit inspirer de la défiance à ceux qui
étoient tentés d’en faire un héros 6c un
prince ; ôc à voir dans ses aventures une
histoire réelle. M. de-Paw (8) a très-bien
apperçu, qu’on ne devoit y voir qu’une
fable Cosmique , lorsqu’il dit : --- l ’expedition
d'Osiris , qu’on sait être le même
que Bacchus , n’a rapport qu’au cours
du soleil 6c aux différens effets produits
par la chaleur de cet astre. Cette proposition
est vraie ; mais elle avoit besoin
d’être prouvée par l’explication
même de cette aventure , par l ’inspection
de la marche du soleil dans les
deux. La difficulté étoit là ; 6c nous
croyons être le premier, qui ayons donne
la solution du problème.
Le savant Freret , dans sa défense de
la chronologie , a bien reconnu qu’Hercule
6c Bacchus étoient des divinités
Demiourgiques, 6c des dieux du premier
ordre ( 9 ), qui étoient tels par leur nature
, & qui tenoient âTessence de l’ame
du monde. Ce savant prétend que l’hits
(g) Strabo. I. 15. p. 8 7 -7 12 .
(6) Acad. Inscrip. t. 1 ,p. 156.
(7 ) Ibid. p. 164..
fS ) Réch e relues sur les Egyp. et les Chia. t . 1 p* 380.
(9) Défense de la cronolegie. p. 317*
toire
toire du Bacclius Egyptien & Phénicien d'étoiles , auxquels correspondent ( 2 )
ne fut jamais celle ni d’un homme , ni dans l ’air des phénomènes météorolo-
d’un héros apôthéosé. ( 1 ). Il avance giques , &sur la terre divers états de la
même & avec beaucoup de raison, que végétation, ôc des opérations variées de
le Bacchus Grec n etoit pas non plus un l ’agriculture , a pu être embelli par la
personnage historique ni un héros. Il broderie poétique , au point de devenir
ajoute que ( 2) la description , que tous un poëine de longue haleine , plein,
les anciens, poëtes font de l’armée de d'images, de descriptions, &c. de mou-
Bacchus , composée de Ménades , de vements intéressants. Tout j prend la
Bacchantes échevelées , de Pans, d'Fgy- vie , le sentiment ôc les passions douces
pans , <Sc de Satyres armés de Tiiyrses, ou fortes , de il n'est pas j usqu aux êtres
n'offre que le tableau des-fêtes qui se moraux, qui ne figurent sur cette scène
célcbroient en honneur de ce dieu. Mal- epico-dramatique. Lés derniers chants
gré cette assertion , dont la vérité m’est du poëtne , qui comprennent^ la qua-
connue , Fréret n'ayant point explique ttieme saison , forment une suite àsse^z
les fictions sur Bacclius, ce prétendu frappante, pour ne pas permettre demé-
héros est toujours resté eivpossession connoître cette fécondité clu génie des
de son existence historique , Ôc la même- poëtes sacrés,qui nous ontlaisseces mo-
Académie(3),quiimprimoitlesmémoires numens de la haute antiquité. La seule
de Fréret sur Bacchus , imprimoit aussi aventure d Aura ou du Zéphyr printa-
ceux de Bannier , qui fait de Bacchus un nier , dont Bacchus devientamoureux ,
personnage historique ( 4 )• Fréret lui- ôc qui termine sa course par son retour
même,quine croit pas à l'existence d’Her- au point équinoxial, en est une preuve,
cule , comme homme ou héros , croit à C est ainsi que le genie créateur des
celle de Clairon, qui lui donne l'hospita- poëtes., aved de tres-petits elemens , or-
lité. Les anciennes chroniques fixoient ganise unpoëmc immense dans ses dé-
l ’âge où il avoit vécu. (5) On montroit tails. A ces -reflexions sur la fécondité
en Laconie unlieuappelléles Jardins.de du genie poétique des anciens^, nous en
Bacchus ( 6 ), ôc on disoit que'c'étoit là ajouterons une sur la coïncidence de
qu’Ino satante l ’avoitnourri. Toutprès tous les poëmes, avec une meme époque
étûitle temple d’Esculape ou de Cadmus. de temps ou ils furent faits. On voit en.
On montroit aussi l’antre où fut nourri effet encore ici, que le Taureau étoit le.
Mithra ôc la crèche de Bethléem; car l'his point de départ & de retour , ou le cora-
toire religieuse de chaque peuple a ses mencement & la fin de la révolution du
monumens. Mais si l'histoire des hom- soleil, dans son mouvement d un equi-
mes perd un"de ses héros dans Bacchus, noxe de printemps au même equinoxe
l’antiquité Poétique gagne de son côté,& de l'année suivante. Donc le Lion occu-
recouvreun des plus beaux monu mens de~: poit le Solstice d été, comineTl est censé
son génie. Ce nouveau poëine nous ap- l ’occuperdanslepoëmesurHercule &sur
prend à juger de son caractère origi- - ses douze travaux; Donc ces deux poë-
nal, «Sc nous donne la mesure de l’éten- mes remontent à la même antiquité &
due des élans de la poésie. On voit com- conséquemment concourent à établir
ment ùn cannevas aussi simple, que l'est 1 existence d un ^siecle de lumières,
un calendrier rustique , tel que celui dans 1 Europe et 1 Asie, ou les prêti es de
de Coluinelle, dans lequel les mois sont toutes les nations peignoient ôc clian-
marqués par des levers ôc des couchers toient la nature , ôc consacroient ces
(ï) P. 318. ^4) Explic. des fab. t. 3 p. 66.
(2) P- 321. ' (5) Clém. Aiex. Strom* J. j , pi 322.
Gp Acadétn» Inscript, t. 23 p» 243. i ■ ’* ^au^‘ ^,aeo^1, P* 10^ , T
lte/igr. Ifniv. Tome ÏI* ■ ^