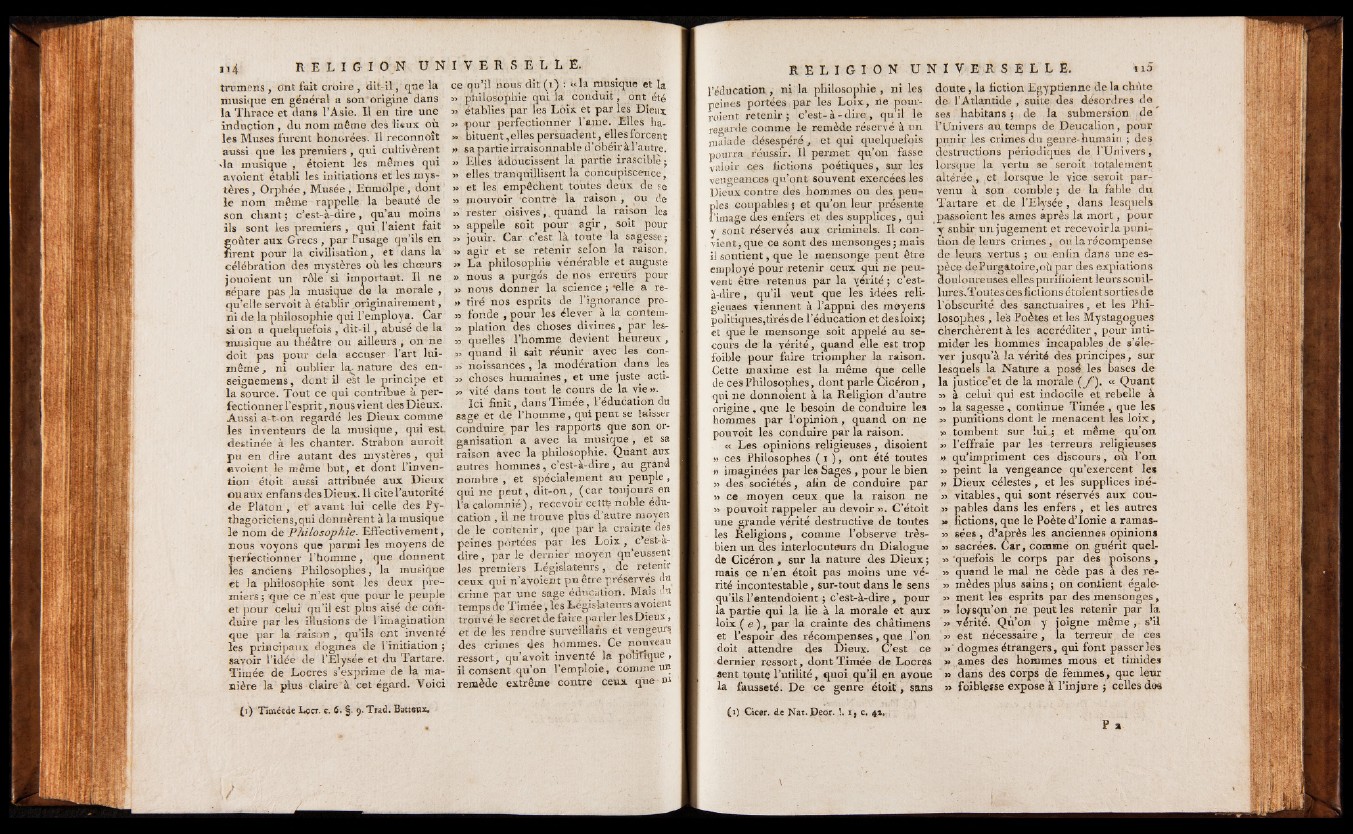
tramens , Ont fait croire , dit-il, que la
musique en général a son origine dans
la Thrace et dans l’Asie. Il en tire une
induction, du nom même des lieux où
les Muses furent honorées. Il reconnoït
aussi que les premiers, qui cultivèrent
-la musique , étoient les mêmes qui
avoient établi les initiations et les mystères
, Orphée, Musée, Ennidlpe, dont
le nom même rappelle la beauté de
son chant; c’est-à-dire, qu’au moins
ils sont les premiers , qui l’aient fait
coûter aux Grecs , par l’usage qu’ils en
firent pour la civilisation, et dans la
célébration des mystères où les choeurs
jouoient un rôle si important. Il ne
sépare pas la musique de la morale ,
qu’elle servoit à établir originairement,
ni de la philosophie qui l’employa. Car
ri on a quelquefois , dit-il, abusé de la
musique au théâtre ou ailleurs , on ne
doit pas pour cela accuser l'art lui-
même, ni oublier la^ nature des en-
seigaemeHS, dont il est le principe et
la source. Tout ce qui contribue à perfectionner
l’esprit , nous vient des Dieux.
Aussi a-t-on regardé les Dieux comme
les inventeurs de la musique, qui est.
destinée à les chanter. Strabon auroit
pu en dire autant des mystères, qui
«voient le même but, et dont l’invention
étoit aussi attribuée aux Dieux
ouaux enfans desDieux. Il cite l’autorité
de Platon , et avant lui celle des Pythagoriciens,
qui donnèrent à la musique
le nom de Philosophie. Effectivement,
nous voyons que parmi les moyens de
perfectionner l ’homme, que donnent
les anciens Philosophes, la musique
et la philosophie sont les deux premiers
; que ce n’est que pour le peuple
et pour celui qu’il est plus aisé de conduire
par les illusions de l’imagination
que par la raison , qu’ils ont inventé
les principaux dogmes de l’initiation ;
savoir l’idée de l’Elysée et du Tartare.
Timée de Loeres s’exprime de la manière
la plus fclaire à cet égard. Voici
f i ) Timéèée Lecr. c. 6. §. 9. Traé. Batteux,
ce qu’il nous dit (1) : «la musique et la
» philosophie qui la conduit, ont été
» établies par les Lois et par les Dieux
» pour perfectionner l’ame. Elles ha-
» bituent,elles persuadent, elles forcent
» sa partie irraisonnable d’obéir à l’autre.
» Elles adoucissent la partie irascible ;
3» elles tranquillisent la concupiscence,
» et les empêchent toutes deux de se
si mouvoir -contré la raison, ou de
33 rester oisives,. quand la raison les
33 appelle soit pour agir, soit pour
33 jouir. Car c’est là toute la sagesse;
33 agir et se retenir selon la raison.
33 La philosophie vénérable et auguste
» nous a purgés de nos erreurs pour
33 nous donner la science ; "elle a re-
» tiré nos esprits de l’ignorance pro-
33 fonde , pour les élever à la contem-
3» plation des choses divines, par les-
33 quelles l ’homme devient heureux,
33 quand il sait réunir avec les con-
33 noissances, la modération dans les
33 choses humaines, et une juste acti-
33 vité dans tout le cours de la vie ».
Ici finit, dans Timée, l ’éducation du
sage et dé l’homme, qui peut se laisser
conduire par les rapports que son organisation
a avec la musique , et sa
raison avec la philosophie. Quant aux
autres hommes, c’est-à-dire, au grand
nombre , et spécialement au peuple ,
qui ne peut, dit-on, ( car toujours en
l’a calomnié ), recevoir cette noble éducation
, il ne trouve plus d’autre moyen
de le contenir, que par la crainte des
peines portées par les L oix , c’est-a-
dire, par le dernier moyen qu’eussent
les premiers Législateurs, de retenir
ceux qui n’avoient pu être préservés du
crime par une sage éducation. Mais du
temps de Timée, les Législateurs avoient
trouvé le secret de faire parler les Dieux,
et de lés rendre surveillans et vengeurs
des crimes des hommes. Ce nouveau
ressort, qu’avoit inventé 3a pohTîque ,
il consent qu’on l’emploie, comme un
remède extrême contré ceux que m
l’éducation, ni la philosophie, ni les,
peines portées par les Loix, rie pourvoient
retenir; c’est-à-dire, qu’il le
regarde comme le remède réservé à un
malade désespéré, et qui quelquefois
pourra réussir. Il permet qu’on fasse
valoir ces fictions poétiques, sur les
vengeances qu’ont souvent exercées les
Dieux contre dès hommes ou des peuples
coupables ; et qu’on leur présente
l ’image des enfers et des supplices, qui
y sont réservés aux criminels. Il convient,
que ce sont des mensonges ; mais
il soutient, que le mensonge peut être
employé pour retenir ceux qui ne peuvent
être retenus par la vérité; c’est-
à-dire , qu’il veut que les idées religieuses
viennent à l’appui des moyens
politiques,tirés de l ’éducation et des loix;
et que le mensonge soit appelé au secours
de la vérité, quand elle est trop
foible pour faire triompher la raison.
Cette maxime est la même que celle
de ces Philosophes, dont parle Cicéron ,
qui ne donnoient à la Religion d’autre
origine , que le besoin de conduire les
hommes par l’opiniori, quand on ne
pouvoit les conduire par la raison.
cc Les opinions religieuses, disoient
» ces Philosophes ( 1 ) , ont été toutes
» imaginées par les Sages , pour le bien
33 des sociétés , afin de, conduire par
33 ce moyen ceux que la raison ne
>3 pouvoit rappeler au devoir 33. C’étoit
une grande vérité destructive de toutes
les Religions, comme l’observe très-
bien un des interlocuteurs du Dialogue
de Cicéron, sur la nature des Dieux ;
mais ce n’en étoit pas moins une vérité
incontestable, sur-tout dans le sens
qu’ils l’entendoient ; c’est-à-dire, pour
la partie qui la lie à la morale et aux
loix ( e ) , par la crainte des châtimens
et l ’espoir des récompenses, que l’on
doit attendre des Dieux. C’est ce
dernier ressort, dont Timée de Loeres
sent toute l ’utilité, quoi qu’il en avoue
la fausseté. De ce genre étoit, sans
(1) Cicer. de Nat. Deor. !. 1 , c. 41,
doute, la fiction Egyptienne de la chùte
de l’Atlantide, suite des désordres de ^
ses habitans 5 de la submersion de
l’Univers au temps de Deucalion, pour
punir les crimes du genre-humain ; des
destructions périodiques de l’Univers,
lorsque la vertu se seroit totalement
altérée , ,et lorsque le vice seroit parvenu
à son comble ; de la fable du
Tartare et de l’Elysée , dans lesquels
passoient les aines après la mort, pour
y subir un jugement et recevoir la punition
de leurs crimes , ou la récompense
de leurs vertus ; ou enfin dans une espèce
de Purgatoire,où par des expiations
douloureuses elles purifioient leurs souillures.
Toutes ces fictions étoient sorties de
l’obscurité des sanctuaires, et les Philosophes
, les Poètes et les Mystagogues
cherchèrent à les accréditer , pour intimider
les hommes incapables de s’élever
jusqu’à la vérité des principes, sur
lesquels la Nature a posé les bases de
la justice*et de la morale ( f ) . « Quant
33 à celui qui est indocile et rebelle à
33 la sagesse, continue Timée , que les
33 punitions dont le menacent les loix,
33 tombent sur lui_; et même qu’on
33 l’effraie par les terreurs religieuses
» qu impriment ces discours, où l’on
33 peint la vengeance qu’exercent les
» Dieux célestes, et les supplices iné-
33 vitables, qui sont réservés aux cou-
33 pables dans les enfers , et les autres
» fictions, que le Poète d’Ionie a ramas-
33 sées , d’après les anciennes opinions
33 sacrées. Car, comme on guérit quel-
33 ‘quefois le corps par des poisons,
33 quand le mal ne cède pas à des re-
33 mèdes plus sains ; on contient égale-
33 ment les esprits par des mensonges,
3> lorsqu’on ne peut les retenir par la
33 vérité. Qu’on y joigne même , s’il
33 est nécessaire, la terreur de ces
3> ' dogmes étrangers, qui font passer les
3» âmes des hommes mous et timides
‘ 33 dans des corps de femmes, que leur
» foiblesse expose à l’injure ; celles des
P *
\