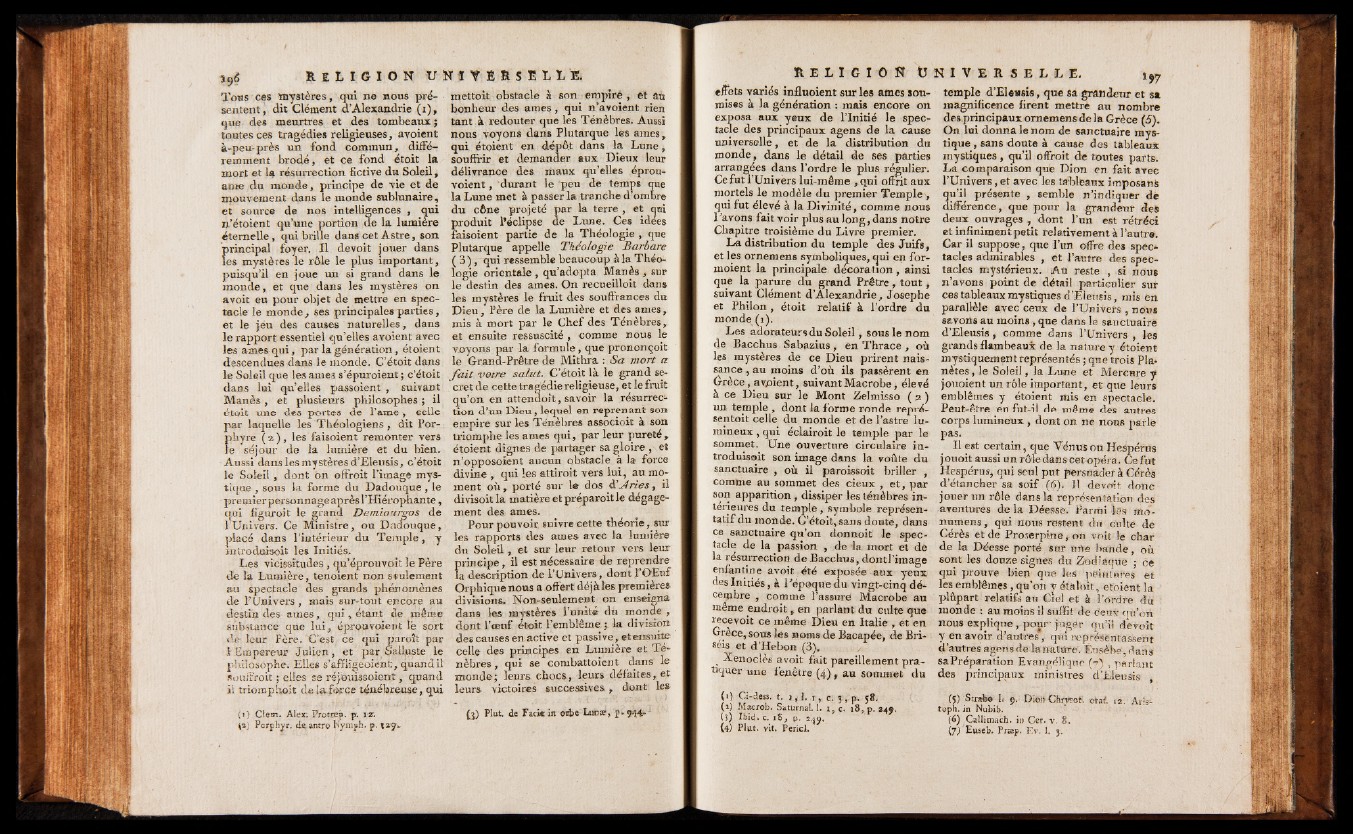
T o u s ces mystères, qui ne nous présentent,
dit Clément d’Alexandrie (i),
que des meurtres et des tombeaux ;
toutes ces tragédie» religieuses, avoient
à-peu-près un fond commun, différemment
brodé, et ce fond était la
mort et la résurrection fictive du Soleil,
anre du monde, principe de vie et de
ntouvement dans le monde sublunaire,
et source de nos intelligences , qui
n’étoient qu’une portion de la lumière
éternelle, qui brille dans cet Astre, son
principal foyer. Il devoit jouer dans
les mystères le rôle le plus important,
puisqu’il en joue un si grand dans le
m onde, et que dans les mystères on
avoit eu pour objet de mettre en spectacle
le monde, ses principale» parties,
et le jéu des causes naturelles, dans
le rapport essentiel qu’elles avoient avec
les âmes q ui, par la génération, étoient
descendues dans le monde. C’étoit dans
le Soleil que les âmes s’épuroient ; c’étoit
dans lui qu’elles passoient , suivant
Manès , et plusieurs philosophes ; il
était une des portes de l’am e, celle
par laquelle les Théologiens, dit Porphyre
(2 ), les faisoient remonter vers
le séjour de la lumière et du bien.
Aussi dans les mystères d’Eleusis, c’étoit
le Soleil , dont On oftroit l’image mystique
, sous la forme du Dadouque, le
premier personnage après l’Hiérophante,
qui figuroit le grand Demïonrgos de
1 Univers. Ce Ministre, ou Dadouque,
placé dans l’intérieur du Tem ple, y
m troduisoit les Initiés.
Les vicissitudes, qu’éprouvùit le Père
dè là Lumière, tenoient non seulement
au spectacle des grands phénomènes
de l’Univers, mais sur-tout encore au
destin des âmes, q u i, étant de même
substance que lui, épr envoie ut Iè sort
de- leur Père. C’est ce qui paroît par
1 Empereur Julien, et par S'alluste le
philosophe.. Elles s’affllgeoxent:, quandil
sonffroit ; elles se réjouissoîent, quand
il triomphait de la farce ténébreuse, qui
(1) Cfem. Alex; Protrep. p. 1Z.
Perphyr. de antre Nyir.yh. p. 12J.
mettoit obstacle à son empiré , et att
bonheur des âm es, qui n ’avoient rien
tant à redouter que les Ténèbres. Aussi
nous voyons dans Plutarque les âmes,
qui étoient en dépôt dans la L une,
souffrir et demander aux Dieux leur
délivrance des maux qu’elles éprou-
voient, durant le peu de temps que
la Lune met à passer la tranche d’ombre
du cône projeté par la terre , et qui
produit l’éclipse de Lune. Ces idées
faisoient partie de la Théologie , que
Plutarque appelle Théologie Barbare
( 3) , qui ressemble beaucoup à la Théologie
orientale , qu’adopta Manès , sur
le destin des âmes. On recueilloit dans
les mystères le fruit des souffrances du
D ieu, Père de la Lumière et des âmes,
mis à mort par le Chef des Ténèbres,
et ensuite ressuscité , comme nous le
voyons par la formule, que prononçoit
le Grand-Prêtre de Mithra ; S a mort a
f a i t votre salut. C’étoit là le grand secret
de cette tra gédie religieuse, et le fruit
qu’on en attendoit, savoir la résurrection
d’un D ieu, lequel en reprenant son
empire sur les Ténèbres associoit à son
triomphe les âmes qui, par leur pureté,
étoient dignes de partager sa gloire , et
n ’opposoient aucun obstacle à la force
divine , qui les attiroit vers lui, au moment
o ù , porté sur 1* dos d'A r ie s , il
divisoitla matière et préparoitle dégagement
Poudre pso uâvmoeisr,. suivre cette théorie, sur
les rapports des âmes avec la lumière
du Soleil, et sur leur retour vers leur
principe, il est nécessaire de reprendre
la description de l’Univers, dontf’QËuf
Orphique nous a offert déjàles premières
divisions. Non-seulement on enseigna
dans les mystères l’unité du monde ,
dont l’oeuf était l’emblêine la division
des causes enactive et passive , et ensuite
celle des principes en Lumière et Ténèbres
, qui se combattaient dans le
monde; leurs chocs, leurs défaites, et
leurs victoires successives, dont les
(3) Plut, de Fade in orbe Limæ, p.
effets variés influoient sur les âmes soumises
à la génération : mais encore on
exposa aux yeux de l’Initié le spectacle
des principaux ageus de la cause
universelle, et de la distribution du
monde, dans le détail de ses parties
arrangées dans l’ordre le plus régulier.
C efutl’Univèrs lui-même , qui offrit aux
mortels le modèle du premier Temple ,
qui fut élevé à la D ivinité, comme nous
l ’avons fait voir plus au long,dans notre
Chapitre troisième du Livre premier.
La distribution du temple des Juifs,
et les ornemens symboliques, qui en for-
moient la principale décoration, ainsi
que la parure du grand P rêtre, to u t,
suivant Clément d ’Alexandrie, Josephe
emt oPndheil ofni) ., étoit relatif à l’ordre du
Les adorateurs du Soleil, sous le nom
de Bacchus Sabazius, en Thrace , où
les mystères de ce Dieu prirent nais-
san ce , au moins d’où ils passèrent en
Grèce, avaient, suivantMacrobe, élevé
à ce Dieu sur le Mont Zelmisso ( 2 )
un temple , dont la forme ronde représentait
celle du monde et de l’astre lumineux
, qui éclairoit le temple par le
sommet. Une ouverture circulaire introduisait
son image dans la voûte du
sanctuaire , où il paroissoit briller ,
comme au sommet des cieux , et, par
son apparition, dissiper les ténèbres intérieures
du tem ple, symbole représentatif
du monde. C’était, sans doute, dans
ce sanctuaire qu’on donnoit le spectacle
de la passion , de la mort et de
la résurrection de Bacchus, dontl’image
enfantine avoit été exposée aux yeux
des Initiés, à l’époque du vingt-cinq décembre
, comme l’assure Macrobe au
même endroit, en parlant du culte que
recevoit ce même Dieu en Italie , et en
sGérisè ceet, sdo’uHse lbeso nn o(m3)s. de Bacapée, de Bri-
Xenoclès avoit fait pareillement pratiquer
une fenêtre (4 ), au sommet du
((11)) MCia-dcreosbs.. St.a tJur, nIa. Lr 1,. 1c ; 3c ., 1p8. , 5p8. .axs. (3) Ibid. c. 1$, p. zqÿ. (t) Plut. vit. Pericl.
temple d’Eleusis, que sa grandeur et sa
magnificence firent mettre au nombre
des,principaux ornemens de la Grèce (5). On lui donna le nom de sanctuaire mystique
, sans doute à cause des tableaux
mystiques, qu’il offroit de toutes parts.
La comparaison que Dion en fait avec
l’Univers, et avec les tableaux imposans
u’il présente , semble n ’indiquer dè
ifférence, que pour la grandeur des
deux ouvrages , dont l’un est rétréci
et infiniment petit relativement à l’autre.
Car il suppose, que l’un offre des spectacles
admirables , et l’autre des spectacles
mystérieux. Au reste , si nous
n ’avons point de détail particulier sur
ces tableaux mystiques d’Eleusis, mis en
parallèle avec ceux de l’Univers , nous
savons au moins, que dans le sanctuaire
d’Eleusis, comme dans l'Univers , les
grands flambeaux de la nature y étoient
nmèytessli ,q ulee mSoelnetirle, plraé sLeunntées e; qt uMe terorcisu rPel ay
jouoient un rôle important, et que leurs
emblèmes y étoient mis en spectacle.
Peut-être en fut-il de même des autres
pcoasrp. s lumineux , dont on ne nous parlé
Il est certain, que Vénus ou Hespérus
jouoit aussi un rôle dans cet opéra. Ge fut
Hespérus, qui seul put persuader à Cérès
d’étancher sa soif (6). Il devoit donc
jouer un rôle dans la représentation des
aventures de la Déesse. Parmi les mo-
numens, qui nous restent du culte de
Gérés et de Proserptne, oft voit le char
de la Déesse porté sur née bande, où
sont les douze signes du Zodiaque ; ce
qui prouve bien que les ‘peinturés et
les emblèmes, qu’on y étaloit, étaient là
plûpart relatifs au Ciel et à l’ordre du
monde : au moins il suffît'de ceux ciù’on
nous explique, pour- juger qu’il devoit
y en avoir d’autres, qui représentassent
d ’autres agensde lanatare. Ëusèbe,dahs
saPréparation Evangélique (7"! , narlant
des principaux ministres d ’Eleusis ,
(5) 'Stritfe© 1. r). Dîort-Chrvtot; .2 Arc-
toph. in Nubib.
(6) Caîlimach. in Cer. v. 8.
(7) Euseb. Præp. Ev. 1. 3.