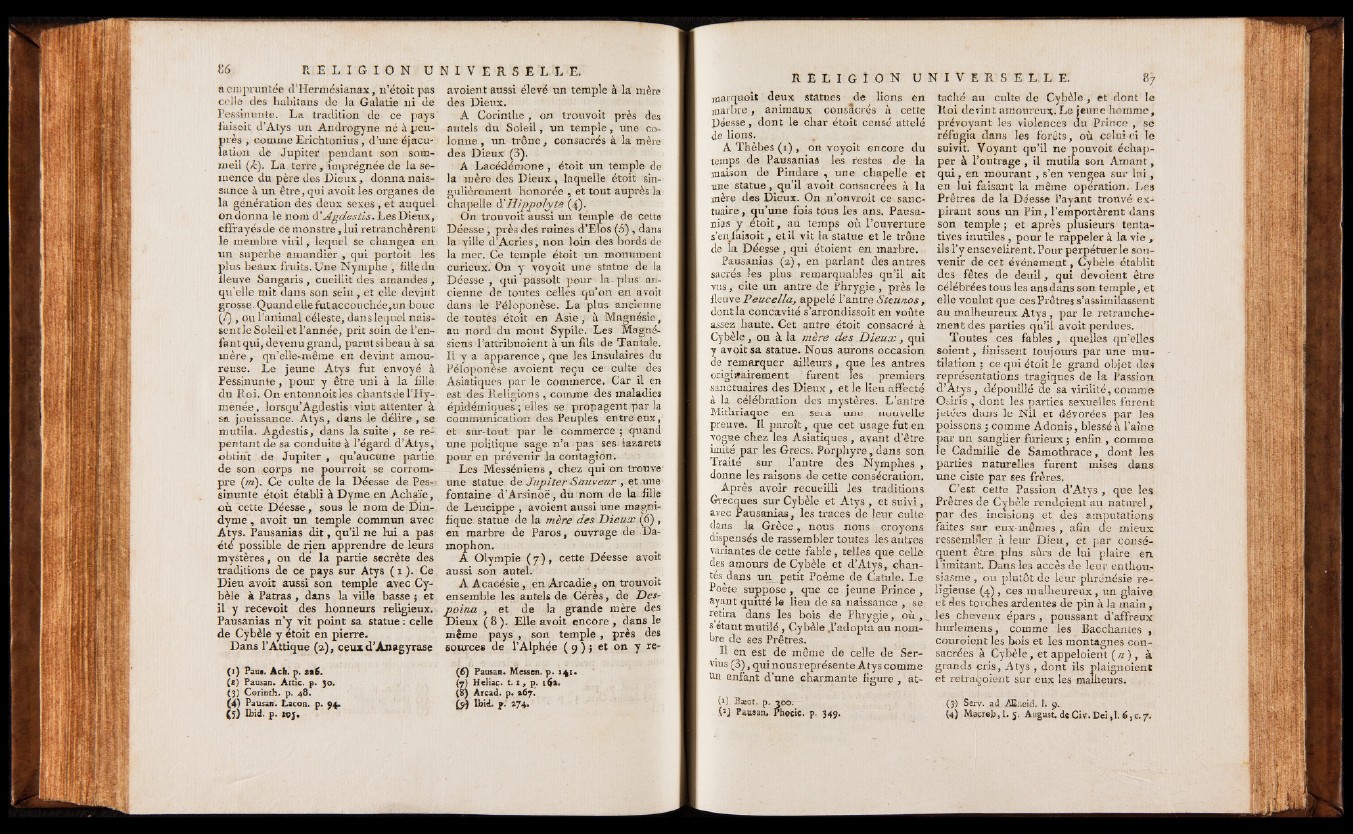
a empruntée d’PIermésianax, 11’étoit pas
celle des liabitans de la Galatie ni de
Pessinunte. La tradition de ce pays
fkisoit d’Atys un. Androgyne né à peuples
, comme Erichtonius , d’une éjaculation
de Jupiter pendant son sommeil
(4). La terre , imprégnée de la semence
du père des Dieux, donna naissance
à un être, qui avoit les organes de
la génération des deux sexes, et auquel
on donna le nom d'Agdestis. Les Dieux,
effrayés de ce monstre, lui retranchèrent
le membre viril, lequel se changea en
un superbe amandier , qui portoit les
plus beaux fruits. Une Nymphe , bile du
fleuve Sangaris , cueillit des amandes ,
qu’elle mit dans son sein, et elle devint
grosse. Quandelle fut accouchée,un bouc
(/) , ou l’animal céleste, dans lequel naissent
le Soleil et l’année, prit soin de l’enfant
qui, devenu grand, parut si beau à sa
mère, qu’elle-même en devint amoureuse.
Le jeune Atys fut envoyé à
Pessinunte, pour y être uni à la fille
du Roi. On entonnoitles chants de l’Hy-
menée, lorsqu’Agdestis vint attenter à
sa jouissance. Atys, dans le délire, se
mutila. Agdestis, dans la suite , se repentant
de sa conduite à l ’égard d’Atys,
obtint de Jupiter , qu’aucune partie,
de son corps ne pourrait se corrompre
(ai). Ce culte de la Déesse de P es--
sinunte .étoit établi à Dyme en Achaïe,
où "cette Déesse, sous le nom de Din-
dyme , avoit un temple commun avec
Atys. Pausanias d it, qu’il ne hii a pas
été possible de rien apprendre de leurs
mystères, ou de la partie secrète des
traditions de ce pays sur Atys ( 1 ). Ce
Dieu avoit aussi son temple avec Cy-
bèle à Patras , dans la ville basse ; et
il y recevoit des honneurs religieux,
Pausanias n’y vit point sa statue : celle
de Cÿbèle y étoit en pierre.
Dans l’Attique (a), ceuxd’Ànagyrase
(i) Païu. Acb. p. 2*6.
(fi) Fausan. Aîtic. p. 30.
(3) Corinth. p. 48. (41 Pausan. Lacoa. p. 94.
(5) Ibid. p. WJ.
avoient aussi élevé un temple à la mère
des Dieux.
A Corinthe, on trouvoit près des
autels du Soleil, un temple, une colonne
, un trône, consacrés à la mère
des Dieux (3).
A Lacédémone , étoit un temple de
la mère des Dieux, laquelle étoit singulièrement
honorée , et tout auprès la
chapelle d’Hippolyte (4).
On trouvoit aussi un temple de cette
Déesse , près des ruines d’Elos (5) , dans
la ville d’Acries, non loin des bords de
la mer. Ce temple étoit un monument
curieux. On y voyoit une statue de la
Déesse , qui passott pour la plus ancienne
de tontes celles qu'on en avoit
dans le Péloponèse. La plus ancienne
de toutes étoit en A s i e à Magnésie,
au nord du mont Sypile. Les Magnésiens
l’attribuoient à un fils de Tantale.
Il y a apparence, que les Insulaires du
Péloponese avoient reçu ce culte des
Asiatiques par le commerce. Car il en
est des Religions , comme des maladies
épidémiques ; elles se propagent par la
communication des Peuples entre eux,
et sur-tout par le commerce ; quand
une politique sage n’a pas ses lazarets
pour en prévenir la contagion.
Les Messéniens , chez qui on trouve
une statue de Jupiter Sauveur , et une
fontaine d’Arsinoë, du nom de la fille
de Leucippe , avoient aussi une magnifique
statue de la mère des D ieux (6) ,
en marbre de Paros, ouvrage de Da-
mophon.
A Olympie ( 7 ) , cette Déesse avoit
aussi son autel.
A Acacésie, en Arcadie, on trouvoit
ensemble les autels de Cérès, de Des-
poina , et de la grande mère des
Dieux ( 8 ). Elle avoit encore , dans le
même pays , son temple , près de»
sources de l’Alphée ( 9 ) ; et on y re-
(6) Pausan. Messen, p. 141.
(7) Heliac. 1 .1 , p. 16a.
(b) Arcad. p, *67.
(ÿ) Ibii f : 274-
R E L I G I O N U N I V E R S E L L E . 87
marquent deux statues de lions en
marbre, animaux consacrés à cette
péesse, dont le char étoit censé attelé
de lions.
À Thèbes (x) , on voyoit encore du
temps de Pausanias les restes de la
maison de Pindare , une chapelle et
une statue, qu’il avoit consacrées à la
mère des Dieux. On n’ouvroit ce sanctuaire
, qu’une fois tous les ans. Pausanias
y étoit, au temps où l’ouverture
s’en faisoit, et il vit la statue et le trône
de la Déesse , qui étoient en marbre.
Pausanias (2), en parlant dés antres
sacrés les plus remarquables qu’il ait
vus, cite un antre de Phrygie , près le
fleuve Peùcella, appelé l’antre Steunos,
dont la concavité s’arrondissoit en voûte
assez haute. Cet antre étoit consacré à
Cybèle, ou à la mère des D ie u x , qui
y avoit sa statue. Nous aurons occasion
de remarquer ailleurs, que les antres
originairement furent les premiers
sanctuaires des Dieux , et le lieu affecté
à la célébration des mystères. L ’antrè
Mithriaque en sera une. nouvelle
preuve. U paraît, que cet usage fut en
vogue chez les Asiatiques , avant d’être
imité par les Grecs. Porphyre, dans son
Traité sur l ’antre des Nymphes ,
donne les raisons de cette consécration.
Après avoir recueilli les traditions
Grecques sur Cybèle et Atys, et suivi,
avec Pausanias, les traces de leur culte
dans la Grèce, nous nous croyons
dispensés de rassembler toutes les autres
variantes de cette fable, telles que celle
des amours de Cybèle et d’Atys, chantés
dans un_petit Poème de Catule. Le
Poète suppose, que ce jeune Prince,
ayant quitté le lieu de sa naissance , se
retira dans les bois de Phrygie, o ù ,
s étant mutilé, Cybèle .l’adopta an nombre
de ses Prêtres.
Il en est de même de celle de Ser-
vius (3), qui nous représente Atys comme
Un enfant d’une charmante figure , at-
(1) Bæot. p, 2oo.
(U Pausan» Phçcic. p. 349.
taché au culte de Cybèle , et dont le
Roi devint amoureux. Le jeune homme,
prévoyant les violences du Prince , se
réfugia dans les forêts, où celui ci le
suivit. Voyant qu’il ne pouvoit échapper
à l’outrage , il mutila son Amant,
qui, en mourant , s’en vengea sur lui,
en lui faisant la même opération. Les
Prêtres de la Déesse l’ayant trouvé expirant
sous un Pin, l’emportèrent dans
son temple ; et après plusieurs tentatives
inutiles, pour le rappeler à la vie ,
ils l’y ensevelirent. Pour perpétuer le souvenir
de cet événement, Cybèle établit
des fêtes de deuil, qui dévoient être
célébrées tous les ans dans son temple, et
elle voulut que ces Prêtres s’assimilassent
au malheureux Atys , par le retranchement
des parties qu’il avoit perdues.
Toutes ces fables , quelles qu’elles
soient, finissent toujours par une mutilation
; ce qui étoit le grand objet des
représentations tragiques de la Passion
d’Atys, dépouillé de sa virilité, comme
Osiris , dont les parties sexuelles furent
jetées dans le Nil et dévorées par les
poissons ; comme Adonis, blessé à l’aîne
par un sanglier furieux ; enfin , comme
le Cadmille de Samothrace, dont les
parties naturelles furent mises dans
une ciste par ses frères.
C’est cette Passion d’Atys , que les
Prêtres 4e Cybèle rendoient au naturel,
par des incisions et des amputations
faites sur eux-mêmes , afin de mieux
ressembler à leur Dieu, et par conséquent
être pins sûrs de lui plaire en.
l ’imitant. Dans les accès de leur enthousiasme
, ou plutôt de leur phrénésie religieuse
(4.) , ces malheureux, un glaive
e t des torches ardentes de pin à la main,
les cheveux épars , poussant d’affreux
hurlemens, comme ies Bacchantes ,
couraient les bois et les montagnes consacrées
à Cybèle, et appeloien t ( n ) , à
grands cris, A tys , dont ils plaignoient
et retraçoient sur eux les malheurs. .
(3-) Serir. ad AEneid. 1. 9.
(4) Macreb, 1.5. August.d«Civ.Eei,!. 6 ,c.7.