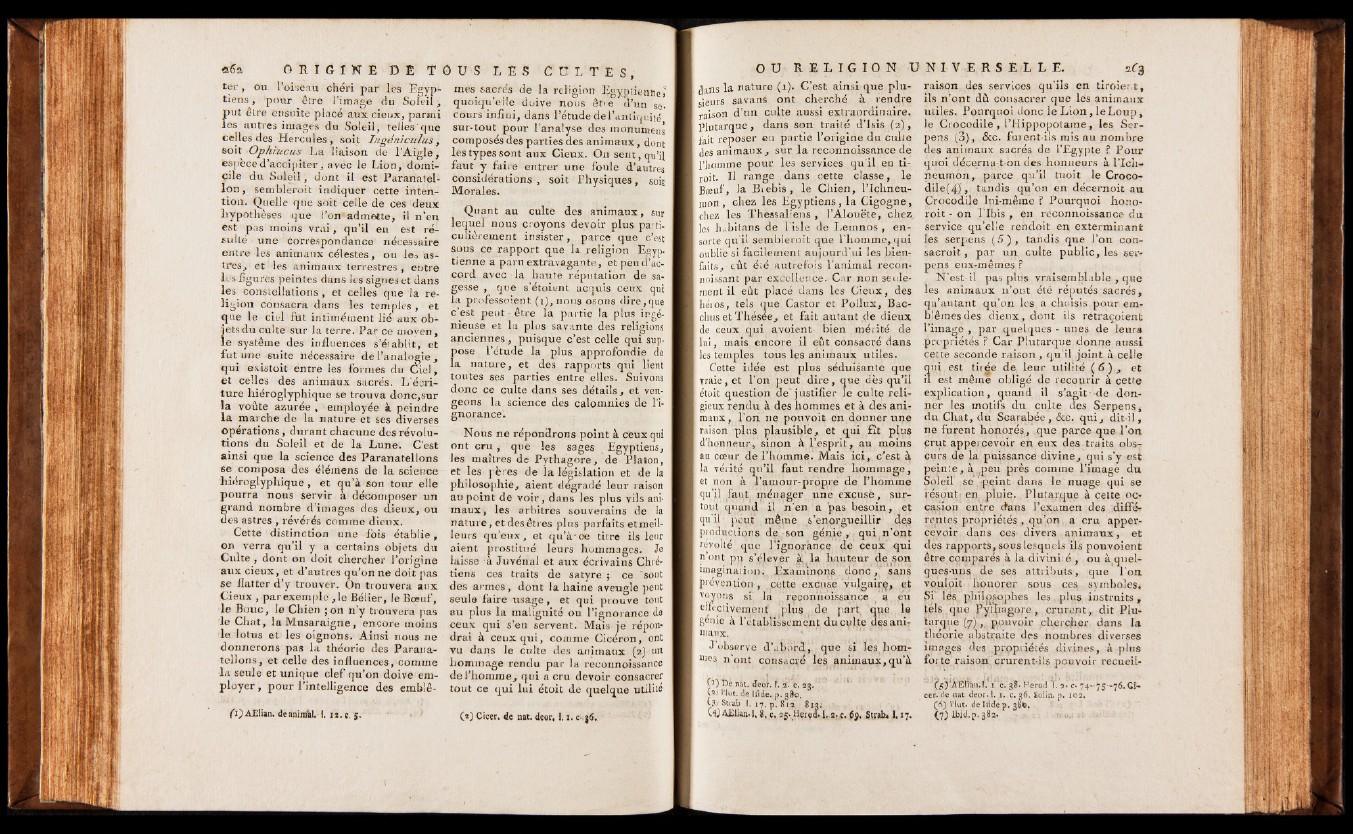
te r , ou I oiseau chéri par les Egyptiens,
pour être l’image du Soleil,
put être ensuite placé aux cieux, parmi
les autres images du Soleil, telles que
celles des Hercules , soit Ingéniculus,
soit Ophiucus La liaison de l ’Aigle,
espèce d’accipiter, avec le Lion, domicile
du Soleil, dont il est Paranatel-
Ion, sembleroit indiquer cette intention.
Quelle que soit celle de ces deux
hypothèses que l’on admette, il n’en
est pas moins vrai, qu’il en est résulté
une correspondance nécessaire
entre les animaux célestes, ou les astres,
et les animaux terrestres , entre
les ligures peintes dans les signes et dans
les constellations , et celles que la religion
consacra dans les temples, et
que le ciel fut intimement lié aux objets
du culte sur la terre. Par ce moyen,
le système des influences s’établit, et
fut une suite nécessaire de l’analogie ,
qui existait entre les formes du Ciel,
et celles des animaux sacrés. L écriture
hiéroglyphique se trouva donc,sur
la voûte azurée , employée à peindre
la marche de la nature et ses diverses
opérations , durant chacune des révolutions
du Soleil et de la Lune. C’est
ainsi que la science des Paranatellons
se composa des éléinens de la science
hi éroglyphiqne , et qu’à son tour elle
pourra nous servir a décomposer un
grand nombre d’images des dieux, ou
des astres , révérés comme dieux.
Cette distinction une fois établie,
on verra qu’il y a certains objets du
Culte , dont on doit; chercher l’origine
aux cieux, et d’autres qu’on ne doit pas
se flatter d’y trouver. On trouvera aux
Cieux , par exemple , le Bélier, le Boeuf,
le Bouc, le Chien ; on n’y trouvera pas
le Chat, la Musaraigne, encore moins
le lotus et les oignons. Ainsi nous ne
donnerons pas la théorie des Parana-
tellons, et celle des influences, comme
la seule et unique clef qu’on doive employer
, pour l ’intelligence des emblêfQAElian.
deaninàl. I, ii.e. J.
mes sacrés de la religion Egyptienne>
quoiqu’elle doive nous êtie d’un se.
cours infini, dans l ’étude del’anliquité
sur-tout pour l ’analyse des inonuinens
composés des parties des animaux, dont
les types sont aux Cieux. On sent, qu’il
faut y faire entrer une foule d’autres
considérations , soit Physiques, soit
Morales.
Quant au culte des animaux, sur
lequel nous croyons devoir plus parti-
culièrement insister, parce que c’est
sous ce rapport que la religion Egyp.
tienne a paru extravagante, etpeud’ac-
cord avec la haute réputation de sagesse
, que s’étoient acquis ceux qui
la professoient (i),nous osons dire,que
c’est peut-être la partie la plus ingénieuse
et la plus savante des religions
anciennes, puisque c’est celle qui suppose
l’étude la plus approfondie de
la nature, et des rapports qui lient
toutes ses parties entre elles. Suivons
donc ce culte dans ses détails, et vengeons
la science des calomnies de l’ignorance.
Nous ne répondrons point à ceux qui
ont c ru , que les sages Egyptiens,
les maîtres de Pythagore, de Platon,
et les pères de la législation et de la
philosophie, aient dégradé leur raison
au point de voir, dans les plus vils animaux,
les arbitres souverains de la
nature, et des êtres plus parfaits et meilleurs
qu’eux, et qu’à-oe titre ils leur
aient prostitué leurs hommages. Je
laisse à Juvénal et aux écrivains Chrétiens
ces traits de satyre ; ce sont
des armes, dont la haine aveugle peut
seule faire usage, et qui prouve tout
au plus la malignité ou l ’ignorance de
ceux qui s’en servent. Mais je répondrai
à ceux qui, comme Cicéron, ont
vu dans le culte des animaux (2) un
hommage rendu par la reconnoissance
de l’homme, qui a cru devoir consacrer
tout ce qui lui étoit de quelque utilité
(*) Citer, de nat. deor, 1, 1. c- j<5.
dans Ia nature (1). C’est ainsi que plusieurs
savans ont cherché à rendre
raison d’un culte aussi extraordinaire.
Plutarque, dans son traité d’Isis (2),
fait reposer eu partie l’origine du culte
des animaux, sur la reconnoissance de
l’homme pour les services qu’il en ti-
roit. Il range dans cette classe, le
Boeuf, la Biebis, le Chien, l’Ichneu-
inon, chez les Egyptiens, la Cigogne,
chez les Thessaliens , l’Alouëte, chez,
I les h^bitans de 1 isle de Leinnos , en-
sorte qu’il sembleroit que l ’homme, qui
oublie si facilement aujourd’ui les bienfaits,
eût été autrefois l ’animal recon-
[ noissant par excellence. Car non seule-
I ment il eût placé dans les Cieux, des
I héros, tels que Castor et Pollux, Bac-
chus et Thésée, et fait autant de dieux
de ceux qui avoient bien mérité de
lui, mais encore il eût consacré dans
; les temples tous les animaux utiles.
Cette idée est plus séduisante que
vraie, et l’on peut dire, que dès qu’il
étoit question de'justifier le culte reli-
[ gieux rendu à des hommes et à des animaux,
l'on ne pouvoit en donner une
raison plus plausible, et qui fit plus
| d’honneur, sinon à l’esprit, au moins
au coeur de l ’homme. Mais ici, c'est à
la vérité qu’il faut rendre hommage,
et non à l ’amour-propre de l’homme
[ qu’il faut ménager une excuse, surtout
qugnd il n’en a pas besoin, et
! qu il peut même s’enorgueillir des
productions de son génie , qui n’ont
révolté que l’ignorance de ceux qui
n ont pp s’élever à la hauteur de son
imaginai ion. Examinons donc, sans
prévention, cette excuse vulgairq, et
voyons si la reconnoissance a , jeu
effectivement’ plus de part que le
génie à l ’établissement du culte des animaux.
J’observe d’abord, que si les,hommes
n ont consacré les animaux,qu’à
C1!) De nat. deor. i, 2'. c. 33.
(2! Vlut. de Ifide. p. 3S0,
(?/Strab I. 17. p. 812 813.'
JAiîlian. 1.8. c. ej- Heivd. 1. 2. c. {y, Strab» 1, 17.
raison, des services qu’ils en tlroier.t,
ils n’ont dû consacrer que les animaux
utiles. Pourquoi donc le Lion, le Loup ,
le Crocodile, l’Hippopotame, les Ser-
pens (3), &c. fuient-ils mis au nombre
des animaux sacrés de l’Egypte ? Pour
quoi décerna-t-on des honneurs à l ’Ich-
neumon, parce qu’il tuoit le Crocodile^),
tandis qu’on en décernoit an
Crocodile lui-même ? Pourquoi hono-
roit - on l’Ibis , en reconnoissance du
service qu’elle rendoit en exterminant
les serpens (5 ) , tandis que l’on consacrait,
par un culte public, les ser-
pens eux-mêmes ?
N'est- il pas plus vraisemblable , que
les animaux liront été réputés sacrés,
qu’autant qu’on les a choisis pour emblèmes
des dieux, dont ils retraçoient
l’image , par quelques - unes de leurs
propriétés ? Car Plutarque donne aussi
cette seconde raison, qu’il joint à celle
qui est tirée de. leur utilité ( 6 ) , et
il est même obligé de recourir à cette
explication, quand il s’agit -de donner
les motifs du culte des Serpens,
du Chat, du Scarabée, &c. qui, dit-il,
ne furent honorés, que parce que l’on
crut appercevoir eh eux des traits obscurs,
de la puissance divine, qui s’y est
peinte, à ,peu près comme l’image du
Soleil se -peint dans le nuage qui se
résout^ en pluie. Plutarque à celte occasion
entre dans l’examen des différentes
propriétés , qu’on a cru apper-
ceyoir dans ces divers animaux, et
dçs rapports, sous lesquels ils pouvoient
être comparés à la divinfé , ou à,quelques
uns. de ses attributs, que l'on
vouloir honorer sous ces symboles,
.Si' les, philosophes les,.plus instruits,
tels que Pytjiagore, crurent, dit Plutarque
(7)',, pouvoir chercher dans la
théorie abstraite des nombres diverses
images des propriétés divines, à plus
forte raison crurent-ils pouvoir recueiL-
(*5yÂE!i!m.l. i’ c. 38. Herod I. 9. c. 74-75—76. Ci-
cer.de nat deor. 1. i. c. 36. Soliu* p. 102.
(6) P lut. de Ilide p. 38$,
(7 ) Ibid, p-382. ü »1
S:
S i® H ;
i i i
iii
j i j t
1 «