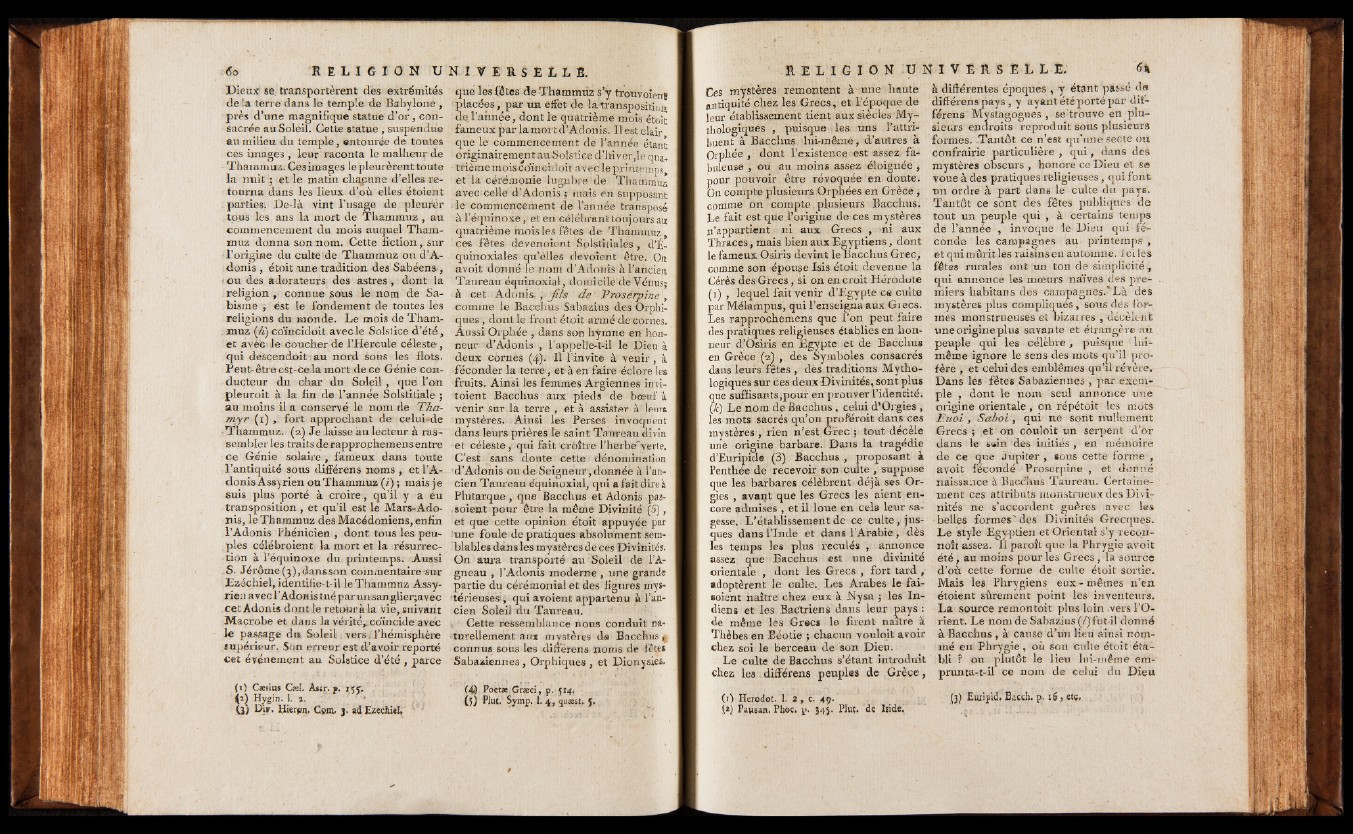
Dieu* se. transportèrent des extrémités
delà terre dans le temple de Babylone,
près d’une magnifique statue d’o r, consacrée
au Soleil. Cette statue , suspendue
au milieu du temple, entourée de toutes
ces images , leur raconta le malheur de
Thammuz. Ces images le pleurèrent toute
la Unit q et le matin chapune d’elles retourna
dans les lieux d’où elles étoient
parties. De-là vint l’usage de pleurer
tous les ans la mort de Thammuz , au
commencement du mois auquel Tham-
muz donna son nom. Cette fiction, sur
l ’origine du culte de Tliammuz ou d’A-
donis , étoit une tradition des Sabéens,
; ou des adorateurs des astres, dont la
religion, connue .sous le nom de Sa-
bisme est le fondement de toutes les
religions du monde. Le mois de Tham-
. muz (fi) coïncidoit avec le Solstice d’été,
et avec le coucher de l’Hercule céleste,
qui descendoit au nord sous les flots.
Peut-être est-ce,la mort de ce Génie conducteur
du char du Soleil , que l’on
pleuroit à la fin de l’année Solstitiale ;
au moins il a conservé le nom de Tha-
myr (i) , fort approchant de celui»de
■ Thammuz. (2) Je laisse au lecteur à rassembler
les traits derapprochemens entre
ce Génie solaire , fameux dans toute
l ’antiquité sous différens noms , et l’A donis
Assyrien ou Thammuz (i) ; mais je
suis plus porté à croire, qu’il y a eu
transposition , et qu’il est le Mars-Adonis,
le Thammuz des Macédoniens, enfin
l’Adonis Phénicien , dont tous les peuples
célébraient la mort et la résurrection
à l’équinoxe du printemps. Aussi
S. Jérôme (a), dans son commentaire-sur
Ezéchiel, identifie-t-il le Thammuz Assyrien
avec l’Adonis tué parunsanglier;avec
cet Adonis dont le retour à la vie, suivant
Maçrobe et dans la vérité^cdincide avec
le passage du Soleil. vers i l’hémisphère
supérieur. Son erreur est d’avoir reporté
cet événement au Solstice d’été , parce
(1) Cæsius Gel. Ai;r. j». jyy.
{r) Hygin. 1. 2. -
(î) Uiv» Hàr»n. C$>m. 3. ai EzechUI, ' '
que les fêtes de Thammuz s’y trouvoïënt
placées, par un effet de la transposition
de l’année, dont le quatrième mois étoit
fameux par la mort d’Adonis. Il est clair
que lè commencement de l’année étant
originairementauSolstice d’hiver ,1e qua.
triàmemoiscoincidoit aÿeele printemps
et la cérémonie lugubre de Tliammuz.
avec celle d’Adonis q .mais en supposant
le commencement de l’année transposé
à l’équinoxe, et en célébrant toujours an
quatrième mois les fêtes de Thammuz
ces fêtes devenoient Splstitiales , d’É-
quinoxiales qu’è.lles dévoient être. On
avoir donné le nom d’Adonis à l’ancien
Taureau équinoxial, domicile de Vénusq
à cet Adonis. , fils de Proserpine ,
comme le Bacelius Sabazius des Orphiques
, dont le front étoit armé de cornes.
Aussi Orphée , dans son hymne en honneur
d’Adonis , i’appelle-t-il le Dieu à
deux cornes (4). Il l’invite à venir, à
féconder la terre, et à en faire éclore les
fruits. Ainsi les femmes Argiennes inri-
toient Bacchus aux pieds de boeuf à
venir sur la terre , et à assister à leurs
mystères. Ainsi les Perses invoquent
dans leurs prières le saint Taureau divin
et céleste, qui fait croître l’herbe'verte.
C’est sans doute cette dénomination
• d’Adonis ou de Seigneur, donnée à l’ancien
Taureau équinoxial, qui afaitdiroà
Plutarque , que Bacchus et Adonis pas-
soient pour être la même Divinité (S) ,
et que cette opinion étoit appuyée par
une foule de pratiques absolument semblables
dansles mystères de ces Divinités.
On aura transporté au Soleil de l’Agneau
, l’Adonis moderne , une grande
partie du cérémonial et des figures mystérieuses,
qui avoient appartenu à l’ancien
Soleil du Taureau,
ü Cette ressemblance nous conduit naturellement
aux mystères de Bacchus^
connus sous les différens noms de fêtes
Sahariennes , Orphiques , et Dionysies.
(4$ Poet» Grævi, p. 514.
(5) Plut. Symp. 1. 4, <juæit. J,
Ces mystères remontent à une haute
antiquité chez les Grecs, et l ’époque de
leur établissement tient aux siècles Mythologiques
, puisque les uns l’attribuent
à Bacchus lui-même , d’autres à
Orphée , dont l'existence est assez fabuleuse
, ou au moins assez éloignée ,
pour pouvoir être révoquée en doute.
On compte plusieurs Orphées en Grèce,
comme on compte plusieurs Bacchus.
Le fait est que l’origine de ces mystères
n’appartient ni aux Grecs , ni aux
Thraces, mais bien aux Egyptiens, dont
le fameux Osiris devint le Bacchus Grec,
comme son épouse Isis étoit devenue la
Cérès des Grecs, si on en croit Hérodote
(1) , lequel fait venir d’Egypte ce culte
par Méktmpus, qui l’enseigna aux Giecs.
Les rapprochemens que l ’on peut faire
des pratiques religieuses établies en honneur
d’Osiris en Egypte et de Bacchus
en Grèce (2) , des Symboles consacrés
dans leurs fêtes, des traditions Mythologiques
sur ces deuxDivinités, sont plus
que suffisants,pour en prouver l’identité.
(£) Le nom de Bacchus, celui d’Orgies ,
les mots sacrés qu’on proférait dans ces
mystères , rien n’est Grec 5 tout décèle
unè origine barbare. Dans la tragédie
d’Euripide (3) Bacchus , proposant à
Penthée de recevoir son culte , suppose
que les barbares célèbrent déjà ses Orgies
, avant que les Grecs les aient encore
admises , et il loue en cela leur sagesse.
L ’établissement de ce culte, jus-
ques dans l’Inde et dans l ’Arabie, dès
les temps les plus reculés , annonce
assez que Bacchus est une divinité
orientale , dont les Grecs , fort tard ,
adoptèrent le culte.. Les Arabes le fai-
soient naître chez eux à Nysa $ les Indiens
et les Baçtriens dans leur pays :
de même les Grecs le firent naître à
Thèbes en Béotie q chacun vouloit avoir
chez soi le berceau de son Dieu.
Le culte de Bacchus s’étant introduit
chez les . différens peuples de Grèce ,
(0 Herodot. 1. 2 , c. 49.
(*) Pausan. Plioc. 345. Plut, de Iiide.
à différentes époques , y étant passé de
différens pays, y ayant été porté par dit-
férens Mystagogues , se trouve en plusieurs
endroits reproduit sous plusieurs
formes. -Tantôt ce n’est qu’une secte ou
confrairie particulière , qui, dans des
mystères obscurs , honore ce Dieu et se
voue à des pratiques religieuses, qui font
un ordre à part dans le culte du pays.
Tantôt ce sont des fêtes publiques de
tout un peuple qui , à certains temps
de l’année , invoque le Dieu qui féconde
les campagnes au printemps ,
et qui mûrit les raisins en automne, i ci les
fêtes rurales ont un ton de simplicité,
qui annonce les moeurs naïves des premiers
habitans des campagnes. Là des
mystères plus compliqués, sous dés formes
monstrueuses et bizaires , décèlc-nt
une origine plus savante et étrangère au
peuple qui les célèbre, puisque lui-
même ignore le sens des mots qu’il profère
, et celui des emblèmes qu’il révère.
Dans lés fêtes Sabaziennes , par exemple
, dont le nom seul annonce une
origine orientale, on répétoit les mots
Enoi, Saboi, qui ne sont nullement
Grecs ; et on couloit un serpent d’or
dans le sein des initiés , en mémoire
de ce que Jupiter , sous cette forme ,
avoit fécondé Proserpine , et donné
naissance à Bacdhus Taureau. Certainement
ces attributs monstrueux des Divinités
ne s’accordent guères avec les
belles formes'des Divinités Grecques.
Le style Egyptien et Oriental s’-y recon-
noît assez. Il paraît que la Phrygie avoit
été, au moins pour les Grecs , la source
d’où cette forme de culte étoit sortie.
Mais leB Phrygiens eux-mêmes n’en
étoient sûrement point les inventeurs.
La source remontait plus loin .vers l’Orient.
Le nom de Sabazius (/) fut-il donné
à Bacchus, à cause d’un lieu ainsi nommé
en Phrygie, où son culte étoit établi
? ou plutôt le lieu lui-même emprunta
t-il ce nom de celui dit Dieu
(3) Euripid. B.icdi. p. , etc.