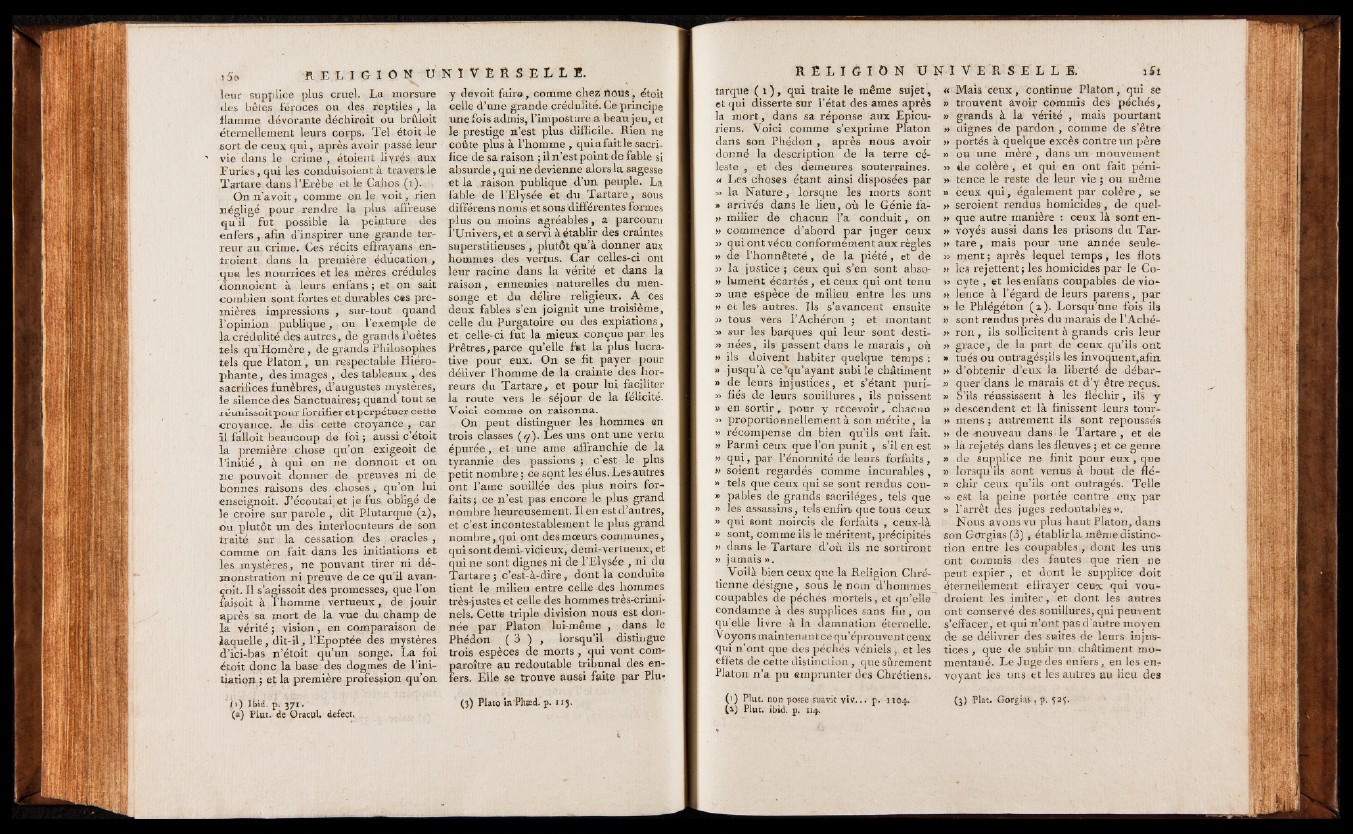
R 3 5© E L I G I O N U N I V E R S E L L E .
leur supplice plus cruel, La morsure
des bêtes féroces ou des reptiles , la
fiamme dévorante déchiroit ou brûloit
éternellement leurs corps. Tel étoit.le
sort de ceux qui, après avoir passé leur
vie dans le crime , étpient livrés aux
Furies, qui les conduisoient à travers le
Tartare dans l ’Erèbe et le Caiios (1). ,
On n’a voit, comme on le voit, rien
négligé pour rendre la plus affreuse
qu’il fut possible la peinture des
enfers, afin d’inspirer une grande terreur
au crime. Ces récits effrayans entroient
dans la première éducation ,
que les nourrices et les mères crédules
donnoient à leurs enfans ; et on sait
combien sont fortes et durables ces premières
impressions , sur-tout quand
l’opinion publique, ou l’exemple de
la crédulité des autres, de grands Poètes
tels qu’Homère, de grands Philosophes
tels que Platon, un respectable Hiérophante
, des images , des tableaux , des
sacrifices funèbres, d’augustes mystères,
le silence des Sanctuaires; quand tout se
réunissoitpour fortifier et perpétuer cette
croyance. Je dis cette croyance , car
il falloir beaucoup de foi ; aussi c’étoit
la première chose qu’on exigeoit de
l ’initié , à qui on ne donnoit et on
ne pouvoit donner de preuves ni de
bonnes raisons des choses ; qu’on lui
enseignoit. J’écoutai et je fus obligé de
le croire sur parole , dit Plutarque (2),
ou plutôt un des interlocuteurs de son
traité sur la cessation des , oracles ,
comme on fait dans les initiations et
les mystères, ne pouvant tirer ni démonstration
ni preuve de ce qu’il avan-
çoit. Il s’agissoit des promesses, que l’on
faisoit à l’homme vertueux, de jouir
après sa mort dé la vue du champ de
la vérité ; vision, en comparaison de
laquelle, dit-il, l’Epoptée des mystères
d’ici-bas n’étoit qu’un songe. La foi
étoit donc la base des dogmes de l’initiation
; et la première profession qu’on
|li) Ibid. p. 371.
(a) Plut. de Oracyl. defect.
y devoit faire, comme chez nous, étoit
celle d’une grande crédulité. Ce principe
une fois àdmis, l’imposture a beau jeu, et
le prestige n’est plus difficile. Rien ne
coûte plus à l ’homme , qui a fait le sacrifice
de sa raison ; il n’est point de fable si
absurde, qui ne devienne alors la sagesse
et la raison publique d’un peuple. La
fable de l’Elysée et du Tartare, sous
différens noms et sous différentes formes
plus ou moins agréables, a parcouru
l’Univers, et a servi à établir des craintes
superstitieuses , plutôt qu’à donner aux
hommes des vertus. Car celles-ci ont
leur racine dans la vérité et dans la
raison, ennemies naturelles du mensonge
et du délire religieux. A ces
deux fables s’en joignit une troisième,
celle du Purgatoire ou des expiations,
et celle-ci fut la mieux conçue par les
Prêtres, parce qu’elle fut la plus lucrative
pour eux. On se fit payer pour
déliver l’homme de la crainte des horreurs
du Tartare, et pour lui faciliter
la route vers le séjour de la félicité.
Voici comme on raisonna.
On peut distinguer les hommes en
trois classes (y). Les uns ont une vertu
épurée, et une ame affranchie de la
tyrannie des passions ; c est le plus
petit nombre ; ce sont les élus. Lesautr.es
ont Paine souillée des plus noirs forfaits
; ce n’est pas encore le plus grand
nombre heureusement. Il en est d’autres,
et c’est incontestablement le plus grand
nombre, qui ont des moeurs communes,
qui sont demir vicieux, demi-vertueux, et
qui ne sont dignes ni de l’Elysée , ni du
Tartare ; c’est-à-dire, dont la conduite
tient le .milieu entre celle des hommes
très-justes et celle des hommes très-criminels.
Cette triple division nous est donnée
par Platon lui-même , dans le
Phédon ( 3 ) , lorsqu’il distingue
trois espèces de morts , qui vont com-
paroître au redoutable tribunal des enfers.
Elle se trouve aussi faite par Plu-
(3) Plato inPhsed. p. 11).
R E L I G I O N U N I V E R S E L L E .
tarque ( 1 ) , qui traite le même sujet,
et qui disserte sur l’état des âmes après
la mort, dans sa réponse aux Epicuriens.
Voici comme s’exprime Platon
dans son Phédon , après nous avoir
donné la description de la terre céleste
, et des demeures souterraines.
« liés choses étant ainsi disposées par
» la Nature , lorsque les morts sont
» arrivés dans le lieu, où le Génie fa-
» milier de chacun l’a conduit, on
» commence d’abord par juger ceux
» qui ont vécu conformément aux règles
» de l’honnêteté , de la piété , et de
35 la justice ; ceux qui s’en sont abso-
» lument écartés , et ceux qui ont tenu
» une espèce de milieu entre les uns
» et les autres. Ils s’avancent ensuite
» tous vers l’Achéron ; et montant
» sur les barques qui leur sont desti-
» nées, ils passent dans le marais , où
» ils doivent habiter quelque temps :
» jusqu’à ce'qu’ayant subi le châtiment
» de leurs injustices, et s’étant puri-
33 fiés de leurs souillures , ils puissent
» en sortir, pour y recevoir, chacun
33 proportionnellement à son mérite, la
» récompense du bien qu’ils ont fait.
» Parmi ceux que l’on punit , s’il en est
» qui, par l’énormité de leurs forfaits ,
» soient regardés comme incurables ,
» tels que ceux qui se sont rendus cou-
» pables de grands sacrilèges, tels que
» lès assassins, tels enfin, que tous ceux
» qui sont noircis de forfaits , ceux-là
» sont, Comme ils le méritent, précipités
» dans le Tartare d’où ils ne sortiront
» jamais ».
Voilà bien ceux que la Religion Chrétienne
désigne, sous le nom d’hommes
coupables de péchés mortels, et qu’elle
condamne à des supplices sans fin, ou
qu’elle livre à la damnation éternelle.
Voyons maintenan t ce qu’éprouvent ceux
qui n’ont que des péchés véniels, et les
effets de cette distinction, que sûrement
Platon n’a pu emprunter des Chrétiens.
(1) Plut, non posse suavit y iv ... p. 1104-
(2) Plut. ibid. p. 114.
i S i
« Mais ceux, continue Platon, qui se
» trouvent avoir commis des péchés,
» grands à la vérité , mais pourtant
» dignes de pardon, comme de s’être
» portés à quelque excès contre un père
» ou une mère , dans un mouvement
» de colère, et qui en ont fait péni-
» tence le reste de leur vie ; ou même
» ceux qui, également par colère, se
» seroient rendus homicides, de quel-
» que autre manière : ceux là sont en-
» voyés aussi dans les prisons du Tar-
» tare, mais pour une année seule-
33 ment ; après lequel temps, les flots
» les rejettent; les homicides par le Co-
» cyte , et les enfans coupables de vio-
« lence à l’égard de leurs parens, par
» le Phlégéton (2). Lorsqu’une fois ils
» sont rendus près du marais de l’Aché-
» ron , ils sollicitent à grands cris leur
» grâce, de la part de ceux qu’ils ont
» tués ou outragésjils les invoquent,afin
» d’obtenir d’eux la liberté de débar-
» quer dans le marais et d’y être reçus.
» S’ils réussissent à les fléchir, il! y
» descendent et là finissent leurs tour-
» mens ; autrement ils sont repoussés
» de -nouveau dans le Tartare, et de
» là rejetés dans les fleuves ; et ce genre
» de supplice ne finit pour eux, que
3> lorsqu’ils sont venus à bout de flé-
» chir ceux qu’ils ont outragés. Telle
33 est la peine portée contre eux par
>3 l’arrêt des juges redoutables ».
Nous avons vu plus haut Platon, dans
son Gorgias(3) , établir la même distinction
entre les coupables., dont les uns
ont commis des fautes que rien ne
peut expier , et dont le supplice doit
éternellement effrayer ceux qui voudraient
les imiter, et dont les autres
ont conservé des souillures, qui peuvent
s’effacer, et qui n’ont pas d’autre moyen
de se délivrer des suites de leurs injustices
, que de subir un châtiment momentané.
Le Juge des enfers, en les en.
voyant les uns et les autres au lieu des
(3) Plat. Gorgias, p. 525.