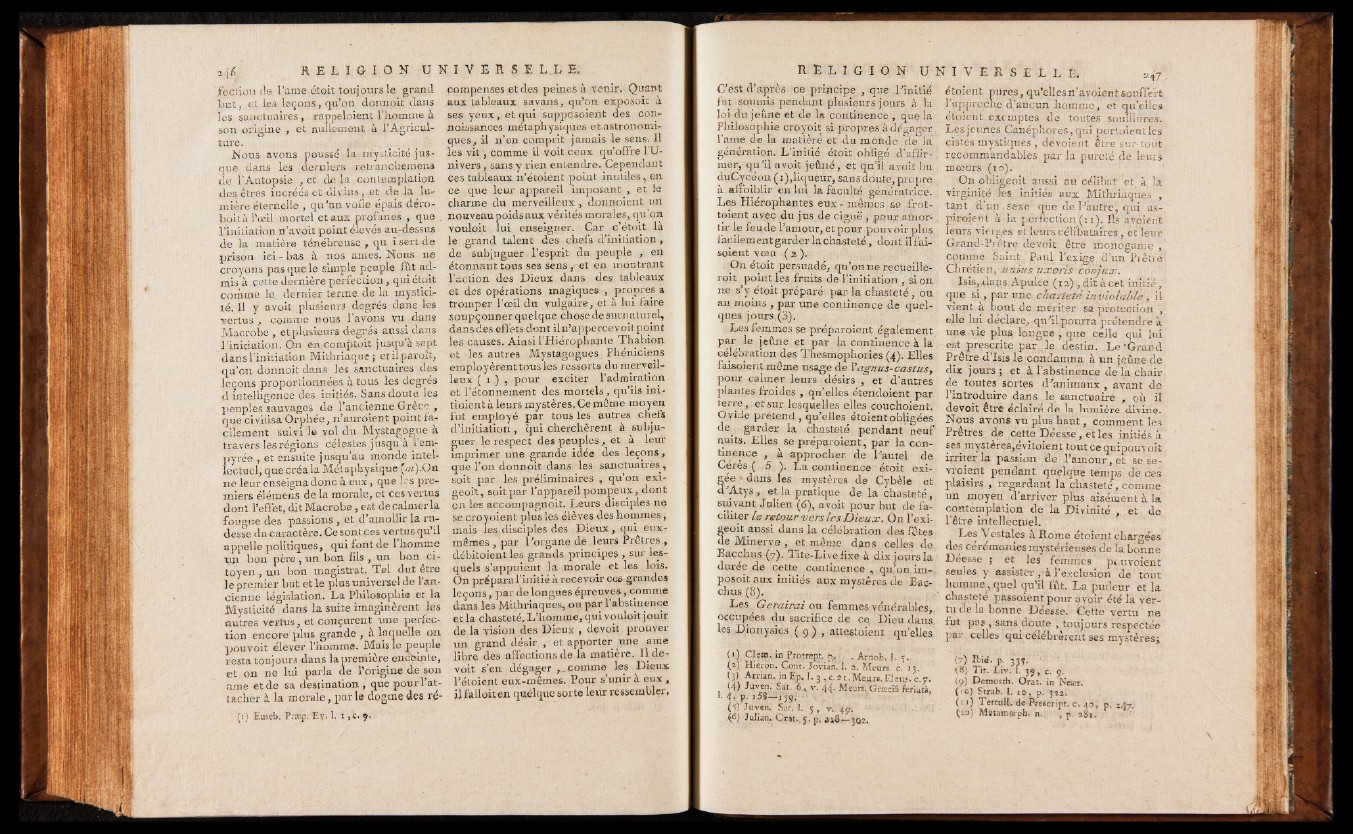
f'ection fie l.’ame était toujours Je grand
Lut, et les leçons, qu’on donnoit dans
les sanctuaires, rappelaient l’homme à
son origine , et nullement à l’Agriculture.
Nous avons poussé la mysticité jusque.
dans les derniers retrancliemens
de l ’Autopsie , et de la contemplation
des êtres iricréés et divins, et de la lumière
éternelle , quJun voile épais dero-
boit à l’oeil mortel et ans profanes , que .
l'initiation n’avoit point élevés aurdessus
de la matière ténébreuse , qu i sert de
prison ici - bas à. nos âmes. Nous ne
croyons pas que le simple peuple fût admis
à cette dernière perfection, qui étoit
comme le. dernier terme de la mysticité.
Il y avoit plusieurs degrés dans les
vertus , comme nous l’ayons vu clans
Macrobe , e.tplusieurs degres aussi dans
l'initiation. On en comptait jusqu’à sept
dans l’initiation Mithriaquc ; etil paraît,
qu’on donnoit dans les sanctuaires des
leçons proportionnées, à tous les degrés
d’intelligence des initiés. Sans doute les
peuples sauvages de l’ancienne Grecs ,
que civilisa Orphée, n’auroient point facilement
suivi 1© vol du Mystagogue a
travers les régions célestes jusqu’à i’em-
pyrée , et ensuite jusqu’au monde intellectuel,
quecréa la Métaphysique (-/«).On
ne leur enseigna donc à eux, que les premiers
élémens de la morale, et ces vertus
dont l’effet, dit Macrobe, est de calmer la
fougue des passions , et d’amollir la rudesse
du caractère. Ce sont ces vertus qu’il
appelle politiques, qui font de 1 homme
un bon père, un bon fils , un bom citoyen
, un bon magistrat. Tel dut etre
le premier but et le plus universel de l’ancienne
législation. La Philosophie et la
Mysticité dans la suite imaginèrent les
autres vertus, et conçurent une perfection
encore plus grande , à laquelle on
pouvoit élever l’homme. Mais le peuple
resta toujours dans la première enceinte,
et on ne lui parla de l’origine de son
ame et de sa destination , que pour l’attacher
à la morale, par le dogme des ré-
■ (i) Euseb. Prsf. Ey. 1. i ,c. 9.
compenses et des peines à venir. Quant
aux tableaux savans, qu’on exposoit à
ses yeux, et qui supposoient des con-
noissances métaphysiques etastronomi-
ques, il n’en comprit jamais le sens. 11
les v it, comme il voit ceux qu’offre l'Univers
, sans y rien entendre. Cependant
ces tableaux n’étaient point inutiles, en
ce que leur appareil imposant , et le
charme du merveilleux , donnoient un
nouveau poids aux vérités morales, qu’on
vouloit lui enseigner. Car c’étoit là
le grand talent des chefs d’initiation,
de subjuguer l ’esprit du peuple , en
étonnant tous ses sens , ut en montrant
l’action des Dieux dans des tableaux
et des opérations magiques , propres à
tromper l’oeil du vulgaire, et à lui faire
soupçonner quelque chose de surnaturel,
dans des effets dont iln’appercevoitpoint
les causes. Ainsi l’Hiérophante Thabion
et les autres Mystagpgues Phéniciens
employèrent tous les ressorts du merveilleux
( 1 ) , pour exciter l’admiration
et l’étonnement des mortels, qu’ils ini-
tioient à leurs mystères,Ce même moyen
fut employé par tous les autres chefs
d’initiation , qui cherchèrent à subjuguer
le respect de» peuples , et à leur
imprimer une grande idée des leçons,
que l’on donnoit dans les sanctuaires,
soit par les préliminaires , qu’on exi-
geoit, soit par l’appareil pompeux, dont
on les accompagnoit. Leurs disciples ne
se croyoient plus les élèves des hommes,
mais les, disciples des Dieux , qui eux-
mêmes , par l ’organe de . leurs Prêtres.,
débitoient les grands principes , sur lesquels
s’appuient la morale et les lois.
On prépara l’initié à recevoir ces grandes
leçons, par de longues épreuves, comme
dans les Mithriaques, ou par l’abstinence
et la chasteté. L’homme, qui vouloit jouir
d.e la vision des Dieux , devoit prouver
un grand désir , et apporter une ame
libre des affections de la matière. Il devoit
s’en dégager , .comme les Dieux
l’étoient eux-memes. Pour s’unir à eux ,
jl falloiten quelque sorte leur ressembler.
est tl apres ce principe , que l ’initié
fût soumis pendant plusieurs jours à la
loi du jeûne et de la continence , que la
Philosophie croyoit si propres à dégager
lame de la matière et du monde cle Ja
génération. L’initié étoit obligé d’affirmer,
qu’il avoit jeûné, et qu’il avoit bu
duCycéon (1),liqueur, sans ddute, propre
à. affoiblir en lui la faculté génératrice..
Les Hiérophantes eux - mêmes se frottaient
avec du jus de ciguë , pour.afnor-
tir le feu de l’amour, et pour pouvoir plus,
facilement garder la chasteté, dont il fai-
soient voeu (a).
Oh étoit persuadé, qu’on ne recueillerait
point les fruits de l’initiation , si on
ne s’y étoit préparé parla chasteté, ou
au moins , par une continence de quelques
jours, (3).
Les femmes se préparoient également
par le jeûne et par la continence à la
célébration des Thesmophories (4). Elles
laisoient même usage de 1’ agnus-castusy
pour calmer leurs désirs , et d’autres
plantes froides , qu’elles étendoient par
terre, et sur lesquelles elles couchoient.
Ovide prétend, qu’elles étaient obligées
de garder la chasteté pendant neuf
nuits. Elles se préparoient, par la continence
, à approcher de l ’autel de
Cérès ( 5 ). La continence était exigée
' dans les mystères de Cybèle et
a ’Atys, et la pratique de la chasteté,
suivant Julien (6), avoit pour but de faciliter
le retour vers les Dieux. On l ’exi-
geoit aussi dans la célébration des fêtes
de Minerve , et même dans celles de
Bacchus (7). Tite-Live fixe à dix jours la
durée de cette continence , .qu’on im-
posoit aux initiés aux mystères de Bae-
chus (8).
Les Gerairai ou femmes vénérables,
occupées du sacrifice de ce, Dieu dans,
les Dionysies ( 9) , attestaient qu’elles
.(>) Clem. in Protrept. p, . Arnob. 1. 5.
O) Hieron. Coût. Joyian. 1. 2. Meurs, c. 13. (3) Arrian. in Ep, 1. 3, c. 21. Meure. Etau. c. 7. (4) Set- 6, v. 44* Meurs,Grimii feriatà, 1. 4> p- >5s— 1J9.
(?) Juven. Sat. 1. 5 , v. 47.
»SS Julian. Crat, 5. p. as8—302.
étaient pures, qu’elles n ’avoient souffert
l’approche d’aucun homme, et qu’elles
étaient, exemptes de toutes souillures.
Les jeunes Canéphores, qui portaient les
cistes mystiques , dévoient être sur-tout
recommandables par moeurs (10), la pureté de leurs
On oblige oit aussi au célibat et. à la
virginité les initiés aux Mithriaques ,
tant Û’un-sexe que de l ’autre, qui aspiraient
à la perfection (11). Ils avoient
leurs viergés et leurs célibataires , et leur
Grand-Prêtre devoit être monogame ,
comme Saint Paul l ’exige’ d’un Pièce
Chrétien, unius uxoris conjux.
Isis, .daps Apulée (12) , dit à cet initié,
que si , par une chasteté inviolable , il
vient à bout de mériter sa protection ,
elle lui déclare, qu’ibpourra prétendre à
une vie plus longue , que celle qui lui
est prescrite par le destin. L e ‘Grand
Praire d’Isis,1e condamna à un jeûne de
dix jours ; et à l’abstinence de la chair
de toutes sortes d’animaux , avant de
l’introduire dans le sanctuaire , ou il
devoit être éclairé de la lumière divine.
Nous avons vu plus haut, comment les
Prêtres de cette Deesse, et les. initiés à
ses mystères,évitaient, tout cequipouVoit
irriter la passion de l’amour, et se sevraient
pendant quelque temps de ces
plaisirs , regardant la chasteté, comme
un moyen d’arriver plus aisément à la
contemplation de la Divinité , et de
l’être intellectuel.
Les Vestales à Rome étoient chargées
des cérémonies mystérieuses de la bonne
Déesse ; et les femmes peuvoient
seules y assister , * à l’exclusion de tout
homme, quel qu’il fût. La pudeur et la
chasteté passoient pour avoir été la vertu
de la bonne Déesse. Cette vertu ne
fut pas, sans doute , toujours respectée
par celles qui célébrèrent ses mystères;,
(7) Ibid. p. 333. '
(8) Tit. Liv. 1. 39, c. 9.
(9) Demostlf. Orat. in Neær.
(■ «) Strab. 1. jo, p. 322.
(i 1) Tertull. de Prescripr. c. 40, p. 2A7;
fia) Mstamarph, n , , p. 281.