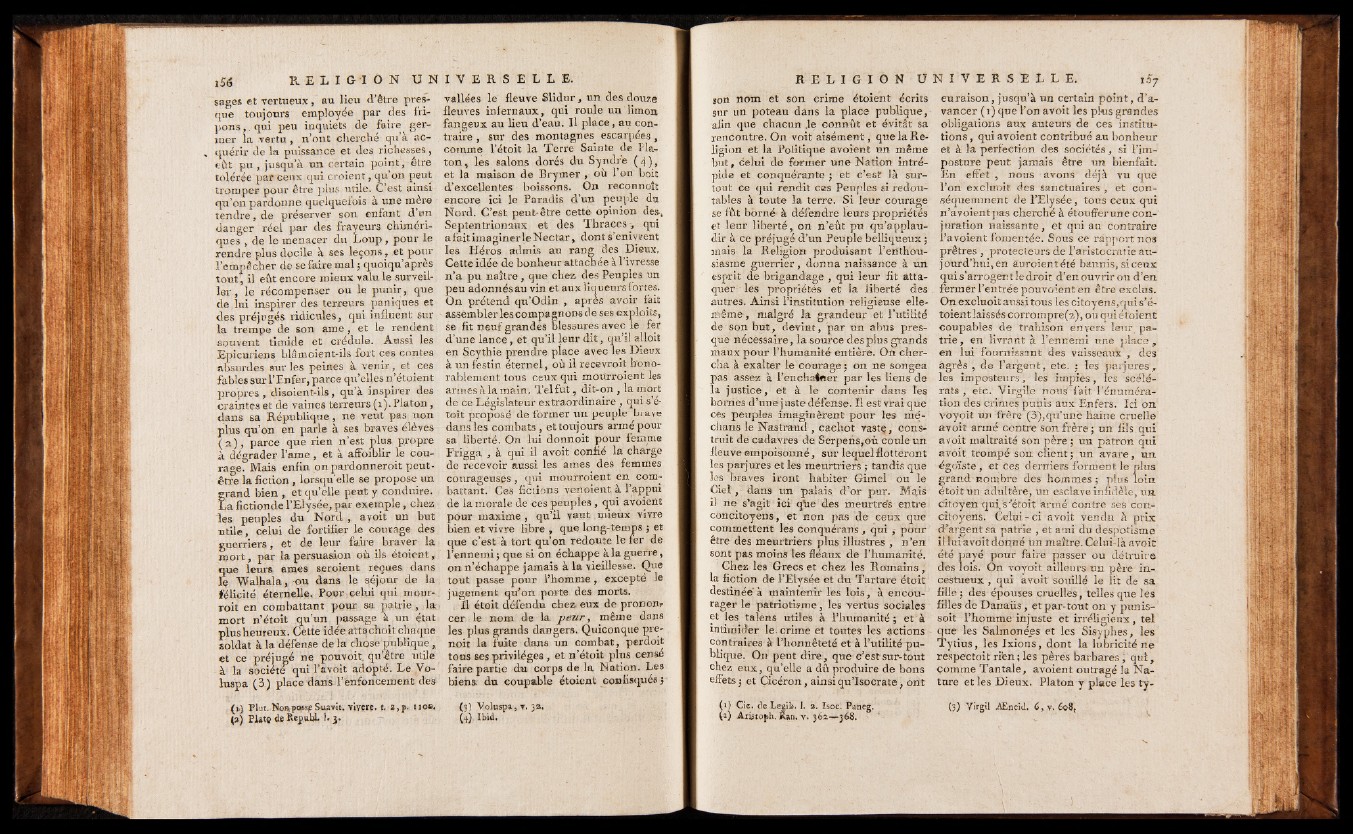
sages et vertueux, au lieu d’être presque
toujours employée par des fripons
,. qui peu inquiets de faire germer
la vertu , n’ont cherché' qu à acquérir
de la puissance et des richesses ,
eût pu , jusqu’à un certain point, être
tolérée par ceux qui croient, qu’on peut
tromper pour être plus utile. C est ainsi
qu’on pardonne quelquefois à une mer«
tendre, de préserver son enfant d’un
danger réel par des frayeurs chimériques
, de le menacer du Loup , pour le
rendre plus docile à ses leçons, et pour
l ’empêcher de se faire mal ; quoiqu’après
tout , il eût encore mieux valu le surveiller
, le récompenser ou le punir, que
de lui inspirer des terreurs paniques et
des préjugés ridicules, qui influent sur
la trempe de son ame, et le rendent
souvent timide et crédule. Aussi les
Epicuriens blâmoient-ils fort ces contes
absurdes sur les peines à venir, et ces
fables sur l ’Enfer, parce qu’elles n’étoient
propres , disoient-ils, qu’à inspirer des
craintes et de vaines terreurs (1). Platon,
dans sa République, ne veut pas non
plus qu’on en parle à ses braves eleves
( a ) , parce que rien n’est plus propre
à dégrader l ’ame , et à affoiblir le courage.
Mais enfin on pardonneroit peut-
être la fiction , lorsqu'elle se propose un
grand bien , et qu’elle peut y conduire.
La fictionde l’Elysée, par exemple, chez
les peuples du Nord , avoit un but
utile, celui de fortifier le courage des
guerriers, et de leur faire braver la
mort, par la persuasion où ils étoient,
que leurs âmes seraient reçues dans
le Walhala, -ou dans le séjour de la
félicité éternelle. Pour j celui qui mourrait
en combattant pour sa patrie, la
mort n’étoit qu’un passage à un état
plusheureux. Cètte idée attachait chaque
soldat à la défense de la chose publique,
et ce préjugé ne pouvdit. qu’être utile
à la société qui l’avoit qdopté. Le Vo-
luspa ( 3 ) place dans l ’ênfonceinent des
Plut, NoniP<^sp Suavit. Yiyere. t. 2,p. no®,
(a) Plate de RejabiL 1. 3.
vallées le fleuve Slidur, un des douze
fleuves infernaux, qui roule un limon
fangeux au lieu d’eau. Il place, au contraire
, sur des montagnes escarpées ,
comme l ’étoit la Terre Sainte de Platon,
les Salons dorés du Syndre (4 ) ,
et la maison de Brymer , où l ’on boit
d’excellentes boissons. On reconnoît
encore ici le Paradis d’un peuple du
Nord. C’est peut-être cette opinion des,
Septentrionaux et des Thraces-, qui
a fait imaginerle Nectar, dont s’enivrent
les Héros admis au rang des Dieux.
Cette idée de bonheur attachée à l’ivresse
n’a pu naître, que chez des Peuples un
peu adonnés au vin et aux liqueurs fortes'.
On prétend qn’Odin , après avoir fait
assembler les compagnons de ses exploits,
se fit neuf grandes blessures avec le fer
d’une lance, et qu’il leur d it, qu’il alloit
en Scythie prendre place avec les Dieux
à un festin éternel, où il recevrait honorablement
tous ceux qui mourraient les
armes à la main. Tel fut , dit-on , la mort
de ce Législateur extraordinaire , qui s’é-
toit proposé de former un peuple brave
dans les combats, et toujours armé pour
sa liberté. On lui donnoit pour femme
Frigga , à qui il avoit confié la charge
de recevoir aussi les âmes des femmes
courageuses , qui mourraient en combattant.
Ces fictions venoient à l’appui
de la morale de ces peuples, qui avoient
pour maxime , qu’il vaut mieux vivre
bien et vivre libre , que long-temps ; et
que c ’est à tort qn’on redoute le fer dé
l ’ennemi ; que si on échappe à la guerre,
on n ’échappe jamais à la vieillesse. Que
tout passe pour l’homme , excepté le
jugement qu’ on porte des morts.
R était défendu chez eux de pronom
cer le nom de la peur, même dans
les plus grands dangers. Quiconque pre-
noit la fuite dans un combat, perdoit
tons ses privilèges , et n’étoit pins censé
faire partie du corps de la Nation. Les
biens du coupable étoient confisqués ;
(3) 'Voluspa , v. 3a.
D). Ibid.
son nom et son crime étoient écrits
sur un poteau dans la place publique,
afin que chacun .le connût et évitât sa
rencontre. On voit aisément, que la Religion
et la Politique avoient un même
but, celui de former une Nation intrépide
et conquérante ; et c’est là surtout
ce qui rendit ces Peuples si redoutables
à toute la terre. Si leur courage
se fût borné à défendre leurs propriétés
et leur liberté, on n’eût pu qu’applaudir
à ce préjugé d’un Peuple belliqueux ;
mais la Religion produisant l’enthousiasme
guerrier, donna naissance.à un
esprit de brigandage , qui leur fit attaquer
les propriétés et la liberté des
autres. Ainsi l’institution religieuse elle-
même , malgré la grandeur et l ’utilité
de son but, devint, par un abus presque
nécessaire, la source des plus grands
maux pour l ’humanité entière. On chercha
à exalter le courage ; on ne songea
pas assez à l’enchaîner par les liens de
la j ustice, et à le contenir dans les
bornes d’unejustedéfense. Il est vrai que
ces peuples imaginèrent pour les médians
le Nastraud , cachot vaste, construit
de cadavres de Serpens,où couleun
fleuve empoisonné, sur lequel flotteront
les parjures et les meurtriers ; tandis que
les braves iront habiter Gimel ou le
C ie l, dans un palais d’or pur. Mais
il ne s’agit ici qùe des meurtre's entre
concitoyens, et non pas de ceux que
commettent les conquérans, qui , pour
être des meurtriers plus illustres , n ’en
font pas moins les fléaux de l ’humanité.
Chez les Grecs et chez les Romains ,
la fiction de l’Elysée et du Tartare étoit
destinée à maintenir les lois, à en cchi-
rager le patriotisme, les vertus sociales
et les talens utiles à l ’humanité; et à
intimider le. crime et toutes les actions
contraires à l ’honnêteté et à l’utilité publique.
On peut dire, que c’est sur-tout
chez eux, qu’elle a dû produire de bons
effets ; et Cicéron, ainsiqu’Isocrate, ont
(1) Cic. de Leaib. I. 2. Isoc. Paheg.
fi) Aristoph. Kan. y. 362—368.
eu raison, jusqu’à un certain point, d’avancer
(1) que l’on avoit les plus grandes
obligations aux auteurs de ces institutions
, qui avoient contribué au bonheur
et à la perfection des sociétés, si l ’imposture
peut jamais être un bienfait.
En effet , ; nous avons déjà vu que
l ’on excliroit des sanctuaires , et conséquemment
de l ’Elysée, tous ceux qui
n’avoientpas cherché à étoufferune conjuration
naissante, et qui au contraire
l ’avoient fomentée. Sous ee rapport nos
prêtres , protecteurs de l ’aristocratie aujourd’hui,
en âuroientété bannis, sicenx
qui s'arrogent le droit d’en ouvrir ou d’en
, fermer l’entrée pouvaient en être exclus.
On excluoit aussi tous les citoyens, qui s’é-
toient laissés corrompre(2), ou quiétoient
coupables de trahison envers leur patrie,
en livrant à l ’ennemi une place ,
en lui fournissant des vaisseaux , des
agrès , de l’argent, ete. ; les parjures,
les imposteurs , les impies, les scélérats
, etc. Virgile nous; fait l ’énumération
des crimes punis aux Enfers. Ici on
voyoit un frère (3) ,qu’une haine cruelle
avoit armé contre son frère ; un fils qui
avoit maltraité son père ; un patron qui
avoit trompé son client; un avare, un
■ égoïste, et Ces derniers forment le plus
grand nombre des hommes; plus loin
étoit un adultère, un esclave infidèle, un
citoyen qui, s’étoit armé contre ses concitoyens.
Celui-ci avoit vendu à prix
d’argent sa patrie , et ami du despotisme
il lui a voit donné un maître. Celui-là avoit
été payé pour faire passer ou détruire
des lois. On voyoit ailleurs un père incestueux
, qui avoit souillé le lit de sa
fille ; dés épouses cruelles, telles que les
filles de Danaüs, et par-tout on y punissait
l ’homme injuste et irréligieux, tel
que les Salmonées et les Sisyphes, les
Tytius, les Ixions, dont la lubricité ne
respectoit riten ; les pères barbares, qui,
comme Tantale, avoient outragé la Nature
et les Dieux. Platon y place les ty-
(3) Virgil Æneiil. 6, v. 6o8,