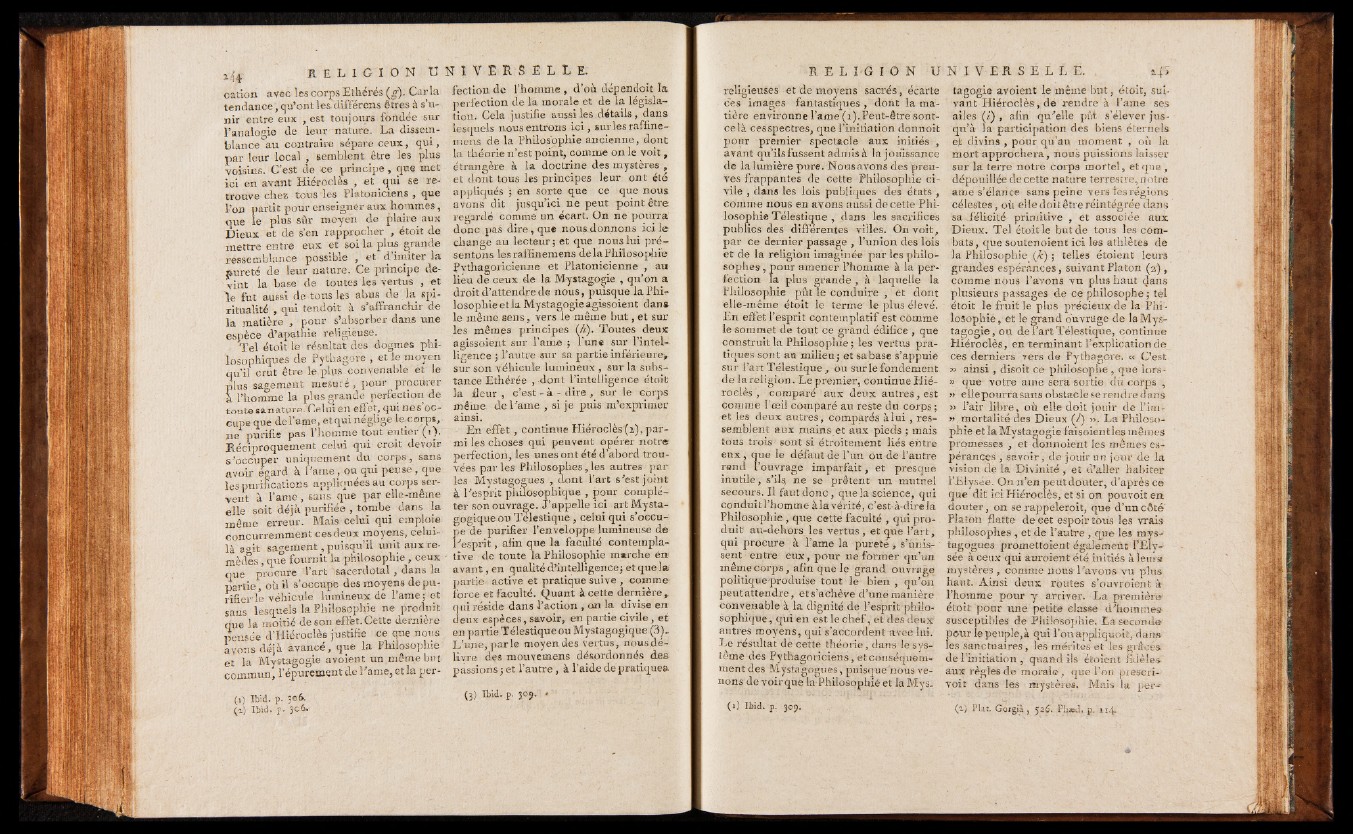
cation avec les corps Ethérés (g). Car la
tendance, qu’ont les différons êtres à s’unir
entre eux , est toujours fondée sur
l’analogie de leur nature. La dissemblance
au contraire sépare ceux, q u i,
par leur local , semblent être les plus
voisins. C’est de ce principe , que met
ici en avant Hiéroclès , et qui se retrouve
chez tous les Platoniciens , que
l’on partit pour enseigner aux hommes,
que le plus sûr moyen de plaire aux
Dieux et de s’en rapprocher , étoit de
mettre entre eux et soi la plus grande
ressemblance possible , et d’imiter la
pureté de leur nature. Ce principe devint
la base de toutes les vertus , et
de fut aussi de tous les abus de la spiritualité
, qui tendoit à s’affranchir de
la matière , pour s’absorber dans une
espèce d’apathie religieuse.
Tel étoit le résultat des dogmes philosophiques
de Pythagore , et le moyen
qu’il crut être le plus convenable et le
plus sagement mesure , pour procurer
à l’homme la plus grande toute sanature. Celui en effepte, rqfueic ntiéosn odce
cupe que de fam é. et qui négligé lexorps,
■ne purifie pas l’homme tout entier'(i).
Réciproquement celui qui croit devoir
s’occuper uniquement du corps, sans
avoir égard à l’ame , ou qui pense, que
les purifications appliquées au corps servent
à l’am e, sans que par elle-même
elle soit déjà purifiée , tombe dans la
même erreur. Mais-celui qui emploie
concurremment cesdenx moyens, celui-
là agit sagement, puisqu’il unit aux remèdes
, que fournit la philosophie, ceux
que procure l’art sacerdotal, dans la
partie, où il s’occupe des moyens de purifier
le véhicule lumineux de l’ame; et
sans lesquels la Philosophie ne produit
que la moitié de son effet. Cette dernière
pensée d’Hiéroclès justifie ce que nous
ayons déjà avancé, que la Philosophie
et la Mystagogie avoient un même but
commun, l’épurement de l’ame, ét la perfection
de l’homme , d’où dépendoit la
perfection de la morale et de la législation.
Cela justifie aussi les détails, dans
lesquels nous entrons ic i, surles.raffine-
mens de la Philosophie ancienne, dont
la théorie n’est point, comme on le voit,
étrangère à la doctrine des mystères ,
et dont tous les principes leur ont été
appliqués ; en sorte que ce que nous
avons dit jusqu’ici ne peut point être
regardé comme un écart. On ne pourra
donc pas dire, que nousdonnons ici le
change au lecteur; et que nous lui présentons
lesraffinemens de la Philosophie
Pythagoricienne et Platonicienne , au
Ùêu de ceux de la Mystagogie , qu’on a
droit d’attendre de nous, puisque la Philosophie
et la Mystagogie agissoient dan a
le même sens, vers le même b u t, et sur
les mêmes principes (h). Toutes deux
agissoient sur l’ame ; l’une sur l’intelligence
; l’autre sur sa partie inférieure-,
sur son véhicule lumineux , sur la substance
Ethérée , dont l’inteiligence étoit
la fleur , c’est - à - dire , sur le corps
même de l’ame , si je puis m’exprimer
ainEsni. effet , continue Hiéroclès'(i),parmi
les choses qui peuvent opérer notre
perfection, les unes ont été d’abord trouvées
par les Philosophes, les autres par
les Mystagogues , dont l’art s’est joint
à l’esprit phüosophique , pour compléter
son ouvrage. J ’appelle ici art Mysta-
gogique ou Telestique , celui qui s’occupe
de purifier l’enveloppe lumineuse de
l’esprit, afin que la faculté contemplative
de toute la Philosophie marche en
avant, en qualité d’intelligence; et que la
partie active et pratique suive , comme
force et faculté. Quant à cette dernière,
qui réside dans l’action , on la divise en
deux espèces, savoir, en partie civile , et
en partie Telestique ou Mystagogique (3).
L’une, parle moyen des vertus, nousdé-
livre des mouvemens désordonnés des
passions ; et l’autre, à l’aide de pratique»
(0 Ibid. p. 3®*- (3} Ibid. p. 305..
(1) Ibid, p- 3e6-
religieuses et de moyens sacrés, écarte
ces images fantastiques , dont la matière
environne l’ame (r). Peut-être sont-
celà cesspectres, que l’initiation donnoit
pour premier spectacle aux initiés ,
avant qu’ils fussent admis à la jouissance
de la lumière pure. Nous avons des preuves
frappantes de cette Philosophie civile
, dans les lois publiques des états ,
comme nous en avons aussi de cette Philosophie
Télestiqne , dans les sacrifices
publics des différentes villes. On voit,
par ce dernier passage , l’union des lois
et de la religion imaginée par les philosophes
, pour amener l’homme à la perfection
la plus grande , à laquelle la
Philosophie pût le conduire , et dont
elle-même étoit le terme le plus élevé.
En effet l’esprit contemplatif est comme
le sommet de tout ce grand édifice , que
construit la Philosophie ; les vertus pratiques
sont an milieu; et sa base s’appuie
sur l’art Telestique, ou sur le fondement
de lareligion. Le premier, continue Hié-
roelès , comparé aux deux autres, est
comme l'oeil comparé au reste du corps;
et les deux autres, comparés à lui , ressemblent
aux mains et aux pieds ; mais
tous trois sont si étroitement liés entre
eux, que le défaut de l’un ou de l’autre
rend l’ouvrage imparfait, et presque
inutile -, s’ils ne se prêtent un mutuel
secours. Il faut donc, que la science, qui
conduit l’homme àla vérité, c’est-à- dire Ja
Philosophie , que cette faculté , qui produit
au-dehors les vertus, et que l’a rt,
qui procure à l’ame la pureté , s’unissent
entre eux, pour ne former qu’un
même corps, afin que le grand ouvrage
politique produise tout le bien , qu’on
peut attendre, et s’achève d’une manière
convenable à la dignité de l’esprit philosophique
, qui en est le chef, et des deux
antres moyens, qui s’accordent avec lui.
Le résultat de cette théorie, dans le système
des Pythagoriciens, etconséquem-
ment des Mystagogues, puisque nous venons
de voir que la Philosophié et la Mys.
(1) Ibid. p. 309.
tagogie avoient le même but, étoit, suivant
Hiéroclès, de rendre à l’ame ses
ailes (i) , afin qu’elle pût s’élever jusqu’à
la participation des biens éternels
e£ divins , pour qu’au moment , où la
mort approchera, nous puissions laisser
sur la terre notre corps mortel, et que ,
dépouilléedecette nature terrestre,notre
ame s’élance sans peine vers l'es régions
célestes , où elle doit être réintégrée dans
sa félicité primitive , et associée aux
Dieux. Tel étoit le but de tous les combats
, que soutenoient ici les athlètes de
la Philosophie (E) ; telles étoient leurs
grandes espérances, suivant Platon (3') ,
comme nous l’avons vu plus haut dans
plusieurs passages de ce philosophe ; tel
étoit le fruit le plus précieux de la Phi -
losophié, et le grand ouvrage de la Mystagogie,
ou deT’aît Télestiqne, continue
Hiéroclès, en terminant l’explication de
ces derniers vers de Pythagore. « C’est
» ainsi , disoit ce philosophe , que lors-
» que votre ame sera sortie du corps ,
» elle pourra sans obstacle se ren dre dans
» l’air libre, où elle doit jouir de l’irn-
» mortalité des Dieux (/) ». La Philosophie
etla Mystagogie faisoientles mêmes
promesses , et aonnoient les mêmes espérances
, savoir, de jouir un jour de la
vision de la Divinité, et d’aller habiter
l’Elysée. On n ’en peut douter, d’après ce
ue dit' ici Hiéroclès, et si on pouvoit en
outer, on se rappeleroit, que d’un côté
Platon flatte de eet espoir tous les vrais
philosophes , et de l’autre , que les mystagogues
promettoient également l'Elysée
à ceux qui auroient été initiés à leurs
mystères, comme nous'l’avons vu plus
haut. Ainsi deux routes s’ouvroîent à
l’homme pour y arriver. La première
étoit pour une petite classe d ’homme»
susceptibles de Philosophie. La seconde
pour le peuple,à qui l’onappliquoit, dans
les sanctuaires, les mérites et les grâces
de 1: ’initiation, quand ils étoient fidèles
aux règles de morale, que l’on prescri-
voit dans les mystères. Mais la per-
(2) Plat. Gorgià, 52$. Piiæd, p. 114.