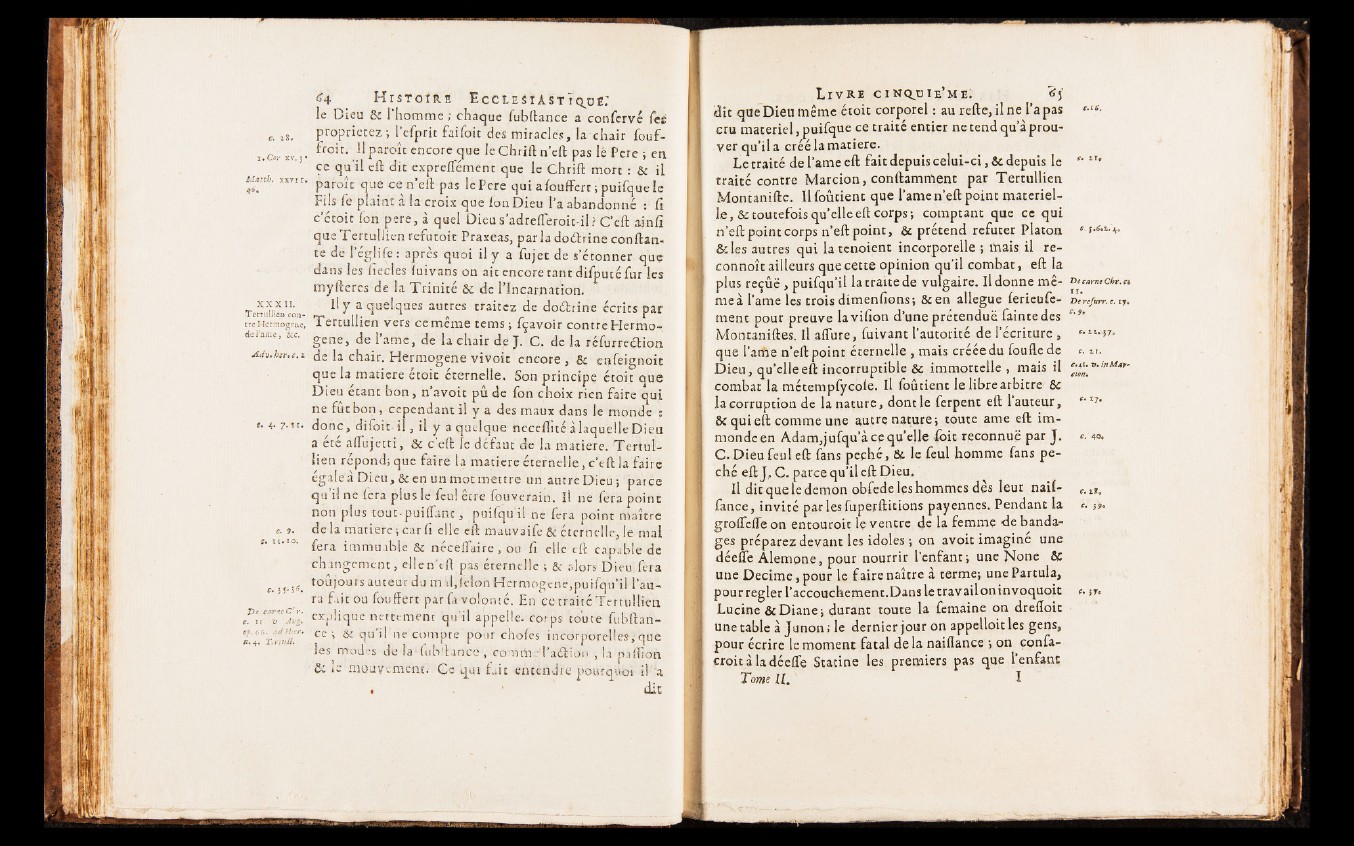
c. 1 8»
i* Cor xy. j •
Mattb. x xv i r. 4<f.
X X X I I .
Termine« contre
Hermogene,
de l’ame, &c.
Adv» her• c. i
ff. 4» 7,'ïr.
e. 9»
S• 11. io.
r. 31- 3^
Z>f carte C< r,
c. ir. V Aug,
e?. 66. ad Hier•
». 4. Ter tu il.
64 H i s t o î r e E c c l e s i a s t i q u e :
le Dieu 8c 1 homme ; chaque fubftance a confcrvé fec
proprietez ; l’efpric faifoit des miracles, la chair fouf-
froir. Il paroît encore que le Chrift n’eft pas lé Pere ; en
ce qu’il eft dit expreffément que le Chrift mort : ôc il
paroîc que ce n’eft pas le Pere qui aiouffert ; puifquele
Fils fe plaint à la croix que ion Dieu l’a abandonné : iî
c’écoit fon pere, à quel D ieu s ’adrefferoit-il? C'eft ainfi
que Tertullien refutoic Praxeas, par la doétrine confiante
de 1 eglife : après quoi il y a fujet de s’étonner que
dans les fîecles fuivans on ait encore tant difputé fur les
myileres de la Trin ité 8c de l’Incarnation.
Il y a quelques autres traitez de do&rine écrits par
Tertullien vers ce même tems ; fçavoir contre Hermogene
, de 1 ame, de la chair de J . C. de la réfurreélion
de la chair. Hermogene vivoic en core , 8c enfeignoit
que la maticre étoic éternelle. Son principe étoit que
Dieu étant bon , n’avoit pu de fon choix rien faire qui
ne fût bon, cependant il y a des maux dans le monde :
don c , difoit i l , il y a quelque neceftité ¿laquelle Dieu
a été aiTujetti, ôc c ’eft fe défaut de la matière. Te rtullien
répond; que faire la matière éternelle, c’eft la faire
égale à Dieu, ôc en un mot mettre un autre Dieu; parce
qu’il ne fera plus le feu! être fouverain. Il ne fera point
non plus tout-puiffant, puifqu il ne fera point maître
delà mariere; car fi elle eft mauvaife 8c éternelle, le mal
fera immuable 8c néceifaire , ou fi elle eft capable de
changement, ellen’tft pas éternelle ; & alors Dieu fera
toujours auteur du m fificlon Hermogene,puifqu’il l’aura
f. fit ou foufiert parfa volonté. En ce traité Tertullien
explique nettement qu'il appelle, corps toute fubftance
; & qu’il ne compte pour choies incorporelles-,'que
les modes de la-lubfta-nce, comme l’aélion , la paillon
8c te mouvement. Ce qui fait entendre pourquoi il a
. dit
L i v r e c i n q j s i e ’ m e . <>j
dit queDieu même étoit corporel : au refte, il ne Tapas
cru matériel, puifque ce traité entier ne tend qu’à prouver
qu’il a créé la matière.
Le traité de l’ame eft fait depuis c e lu i-c i, 8c depuis le
traité contre Marcion , conftamrftent par Tertullien
Montanifte. Il foûtient que lame n’eft point matérielle
, 8c toutefois qu’elle eft corps; comptant que ce qui
n’eft point corps n’eft point, ôc prétend réfuter Platon
ôcles autres qui la tenoient incorporelle ; friais il re-
connoît ailleurs que cette opinion qu’il combat, eft la
plus reçue , puifqu’il la traite de vulgaire, il donne même
à l’ame les trois dimenfions; 8c en allégué ierieufe-
menc pour preuve lavifion d’une prétendue faintedes
Monraniftes. Il affûte, fuivant l’autorité de l’écriture ,
que l’arfie n’eft point éternelle , mais créée du fouile de
D ieu , qu’elle eft incorruptible ôc immortelle , mais il
combat la métempfycoie. Il foûtient le libre arbitre 8c
la corruption de la nature, dont le ferpent eft l’auteur,
8c qui eft comme une autre nature; toute ame eft im monde
en Adam,jufqu’à ce qu’elle fbit reconnue par J .
C. Dieu feul eft fans pephé, 8i le feul homme fans péché
e f t j, C. parce qu’il eft Dieu.
Il dit que le démon obfedelçs hommes dès leur naii-
fance, in vité parlesfuperfthions payennes. Pendant la
groffeffe on entouroit le ventre de la femme de bandages
préparez devant les idoles ; on avoir imagine une
déeffe Alempne, pour nourrir l’enfant; une None 8c
une D e c im e , pour le f aire naître à terme; une Partula,
pourregler l’accouchement.Dans le travailoninvoquoit
Lucine & Diane; durant toute la femaine on drefloit
une table à Ju n o n ; le dernier jour on appelloitles gens,
pour écrire le moment fatal de la naiflance ; on çonfa-
croità la déeffe Statine les prerniers pas que l’enfant
Tome II. ' I
CA6.
e» zi»
c. 4»
De carne Cfir. a
il*
De refurr. c. 17*
c. 9,
* . 1 1 . 3 7 .
C. Z l .
c.au n. inMat'
don.
e» 17 .
e. 40«
C» i*f
c.
}7«