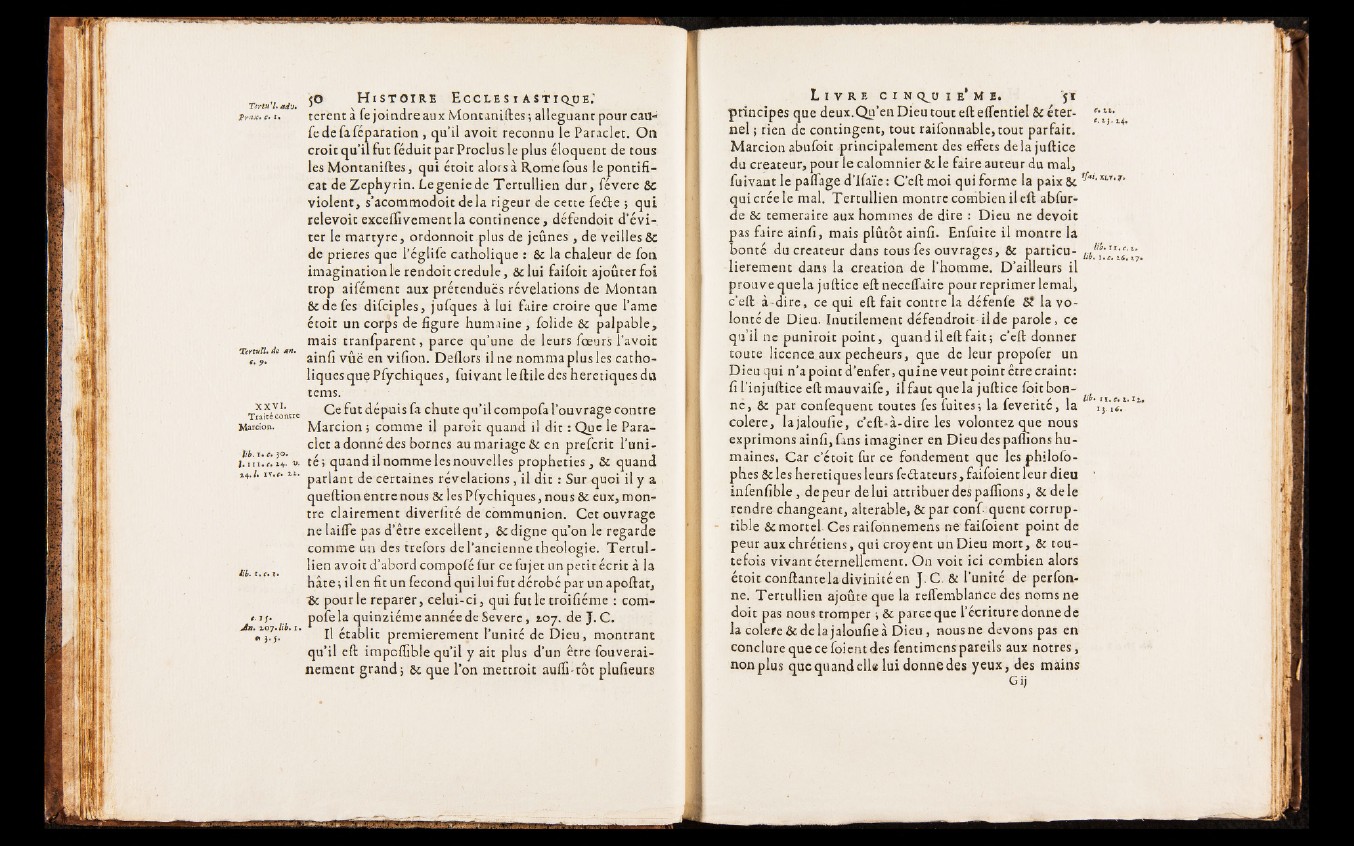
Ter tu11. adv»
^ 1«
TertuîU de an,
§ 9»
X X V I .
Traité contre
Marcion.
lib. i . €• }©•
J. 1 1 1 . c» 14* v ‘
1 4 ,/. iY.f. i i .
i.r. r.
* JS' JLn„ 10 7 . lib» i .
* 3-5-
50 H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e ;
terentà fe joindre aux Montaniftes; alléguant pour cau-
fe de fa réparation , qu'il avoir reconnu Te Parader. On
croit qu’il fut féduit par Proclus le plus éloquent de tous
les Montaniftes , qui étoit alors à Rome fous le pontificat
de Zephyrin. L eg en ied e Tertullien dur, févere 8C
v io len t, s’acommodoit delà rigeur de cette feéte ; qui
relevoit exceffivementla continence, défendoit d 'é v iter
le m arty re , ordonnoit plus de je û n e s , de veilles 8c
de prières que l’églife catholique : 8c la chaleur de fon
imagination le rendoitcredule, âc lui faiioit ajoûterfoi
trop aifément aux prétendues révélations de Montan
8c de fes difciples, jufques à lui faire croire que l’ame
étoit un corps de figure humaine , folide 8c palpable,
mais tranfparent, parce qu’une de leurs foeurs l’avoit
ainfi vûë en vifion. Dellors il ne nomma plus les catholiques
que Pfychiques, fuivant le ftile des heretiques du
teins.
Ce fut dépuis fa chute qu’il compofa l’ouvrage contre
Marcion ; comme il paroît quand il dit : Que le Para-
c letadonnédes bornes au mariage 8c en prefcrit l’unité
; quand il nomme les nouvelles prophéties, & quand
parlant de certaines révélations , il dit : Sur quoi il y a
queftion entre nous & les Pfychiques, nous & eux, montre
clairement diverfité de communion. Cet ouvrage
ne laifTe pas d’être excellent, & digne qu’on le regarde
comme un des trefors de l’ancienne théologie. T e r tu llien
avoir d’abord compofé fur ce fujet un petit écrit à la
hâte ; il en fit un fécond qui lui fut dérobé par un apoftat,
& pour le reparer, c e lu i-c i, qui fut le troifiéme : com-
pofe la quinzième année de Severc, 107. de J . C.
Il établit premièrement l’unité de Dieu, montrant
qu’il efb impcifible qu’il y ait plus d’un être fouverai-
nement gran d; 8c que l’on mettroit aufil-tôt plufieurs
L i v r e c m q^u i e* m b . 51
principes que deux.Qu’en Dieu tout eft effentiel 8c éter-
nel ; rien de contingent, tout raifonnable, tout parfait.
Marcion abufoit principalement des effets delajuftice
du créateur, pour le calomnier 8c le faire auteur du mal,
fuivant le paflage d’ifaïe : C ’eft moi qui forme la paix 5c f y KLr' r'
qui crée le mal. Tertullien montre combien il eft abfur-
de 8c temeraire aux hommes de dire : Dieu ne devoit
pas faire ain fi, mais plutôt ainfi. Enfuite il montre la
bonté du créateur dans tous fes ouvrage s, 8c particu- u/ !^
lierement dans la création de l’homme. D ’ailleurs il
prouve quela juftice eft neceifaire pour reprimer lemal,
c’eft à -d ire , ce qui eft fait contre la défenfe 8? la v o lonté
de Dieu. Inutilement défendroit il de parole, ce
qu’il ne puniroit point, quand il eft fa it; c’eft donner
toute licence aux pecheurs, que de leur propofer un
Dieu qui n’ a point d’en fe r, qui ne veut point être craint:
fi l’injuftice eft mauvaife, il faut quela juftice foit bon-
n é , 8c par confequent toutes fes fuites; la fev erité, la ij'u .1' i"
colere, lajaloufie, c’eft-à-dire les volontez que nous
exprimons ainfi, fans imaginer en Dieu des pallions humaines.
Car c’étoit fur ce fondement que les philofo-
phes 8c les heretiques leurs fedfateurs, faifoient leur dieu '
infenfible, de peur de lui attribuer des paifions, 8c de le
rendre changeant, altérable, 8c par conf quent corruptible
8c mortel. Ces raifonnemens ne faifoient point de
peur aux chrétiens, qui croyent un Dieu mort, 8c toutefois
vivant éternellement. On voit ici combien alors
étoit confiante la divinité en J .C . & l’unité de perfon-
ne. Tertullien ajoûte que la reffemblartce des noms ne
doit pas nous tromper ; 8c parce que l’écriture donne de
la colefe 8c de lajaloufie à D ie u , nous ne devons pas en
conclure que ce foient des fentimens pareils aux nôtres,
non plus que quand elle lui donne des y eu x , des mains