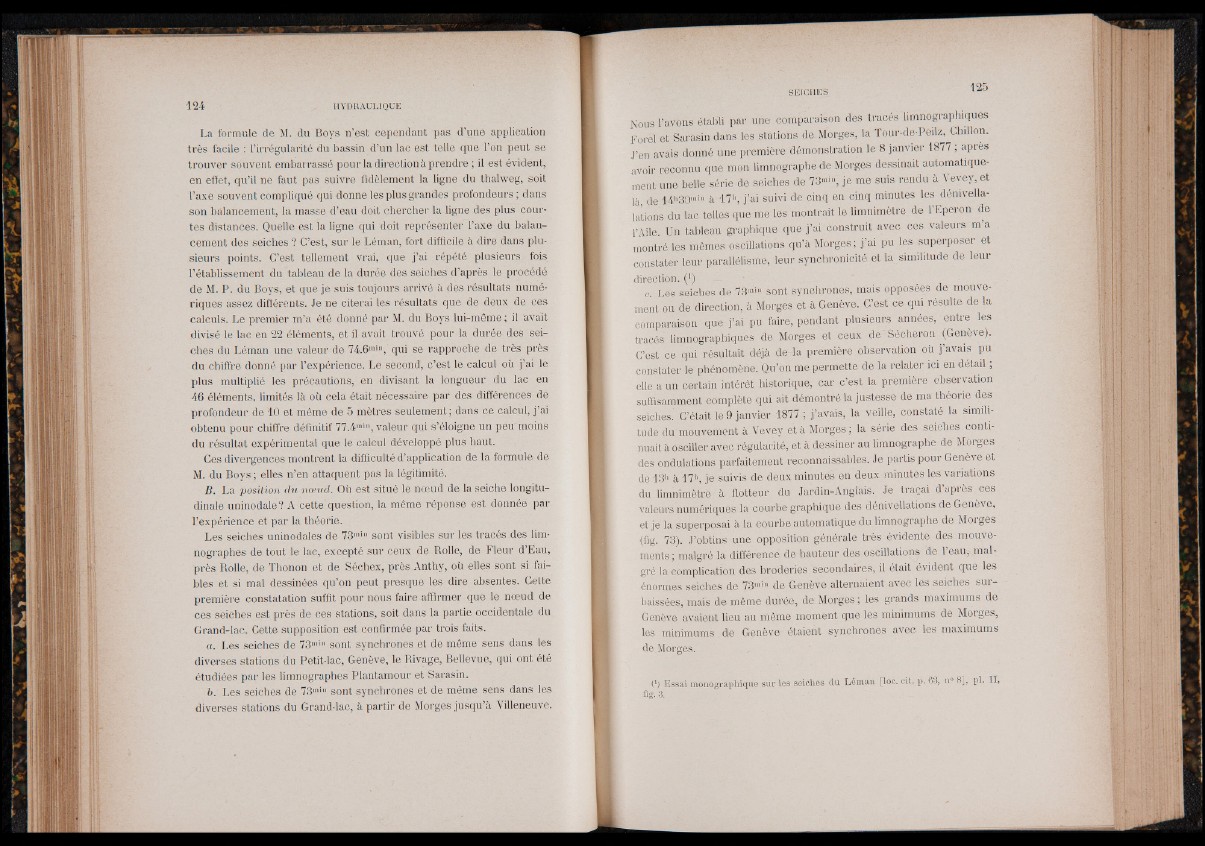
La formule de M. du Boys n’est cependant pas d’une application
très facile : l’irrégularité du bassin d’un lac est telle que l’on peut se
trouver souvent embarrassé pour la direction à prendre ; il est évident,
en effet, qu’il ne faut pas suivre fidèlement la ligne du thalweg, soit
l’axe souvent compliqué qui donne les plus grandes profondeurs ; dans
son balancement, la masse d’eau doit chercher la ligne dés plus courtes
distances. Quelle est la ligne qui doit représenter l’axe du balancement
des seiches ? C’est, sur le Léman, fort difficile à dir.e dans plusieurs
points. C’est tellement vrai, que j’ai répété plusieurs fois
l’établissement du tableau de la durée des seiches d’après le procédé
de M. P. du Boys, et que je suis toujours arrivé à des résultats numériques
assez différents. Je ne citerai les résultats que de deux de ces
calculs. Le premier m’a été donné par M. du Boys lui-même; il avait
divisé le lac en 22 éléments, et il avait trouvé pour la durée des seiches
du Léman une valeur de 74.6min, qui se rapproche de très près
du chiffre donné par l’expérience. Le second, c’est le calcul où j’ai le
plus multiplié les précautions, en divisant la longueur du lac en
46 éléments, limités là où cela était nécessaire par des différences de
profondeur de 10 et même de 5 mètres seulement; dans ce calcul, j’ai
obtenu pour chiffre définitif 77.4»«, valeur qui s’éloigne un peu'moins
du résultat expérimental que le calcul développé plus haut.
Ces divergences montrent la difficulté d’application de la formule de
M. du Boys ; elles n’en attaquent pas la légitimité.
B. La position du noeud. Où est situé le noeud de la seiche longitudinale
uninodale? A cette question, la même réponse est donnée par
l’expérience et par la théorie.
Les seiches uninodales de 73»« sont visibles sur les tracés des lim-
nographes de tout le lac, excepté sur ceux de Rolle, de Fleur d’Eau,
près Rolle, de Thonon et de Séchex, près Anthy, où elles sont si faibles
et si mal dessinées qu’on peut presque les dire absentes. Cette
première constatation suffit pour nous faire affirmer que le noeud de
ces seiches est près de ces stations, soit dans la partie occidentale du
Grand-lac. Cette supposition est confirmée par trois faits.
a. Les seiches de 73min sont synchrones et de même sens dans les
diverses stations du Petit-lac, Genève, le Rivage, Bellevue, qui ont été
étudiées par les limnographes Plantamour et Sarasin.
b. Les seiches de 73min sont synchrones et de même sens dans les
diverses stations du Grand-lac, à partir de Morges jusqu’à Villeneuve.
Nous l’avons établi par une comparaison des tracés hmnographiques
Forel et Sarasin dans les stations de Morges, la Tour-de-Peilz, Chillon.
J’en avais donné une première démonstration le 8 janvier 1877 ; après
avoir reconnu que mon limnographe de Morges dessinait automatiquement
une belle série dé seiches de 73»«, je me suis rendu à Vevey, et
là, de 14''30»« à 1 7 \ j’ai suivi de cinq en cinq minutes les d é n iv e llations
du lac telles que me les montrait le limnimètre de l’Eperon de
l’Aile. Un tableau graphique que j’ai construit avec ces valeurs m’a
montré les mêmes oscillations qu’à Morges; j’ai pu les superposer et
constater leur parallélisme, leur synchronicité et la similitude de leur
direction. (1) — \ V . ' . ■
c. Les seiches de 73»« sont synchrones, mais opposées de mouvement
ou-de direction, à Morges et à Genève. C’est ce qui résulte de là
comparaison que j’ai pu faire, pendant plusieurs an n é e s/ entre les
tracés Hmnographiques de Morges et ceux de~Sécheron (Geneve).
C’est ce qui résultait déjà de-la première observation où j’avais pu
constater le phénomène. Qu’on me permette de la relater ici en détail ;
elle a un certain intérêt historique,yçar c’est la première observation
suffisamment complète qui ait démontré la justesse de ma théorie des
seiches.' C’était le 9 janvier 1877 ; j’avais, la veille, constaté la similitude
du mouvement à Vevey et à Morges ; la série des seiches continuait
à osciller avaé régularité, et à dessiner au limnographe de Morges
des ondulations parfaitement reconnaissables. Je partis pour Genève et
de 13h à 17h, je suivis de deux minutés en deux minutes les variations
du limnimètre à flotteur du Jardin-Anglais. Je traçai d’après ces
valeurs numériques la courbe graphique des dénivellations de Genève,
et je la superposai à.la courbe automatique du limnographe de Morges
(fig. 73). J’obtins une opposition générale très évidente des mouvements
; malgré la différence de hauteur des oscillations de 1 eau,- malgré
la complication des broderies secondaires, il était évident que les
énormes seiches de 73»« de Genève alternaient avec les seiches surbaissées,
mais de même durée, de Morges ; les grands maximums de
Genève avaient lieu au même moment que les minimums de Morges,
les minimums . de Genève étaient synchrones avec les maximums
de.Morges.
I1) .Essai monographique sur les séiches du Léman [loc. cit. p. 63, n° 8], pl. II,
àg. 3.