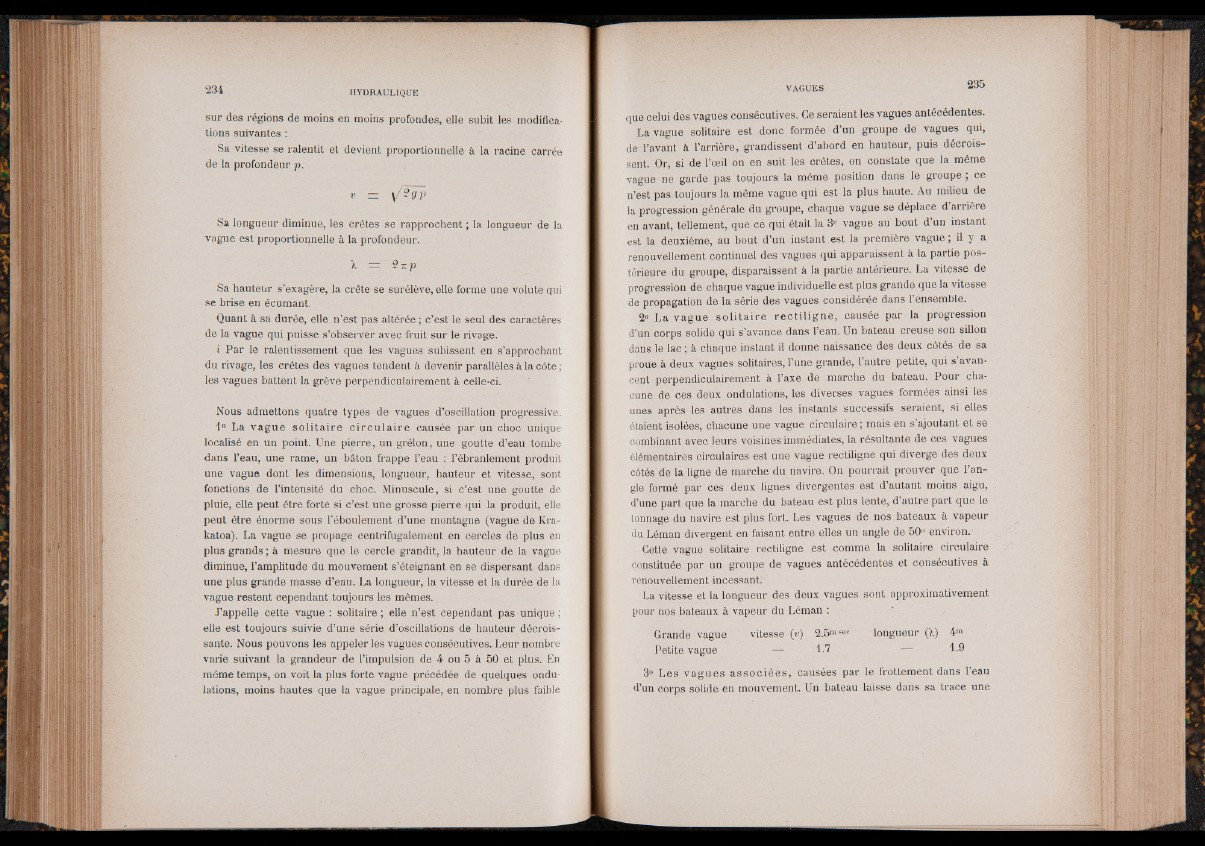
sur des régions de moins en moins profondes, elle subit les modifications
suivantes :
Sa vitesse se ralentit et devient proportionnelle à la racine carrée
de la profondeur p.
V gp
Sa longueur diminue, les crêtes se rapprochent ; la longueur de la
vague est proportionnelle à la profondeur.
X te ;' 2 z p
Sa hauteur s’exagère, la crête se surélève, elle forme une volute qui
se brise en écumânt.
Quant à sa durée, elle n’est pas altérée ; c’est le seul des caractères
de la vague qui puisse s’observer avec fruit sur le rivage.
i Par le ralentissement que les vagues subissent en s’approchant
du rivage, les crêtes des vagues tendent à devenir parallèles à la côte ;
les vagues battent la grève perpendiculairement à celle-ci.
Nous admettons quatre types de vagues d’oscillation progressive.
1° La v a g u e s o lita ir e c i r c u la i r e causée par un choc unique
localisé en un point. Une pierre, un grêlon, une goutte d’eau tombe
dans l’eau, une rame, un bâton frappe l’eau : l’ébranlement produit
une vague dont les dimensions, longueur, hauteur et vitesse, sont
fonctions de l’intensité du choc. Minuscule, si c’est une goutte de
pluie, elle peut être forte si c’est une grosse pierre qui la produit, elle
peut être énorme sous l’éboulement d’une montagne (vague de Kra-
katoa). La vague se propage centrifugalement en cercles de plus en
plus grands ; à mesure que le cercle grandit, la hauteur de la vague
diminue, l’amplitude du mouvement s’éteignant en se dispersant dans
une plus grande masse d’eau. La longueur, la vitesse et la durée de la
vague restent cependant toujours les mêmes.
J’appelle cette vague : solitaire ; elle n’est cependant pas unique ;
elle est toujours suivie d’une série d’oscillations de hauteur décroissante.
Nous pouvons les appeler les vagues consécutives. Leur nombre
varie suivant la grandeur de l’impulsion de 4 ou 5 à 50 et plus. En
même temps, on voit la plus forte vague précédée de quelques ondulations,
moins hautes que la vague principale, en nombre plus faible
que celui des vagues consécutives. Ce seraient les vagues antécédentes.
La vague solitaire est donc formée d’un groupe de vagues qui,
de l’avant à l’arrière, grandissent d’abord en hauteur, puis décroissent.
Or, si de l’oeil on en suit les crêtes, on constate que la même
vague ne garde pas toujours la même position dans le groupe ; ce
n’est pas toujours la même vague qui est la plus haute. Au milieu de
la progression générale du groupe, chaque vague se déplace d’arrière
en avant, tellement, que ce qui était la 3e vague au bout d’un instant
est la deuxième, au bout d’un instant est la première vague; il y a
renouvellement continuel des vagues qui apparaissent à la partie postérieure
du groupe, disparaissent à la partie antérieure. La vitesse de
progression de chaque vague individuelle est plus grande que la vitesse
de propagation de la série des vagues considérée dans l’ensemble.
2° La v ag u e s o lita ir e r e c tilig n e , causée par la progression
d’un corps solide qui s’avance dans l’eau. Un bateau creuse son sillon
dans le lac ; à chaque instant il donne naissance des deux côtés de sa
proue à deux vagues solitaires, l’une grande, l’autre petite, qui s’avancent
perpendiculairement à l’axe de marche du bateau. Pour chacune
de ces deux ondulations, les diverses vagues formées ainsi les
unes après les autres dans les instants successifs seraient, si elles
étaient isolées, chacune une vague circulaire; mais en s’ajoutant et se
combinant avec leurs voisines immédiates, la résultante de ces vagues
élémentaires circulaires est une vague rectiligne qui diverge des deux
côtés de la ligne de marche du navire. On pourrait prouver que l’angle
formé par ces deux lignes divergentes est d’autant moins aigu,
d’une part que la marche du bateau est plus lente, d’autre part que le
tonnage du navire est plus fort. Les vagues de nos bateaux à vapeur
du Léman divergent en faisant entre elles un angle de 50° environ.
Cette vague solitaire rectiligne est comme la solitaire circulaire
constituée par un groupe de vagues antécédentes et consécutives à
renouvellement incessant.
La vitesse et la longueur des deux vagues sont approximativement
pour nos bateaux à vapeur du Léman :
Grande vague vitesse (v) 2.5“ sec longueur (X) 4“
Petite vague — 1.7 — 1-9
3° Les v a g u e s a s s o c ié e s , causées par le frottement dans l’eau
d’un corps solide en mouvement. Un bateau laisse dans sa trace une