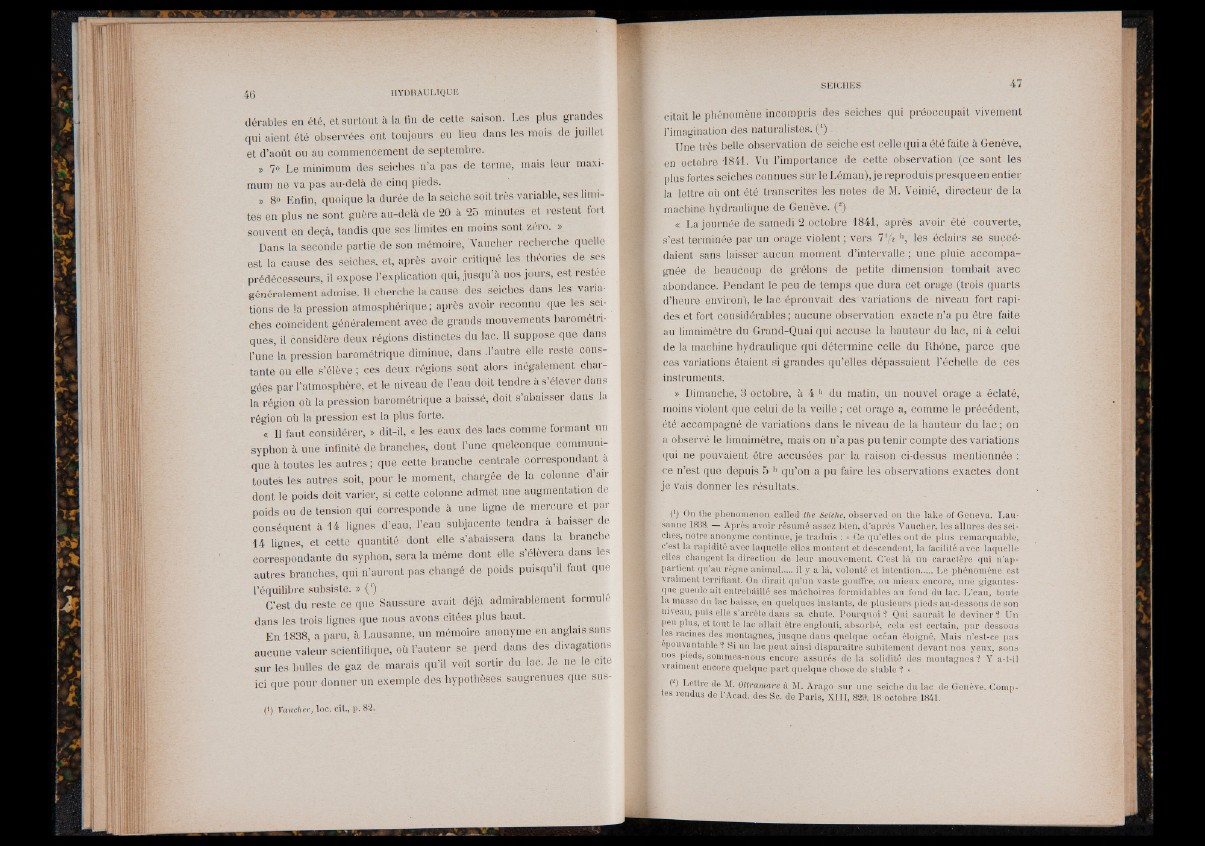
46 I1YDRAULTQUE
dérables en été, et surtout à la fin de cette saison. Les plus grandes
qui aient été observées ont toujours eu lieu dans les mois de juillet
et d’août ou au commencement de septembre.
» 7° Le minimum des seiches n’a pas de terme, mais leui maximum
ne va pas au-delà de cinq pieds.
» 8° Enfin, q u o i q u e l a durée de la seiche soit très variable, ses limites
en plus ne sont guère au-delà de 20 à 25 minutes et restent foit
souvent en deçà, tandis que ses limites en moins sont zéro. ».
Dans la seconde partie de son mémoire, Vaucher recherche quelle
est la cause des seiches, et, après avoir critiqué les théories de ses
prédécesseurs, il expose l’explication qui, jusqu’à nos jours, est restée
généralement admise. 1 cherche la cause des seiches dans les variations
de la pression atmosphérique; après avoir reconnu que les seiches
coïncident généralement avec de grands mouvements barométriques,
il considère deux régions distinctes du lac. 11 suppose que dans
l’une la pression barométrique diminue, dans .l’autre elle reste constante
ou elle s’élève ; ces deux régions sont alors inégalement chargées
par l’atmosphère, et le niveau de l’eau doit tendre à s’élever dans
la région où la pression barométrique a baissé, doit s’abaisser dans la
région où la pression est la plus forte.
« 11 faut considérer, » dit-il, « les eaux des lacs comme formant un
syphon à une infinité de branches, dont l’une quelconque communique
à toutes les autres; que cette branche centrale,correspondant à
toutes les autres soit, pour le moment, chargée de la colonne d’air
dont le poids doit varier, si cette colonne admet une augmentation de
poids ou de tension qui corresponde à une ligné de mercure et par-
conséquent à U lignes d’eau, l’eau subjacente tendra à baisser de
-14 lignes, et cette quantité dont elle s’abaissera dans la branche
correspondante du syphon, sera la même dont elle s’élèvera dans les
autres branches, qui n’auront-pas changé de poids puisqu’il faut que
l’équilibre subsiste. » 0 -
C’est du reste ce que Saussure avait déjà admirablement formule
dans les trois lignes que nous avons citées plus haut.
En 1838, a paru, à Lausanne, un mémoire anonyme en anglais sans
aucune valeur scientifique, où l’auteur sa ,p e rd dans des divagations
sur les bulles de gaz de marais qu’il voit sortir du lac. Je ne le cite
ici que pour donner un exemple des hypothèses saugrenues que sus(
1) Vaucher, loo. cit., p. 82.
citait le phénomène incompris des seiches qui préoccupait vivement
l’imagination des naturalistes. (*)
Une très belle observation de seiche est celle qui a été faite à Genève,
en octobre 1841. Vu l’importance de cette observation (ce sont les
plus fortes seiches connues sur le Léman), je reproduis presqueen entier
la lettre où ont été .transcrites les notes- de M. Veinié, directeur de la
machine hydraulique de Genève. (2)
« La journée de samedi 2 octobre 1841, après avoir été couverte,
s’est terminée par un orage violent; vers 7 l/a h, les éclairs se succédaient
sans laisser aucun moment d’intervalle ; une pluie accompagnée
de beaucoup de grêlons de petite dimension tombait avec
abondance. Pendant le peu de temps que dura cet orage (trois quarts
d’heure environ), le lac éprouvait des variations de niveau fort rapides
et fort considérables; aucune observation exacte n’a pu être faite
au limnimètre du Grand-Quai qui accuse la hauteur du lac, ni à celui
de la machine hydraulique qui détermine celle du Rhône, parce que
ces variations étaient si grandes qu’elles dépassaient l’échelle de ces
instruments.
» Dimanche, 3 octobre, à 4 11 du matin, un nouvel orage a éclaté,
moins violent que celui de la veille ; cet orage a, comme le précédent,
été accompagné de variations dans le niveau de la hauteur du lac; on
a observé le limnimètre, mais on n’a pas pu tenir compte des variations
qui ne pouvaient être accusées par la raison ci-dessus mentionnée :
ce n’est que depuis 5 h qu’on a pu faire les observations exactes dont
je Vais donner les résultats.
(!) On the phenomenon called Ihe Seiche, observed on the lake of Geneva. L au sanne
1888. — Après avoir résumé assez bien, d’après Vaucher, les allures des seiches,
notre anonyme continue, je traduis : « Ge qu’elles ont de plus remarquable,
c’est la rapidité avec laquelle elles montent et descendent, la facilité avec laquelle
elles changent la direction-de leur mouvement. G’est là un caractère qui n ’appartient
qu’au règne animal il y a là, volonté et intention Le phénomène est
vraiment terrifiant. On dirait qu’un vaste gouffre, ou mieux encore, une gigantesque
gueule ait entrebâillé ses mâchoires formidables au fond du lac. L ’eau, toute
.la. masse du lac baisse, en quelques instants, de plusieurs pieds au-dessous de son
niveau, puis elle s’arrête dans sa chute. Pourquoi ? Qui sau rait le deviner? Un
peu plus, et tout le lac allait être englouti, absorbé, cela est certain, pa r dessous
des racines des montagnes, jusque dans quelque .océan éloigné. Mais n’est-ce pas
épouvantable ? Si un lac peut ainsi disparaître subitement devant nos yeux, sous
nos pieds, sommes-nous encore assurés de la solidité des montagnes? Y a-t-il
vraiment encore quelque pa rt quelque chose.de stable ? »
(2) Lettre de M. Oltramare à M. Arago su r une seiche du lac de Genève. Comptes
rendus de l’Acad. dès Sc. de Paris, XIII, 829.18 octobre 1841.