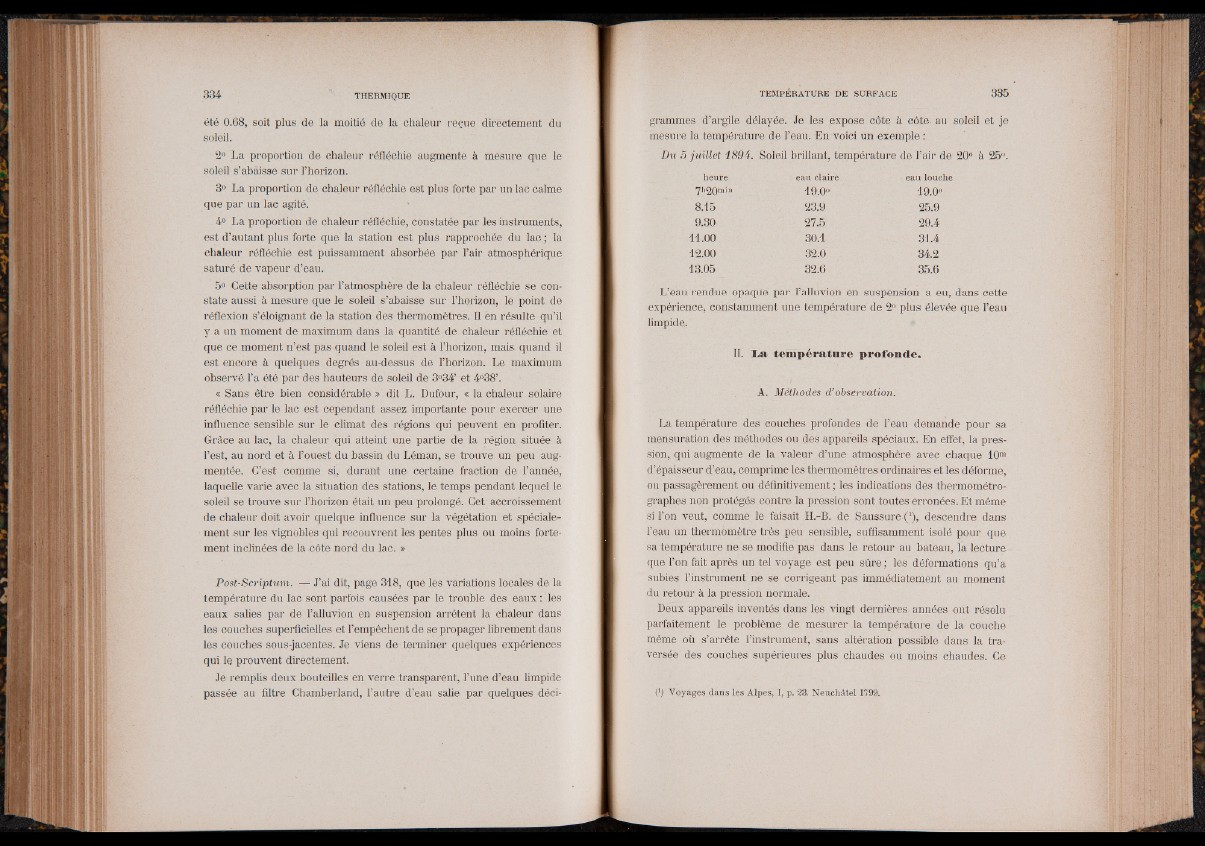
été 0.68, soit plus de la moitié de la chaleur reçue directement du
soleil.
2° La proportion de chaleur réfléchie augmente à mesure que le
soleil s’abàisse sur l’horizon.
3° La proportion de chaleur réfléchie est plus forte par un lac calme
que par un lac agité.
4° La proportion de chaleur réfléchie, constatée par les instruments,
est d’autant plus forte que la station est plus rapprochée du lac ; la
chaleur réfléchie est puissamment absorbée par l’air atmosphérique
saturé de vapeur d’eau.
5° Cette absorption par l’atmosphère de la chaleur réfléchie se constate
aussi à mesure que le soleil s’abaisse sur l’horizon, le point de
réflexion s’éloignant de la station des thermomètres. Il ën résulte qu’il
y a un moment de maximum dans la quantité de chaleur réfléchie et
que ce moment n’est pas quand le soleil est à l’horizon, mais quand il
est encore à quelques degrés au-dessus de l’horizon. Le maximum
observé l’a été par des hauteurs de soleil de 3°34’ et 4°38’.
« Sans être bien considérable » dit L. Dufour, « la chaleur solaire
réfléchie par le lac est cependant assez importante pour exercer une
influence sensible sur le climat des régions qui peuvent en profiter.
Grâce au lac, la chaleur qui atteint une partie de la région située à
l’est, au nord et à l’ouest du bassin du Léman, se trouve un peu augmentée.
C’est comme si, durant une certaine fraction de l’année,
laquelle varie avec la situation des stations, le temps pendant lequel le
soleil se trouve sur l’horizon était un peu prolongé. Cet accroissement
de chaleur doit avoir quelque influence sur la végétation et spécialement
sur les vignobles qui recouvrent les pentes plus ou moins fortement
inclinées de la côte nord du lac. »
Post-Scriptum. — J’ai dit, page 318, que les variations locales de la
température du lac sont parfois causées par le trouble des eaux : les
eaux salies par de l’alluvion en suspension arrêtent la chaleur dans
les couches superficielles et l’empêchent de se propager librement dans
les couches sous-jacentes. Je viens de terminer quelques expériences
qui le prouvent directement.
Je remplis deux bouteilles en verre transparent, l’une d’eau limpide
passée au filtre Chamberland, l’autre d’eau salie par quelques décigrammes
d’argile délayée. Je les expose côte à côte, au soleil et je
mesure la température de l’eau. En voici un exemple :
Du 5 juillet 4894. Soleil brillant, température de l’air de 20° à 25°.
heure eau claire eau louche
7h20m‘n 19,0“ 19.0“
8.15 23.9 25.9
9.30 27.5 '29.4
11.0 0 30.1 31.4
12.00 32.0 34.2
13.05 32.6 35.6
L’eau rendue opaque par l’alluvion en suspension a eu, dans cette
expérience, constamment une température de 2° plus élevée que l’eau
limpide.;
II. lia température profonde.
A. Méthodes d’observation.
La température des couches profondes de l’eau demande pour sa
mensuration des méthodes ou des appareils spéciaux. En effet, la pression,
qui augmente de la valeur d’une atmosphère avec chaque 10m
d’épaisseur d’eau, comprime les thermomètres ordinaires et les déforme,
ou passagèrement ou définitivement ; les indications des thermométro-
graphes non protégés .contre la pression sont toutes erronées. Et même
si l’on veut, comme le faisait H.-B. de Saussure (1), descendre dans
l’eau un thermomètre très peu sensible, suffisamment isolé pour que
sa température ne se modifie pas dans le retour au bateau, la lecture
que l’on fait après un tel voyage est peu sûre ; les déformations qu’a
subies l’instrument ne se corrigeant pas immédiatement au moment
du retour à la pression normale.
Deux appareils inventés dans les vingt dernières années ont résolu
parfaitement le problème de mesurer la température de la couche
même où s’arrête l’instrument, sans altération possible dans la traversée
des couches supérieures plus chaudes ou moins chaudes. Ce
(f) Voyages dans les Alpes, I, p. 23. Neuchâtel 1799.