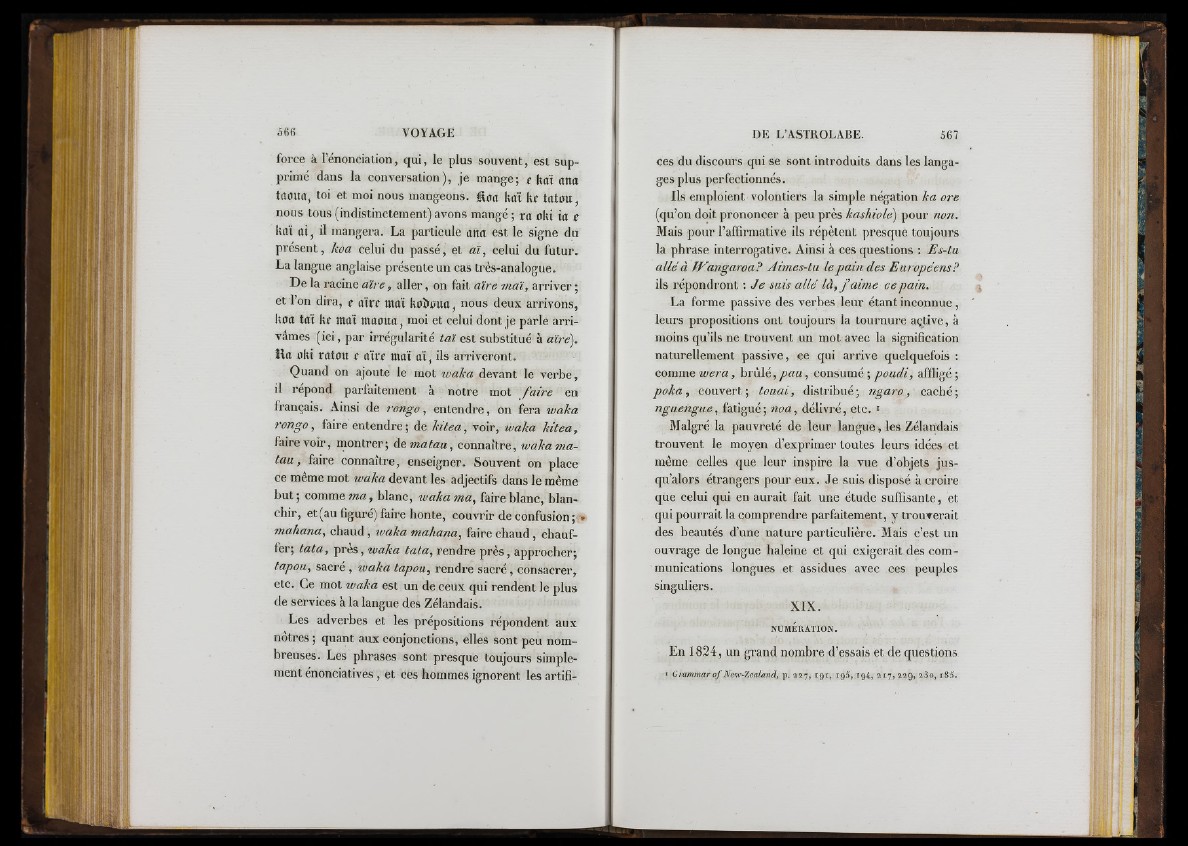
l'orce à renonciation, qu i, le plus souvent, est supprimé
dans la conversation), je mange; f kaï ana
iamia, toi et moi nous mangeons. <âiia kaï kf ttttmi,
nous tous (indistinctement) avons mangé ; ra oki ia t
kaï a i, il mangera. La particule ana est le signe du
présent, koa celui du passé, et a ï, celui du futur.
La langue anglaise présente un cas très-analogue.
De la racine aire, alle r, on fait aïre maï, arriver ;
et l’on dira, s aire mai knîtoua, nous deux arrivons,
kcta taï kf mai inaana, moi et celui dont je parle arrivâmes
(ici, par irrégularité laï est substitué à aïre).
ila nkt ratan r aïrr mai aï, ils arriveront.
Quand on ajoute le mot ivaka devant le verbe,
il répond parfaitement à notre mot fa ir e en
français. Ainsi de rongo, entendre, on fera waka
rongo, faire entendre; de kitea, voir, waka kü ea ,
faire voir, montrer ; de m a la u , connaître, waka ma-
ta u , faire connaître, enseigner. Souvent on place
ce même mot waka devant les adjectifs dans le même
b u t; comme m a , blanc, waka ma, faire blanc, blan-
cbir, et (au figuré) faire honte, couvrir de confusion; .
mahana, chaud , ivaka mahana, faire chaud , chauffer;
ta ta , près, waka tata, rendre près, approcher;
tapou, sacré , ivaka tapou, rendre sacré , consacrer,
etc. Ce mot waka est un de ceux qui rendent Je plus
de services à la langue des Zélandais.
Les adverbes et les prépositions répondent aux
nôtres ; quant aux conjonctions, elles sont peu nombreuses.
Les phrases sont presque toujours simplement
énonciatives , et ces hommes ignorent les artifices
du discours qui se sont introduits dans les langages
plus perfectionnés.
Ils emploient volontiers la simple négation ka ore
(qu’on doit prononcer à peu près kashiole) pour non.
Mais pour l’affirmative ils répètent presque toujours
la phrase interrogative. Ainsi à ces questions ; Es-tu
allé à fVangaroa? Aimes-tu le pain des Européens?
ils répondront ; J e suis allé là, fa im e ce pain.
La forme passive des verbes leur étant inconnue ,
leurs propositions ont toujours la tournure açtive, à
moins qu’ils ne trouvent un mot avec la signification
naturellement passive, ce qui arrive quelquefois :
comme tuera, b rû lé , p a u , consumé ; poudi, affligé ;
p o k a , couvert; touai, distribué; ngaro, caché;
nguengue, fatigué; m a , délivré, etc. ‘
Malgré la pauvreté de leur langue, les Zélandais
trouvent le moyen d’exprimer toutes leurs idées et
même celles que leur inspire la vue d’objets jusqu’alors
étrangers pour eux. Je suis disposé à croire
que celui qui en aurait fait une étude suffisante, et
qui pourrait la comprendre parfaitement, y trouverait
des beautés d’une nature particulière. Mais c’est un
ouvrage de longue haleine et qui exigerait des communications
longues et assidues avec ces peuples
singuliers.
XIX.
NUMÉRATION.
En 1824, un grand nombre d’essais et de questions
> Gvammar o f New-Zealand, p, 227, 19 1, 195, t g 4, 2 1 7 , 22g, 280, i 85 .