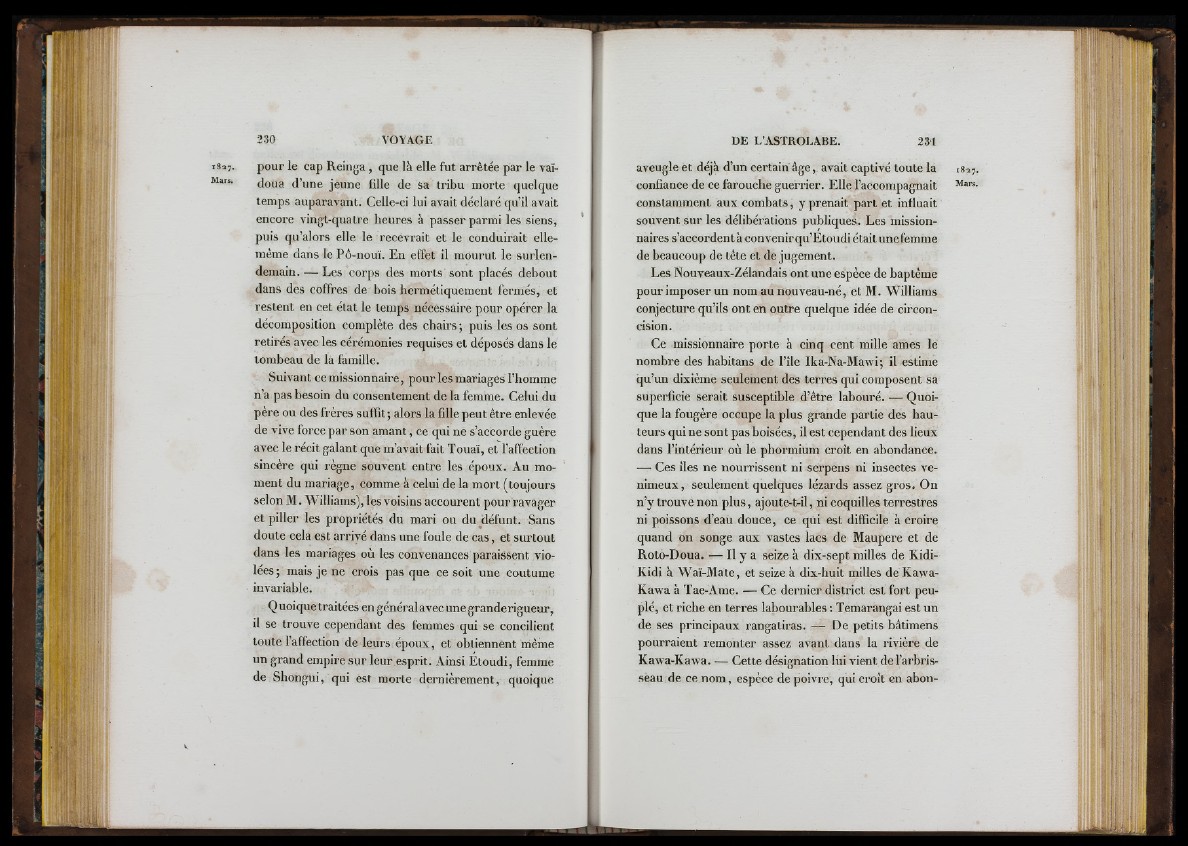
■ iy
I f i
I
6IGÎM.- '
l i
■i
230 VOYAGE
1827.
Mars.
pour le cap Reinga, que là elle fut arrêtée par le vaï-
doua d’une jeune fille de sa tribu morte quelque
temps auparavant. Celle-ci lui avait déclaré qu’il avait
encore vingt-quatre heures à passer parmi les siens,
puis qu’alors elle le recevrait et le conduirait elle-
même dans le Pô-nouï. En effet il mourut le surlendemain.
— Les corps des morts sont placés debout
dans des coffres de bois hermétiquement fermés, et
restent en cet état le temps nécessaire pour opérer la
décomposition complète des chairs ; puis les os sont
retirés avec les cérémonies requises et déposés dans le
tombeau de la famille.
Suivant ce missionnaire, pour les mariages l’homme
n’a pas besoin du consentement de la femme. Celui du
père ou des frères suffit; alors la fille peut être enlevée
de vive force par son amant, ce qui ne s’accorde guère
avec le récit galant que m’avait fait Touaï, et l’affection
sincère qui règne souvent entre les époux. Au moment
du mariage, comme à celui de la mort (toujours
selon M. Williams), les voisins accourent pour ravager
et piller les propriétés du mari ou du défunt. Sans
doute cela est arrivé dans une foule de cas, et surtout
dans les mariages où les convenances paraissent violées
; mais je ne crois pas que ce soit une coutume
invariable.
Quoique traitées en généralavecunegranderigueur,
il se trouve cependant des femmes qui se concilient
toute f affection de leurs époux, et obtiennent même
un grand empire sur leur esprit. Ainsi Étoudi, femme
de Shongui, qui est morte dernièrement, quoique
DE L’ASTROLABE. 23‘1
aveugle et déjà d’un certain âge, avait captivé toute la
confiance de ce farouche guerrier. Elle l’accompagnait
constamment aux combats, y prenait part et influait
souvent sur les délibérations publiques. Les missionnaires
s’accordent à convenir qu’Etoudi était une femme
de beaucoup de tête et de jugement.
Les Nouveaux-Zélandais ont une espèce de baptême
pour imposer un nom au nouveau-né, et M. Williams
conjecture qu’ils ont en outre quelque idée de circoncision.
Ce missionnaire porte à cinq cent mille ames le
nombre des habitans de l’île Ika-Na-Mawi; il estime
iqu’un dixième seulement des terres qui composent sa
superficie serait susceptible d’être labouré. — Quoique
la fougère occupe la plus grande partie des hauteurs
qui ne sont pas boisées, il est cependant des lieux
dans l’intérieur où le phormium croît en abondance.
— Ces îles ne nourrissent ni serpens ni insectes venimeux
, seulement quelques lézards assez gros. On
n’y trouve non plus, ajoute-t-il, ni coquilles terrestres
ni poissons d’eau douce, ce qui est difficile à croire
quand on songe aux vastes lacs de Maupere et de
Roto-Doua. — Il y a seize à dix-sept milles de Kidi-
Kidi à Waï-Mate, et seize à dix-huit milles de Kawa-
Kawa à Tae-Ame. — Ce dernier district est fort peuplé,
et riche en terres labourables ; Temarangai est un
de ses principaux rangatiras. — De petits bâtimens
pourraient remonter assez avant dans la rivière de
Kawa-Kawa. — Cette désignation lui vient de l’arbrisseau
de ce nom, espèce de poivre, qui croît en abon-
, ! | | k r ,
!;■ ' ' ■' i , ■ i
t1 ! . . ! i i '
i ! I
1827.
Mars.
i I.'
ii
li'îl
.?p
ï
* - c ' I
■\i
. r