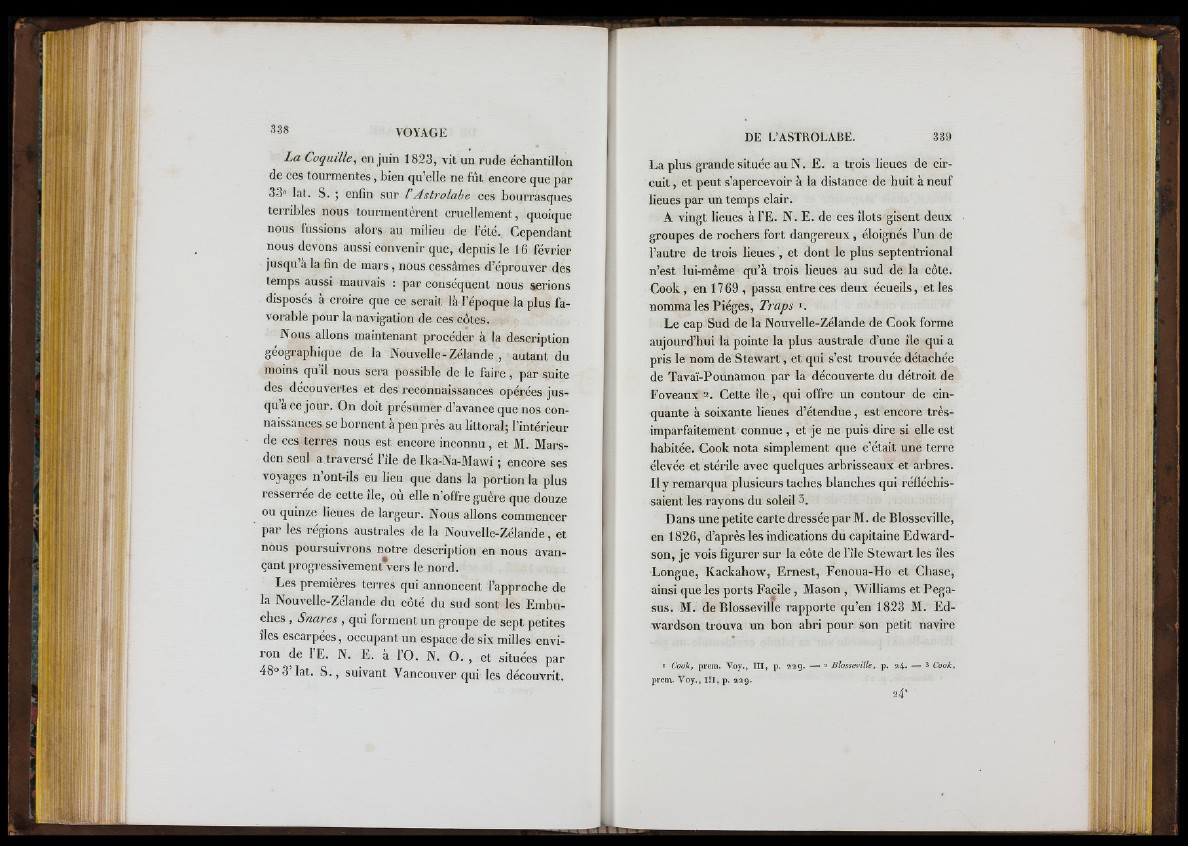
î! 1
7
I !■.
í!
ri j
La Coquille, en juin 1823, vit un rude échantillon
de ces tourmentes, bien qu’elle ne fût encore que par
33" lat. S. ; enfin sur l’Astrolabe ces bourrasques
terribles nous tourmentèrent cruellement, quoique
nous fussions alors au milieu de l’été. Cependant
nous devons aussi convenir que, depuis le 16 février
jusqu’a la fin de mars, nous cessâmes d’éprouver des
temps aussi mauvais : par conséquent nous serions
disposés à croire que ce serait là l’époque la plus favorable
pour la navigation de ces côtes.
Nous allons maintenant procéder à la description
géographique de la Nouvelle-Zélande, autant du
moins qu’il nous sera possible de le faire , par suite
des découvertes et des reconnaissances opérées jusqu’à
ce jour. On doit présumer d’avance que nos connaissances
se bornent à peu près au littoral; l’intérieur
de ces terres nous est encore inconnu, et M. Marsden
seul a traversé l’île de Ika-Na-Mawi ; encore ses
voyages n’ont-ils eu lieu que dans la portion la plus
resserrée de cette île, où elle n ’offre guère que douze
ou quinze lieues de largeur. Nous allons commencer
par les régions australes de la Nouvelle-Zélande, et
nous poursuivrons notre description en nous avançant
progressivement vers le nord.
Les premières terres qui annoncent l’approche de
la Nouvelle-Zélande du côté du sud sont les Embuches
, Snares , qui forment un groupe de sept petites
îles escarpées, occupant un espace de six milles environ
de IE. N. E. a l’O. N. O. , et situées par
48°3’ lat. S ., suivant Vancouver qui les découvrit.
La plus grande située auN . E. a trois lieues de circuit
, et peut s’apercevoir à la distance de huit à neuf
lieues par un temps clair.
A vingt lieues à l’E. N. E. de ces îlots gisent deux
groupes de rochers fort dangereux, éloignés l’un de
l’autre de trois lieues, et dont le plus septentrional
n’est lui-même qu’à trois lieues au sud de la côte.
Cook , en 17 69 , passa entre ces deux écueils, et les
nomma les Pièges, Traps '.
Le cap Sud de la Nouvelle-Zélande de Cook forme
aujourd’hui la pointe la plus australe d’une île qui a
pris le nom de Stewart, et qui s’est trouvée détachée
de Tavaï-Pounamou par la découverte du détroit de
Foveaux 2. Cette île , qui offre un contour de cinquante
à soixante lieues d’étendue, est encore très-
imparfaitement connue , et je ne puis dire si elle est
habitée. Cook nota simplement que c’était une terre
élevée et stérile avec quelques arbrisseaux et arbres.
Il y remarqua plusieurs taches blanches qui réfléchissaient
les rayons du soleil 3.
Dans une petite carte dressée par M. de Blosseville,
en 1826, d’après les indications du capitaine Edward-
son, je vois figurer sur la côte de l’île Stewart les îles
Longue, Kackahow, Ernest, Fenoua-Ho et Chase,
ainsi que les ports Facile , Mason , Williams et Pegasus.
M. de Blosseville rapporte qu’en 1823 M. Ed-
wardson trouva un bon abri pour son petit navire
I Cook, prem. V o y ., II I , p. 22g. — 2 Blosseville, p. 24. — 3 Cook,
prem. V o y ., I I I , p. 229.
î ' ï ï f f f l'i i ' '
i J r i ï
* ÍL » 17
■ Tl
' i i
■i r i
1 f ii