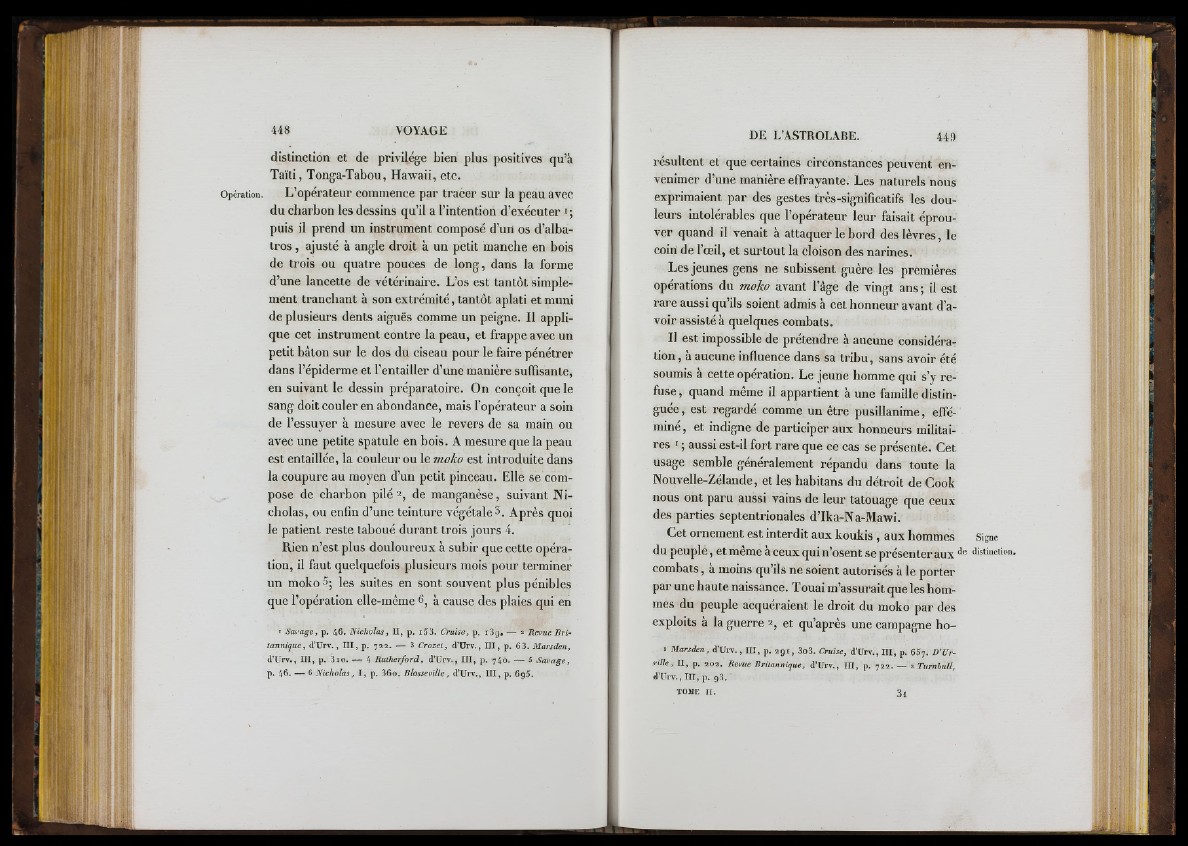
448 VOYAGE
dislinclion et de privilège bien plus positives qu’à
Taïti, Tonga-Tabou, Hawaii, etc.
Opération. L’opérateur commence par tracer sur la peau avec
du charbon les dessins qu’il a l’intention d’exécuter
puis il pi'end un instrument composé d’un os d’albatros
, ajusté à angle droit à un petit manche en bois
de trois ou quatre pouces de long, dans la forme
d’une lancette de vétérinaire. L’os est tantôt simplement
tranchant à son extrémité, tantôt aplati et muni
de plusieurs dents aiguës comme un peigne. II applique
cet instrument contre la peau, et frappe avec un
petit bâton sur le dos du ciseau pour le faire pénétrer
dans l’épiderme et l’entailler d’une manière suffisante,
en suivant le dessin préparatoire. On conçoit que le
sang doit couler en abondance, mais l’opérateur a soin
de l’essuyer à mesure avec le revers de sa main ou
avec une petite spatule en bois. A mesure que la peau
est entaillée, la couleur ou le moko est introduite dans
la coupure au moyen d’un petit pinceau. Elle se compose
de charbon pilé 2, de manganèse, suivant Nicholas,
ou enfin d’une teinture végétale 3. Après quoi
le patient reste taboué durant trois jours 4.
Rien n’est plus douloureux à subir que cette opération,
il faut quelquefois plusieurs mois pour terminer
un moko 5; les suites en sont souvent plus pénibles
que l’opération elle-méme 6, à cause des plaies qui en
1 Savage, p. 46. Nicholas, I I , p. i 5 3 . Cruise, p. r 3 y» — 2 Revue B r itannique,
d’ü r v . , I I I , p. 722. — 3 Crozet, d’ü r v ., I I I , p. 6 3 . Marsden,
d’ü r v ., I II, p. 3 10. — 4 Rutherford, d’Ü rv ., II I , p. 740. — 5 S a m g e ,
p. 46. — 6 Nicholas, I , p. 36o. Blosseville, d’Urv., I I I , p. 6 g 5 .
D E L ’ASTROLABE. 4 4 9
résultent et que certaines circonstances peuvent envenimer
d’une manière effrayante. Les naturels nous
exprimaient par des gestes très-significatifs les douleurs
intolérables que l’opérateur leur faisait éprouver
quand il venait à attaquer le bord des lèvres, le
coin de l’oeil, et surtout la cloison des narines.
Les jeunes gens ne subissent guère les premières
opérations du moko avant l’âge de vingt ans; il est
rare aussi qu’ils soient admis à cet honneur avant d’avoir
assisté à quelques combats.
Il est impossible de prétendre à aucune considération
, à aucune influence dans sa trib u , sans avoir été
soumis à celte opération. Le jeune homme qui s’y refuse
, quand même il appartient à une famille distinguée
, est regardé comme un être pusillanime, efféminé
, et indigne de participer aux honneurs militaires
' ; aussi est-il fort rare que ce cas se présente. Cet
usage semble généralement répandu dans toute la
Nouvelle-Zélande, et les habitans du détroit de Cook
nous ont paru aussi vains de leur tatouage que ceux
des parties septentrionales d’Ika-Na-Mawi.
Cet ornement est interdit aux koukis, aux bommes signe
du peuple, et même à ceux qui n’osent se présenter aux distiuction.
combats, à moins qu’ils ne soient autorisés à le porter
par une haute naissance. Touai m’assurait que les hommes
du peuple acquéraient le droit du moko par des
exploits à la guerre 2, et qu’après une campagne ho-
I Marsden, dÜrv. , I I I , p. 2 9 1 , 3o 3. Omise, d’ürv., IH, p. 6 .5, . D'Ur-
ville, I I , p. 202. Reme Britannique, d’Urv., III, p. 722. — 2 TurnhuU,
d’Urv., III, p. 93.
TOME II. 3 ,