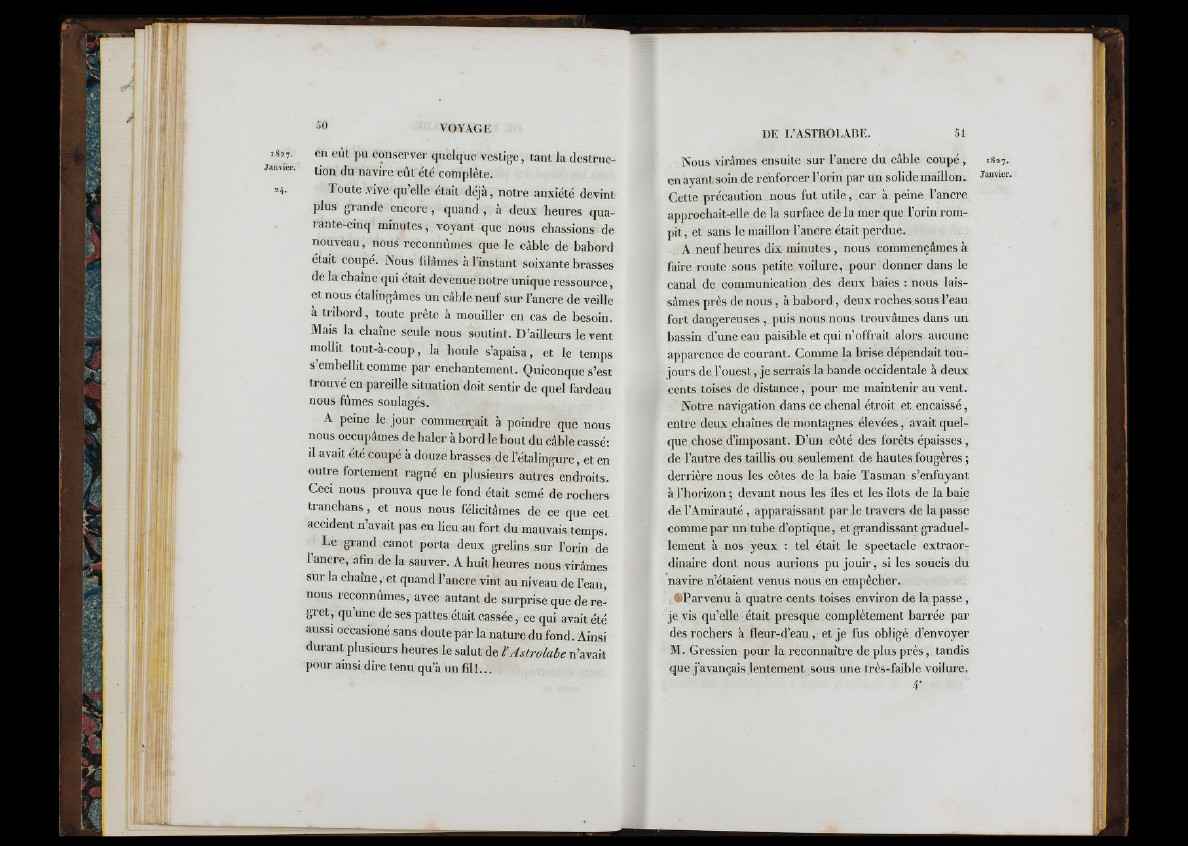
50 VOYAGE DE L’ASTROLABE. 51
1S27.
Janvier.
24.
en eùl pu conserver (juelque vestige, tant la deslruc-
lion du navire eût été complète.
Toute vive qu’elle était déjà, notre anxiété devint
plus grande encore, quand, à deux heures quarante
cinq minutes, voyant que nous chassions de
nouveau, nous reconnûmes que le cable de bâbord
était coupé. Nous filâmes à l’instant soixante brasses
de la chaîne qui était devenue notre unique ressource,
et nous étalingâmes un câble neuf sur l’ancre de veille
à trib o rd , toute prête à mouiller en cas de besoin.
Mais la chaîne seule nous soutint. D’ailleurs le vent
mollit tout-a-coup, la houle s’apaisa, et le temps
s’embellit comme par enchantement. Quiconque s’est
trouvé en pareille situation doit sentir de quel fardeau
nous fûmes soulagés.
A peine le jour commençait à poindre que nous
nous ocrapâmes de haler à bord le bout du câble cassé:
d avait été coupé à douze brasses de l’étalingure, et en
outre fortement ragué en plusieurs autres endroits.
Ceci nous prouva que le fond était semé de rochers
tranchans, et nous nous félicitâmes de ce que cet
accident n avait pas eu lieu au fort du mauvais temps.
^ Le grand canot porta deux grelins sur l’orin de
I ancre, afin de la sauver. A huit heures nous virâmes
sur la chaîne, et quand l’ancre vint au niveau de l’eau,
nous reconnûmes, avec autant de surprise que de regret,
qu’une de ses pattes était cassée, ce qui avait été
aussi occasioné sans doute par la nature du fond. Ainsi
durant plusieurs heures le salut de l’Astrolabe n’avait
pour ainsi dire tenu qu’à un fil !...
Nous virâmes ensuite sur l’ancre du câble coupé,
en avant soin de renforcer l’orin par un solide maillon.
Cette précaution nous fut utile, car à peine l’ancre
approchait-elle de la surface de la mer que l’orin rompit
, et sans le maillon l’ancre était perdue.
A neuf heures dix minutes, nous commençâmes à
faire route sous petite voilure, pour donner dans le
canal de communication des deux baies : nous laissâmes
près de n o u s, à bâbord, deux roches sous l’eau
fort dangereuses , puis nous nous trouvâmes dans un
bassin d’une eau paisible et qui n’offrait alors aucune
apparence de courant. Comme la brise dépendait toujours
de l’ouest, je serrais la bande occidentale à deux
cents toises de distance, pour me maintenir au vent.
Notre navigation dans ce chenal étroit et encaissé,
entre deux chaînes de montagnes élevées, avait quelque
chose d’imposant. D’un côté des forêts épaisses,
de l’autre des taillis ou seulement de hautes fougères ;
derrière nous les côtes de la baie Tasman s’enfuyant
à l’horizon ; devant nous les îles et les îlots de la baie
de l’Amirauté, apparaissant par le travers de la passe
comme par un tube d’optique, et grandissant graduellement
à nos yeux : tel était le spectacle extraordinaire
dont nous aurions pu jo u ir, si les soucis du
navire n’étaient venus nous en empêcher.
, ^Parvenu à quatre cents toises environ de la passe,
je vis qu’elle était presque complètement barrée par
des rochers à fleur-d’e au, et je fus obligé d’envoyer
M. Gressien pour la reconnaître de plus p rè s, tandis
que j’avançais lentement sous une très-faible voilure.
4 ’
1827,
Janvier.
. ' il'