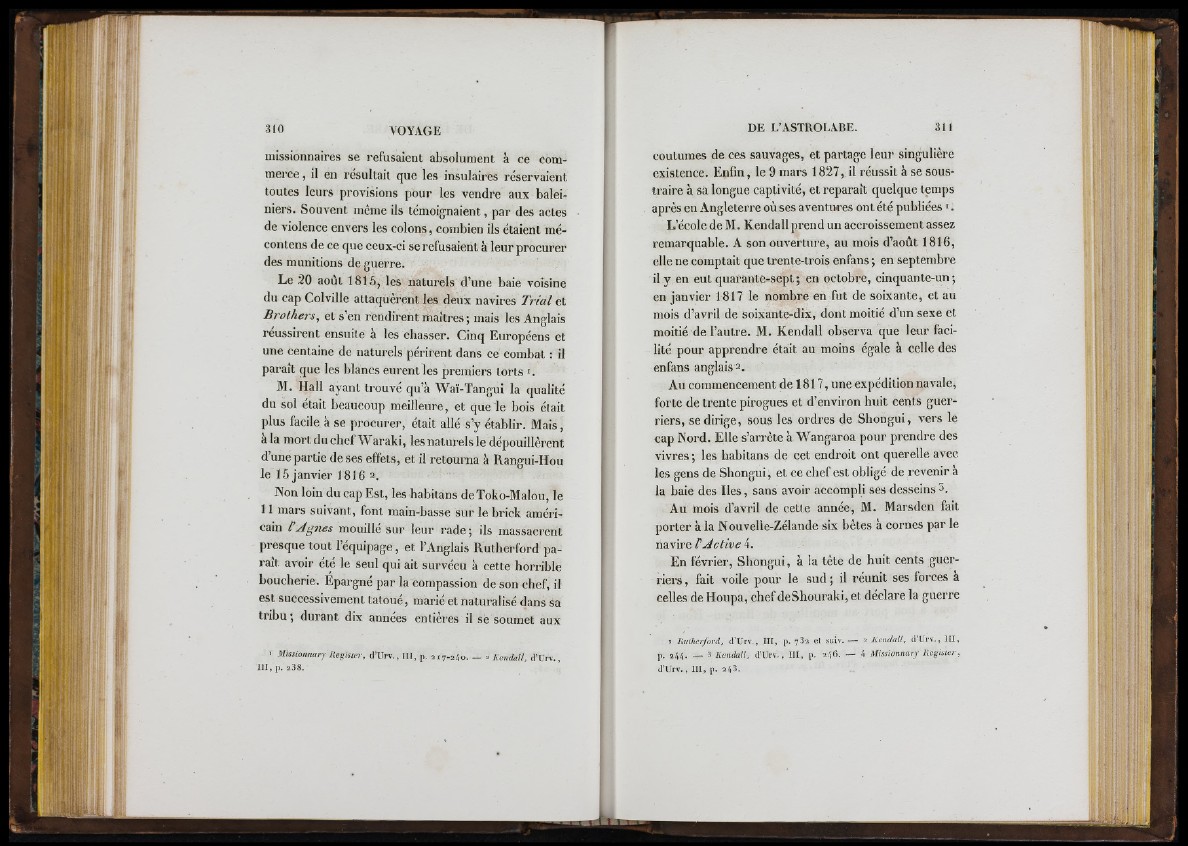
missionnaires se refusaient absolument à ce commerce
, il en résultait que les insulaires réservaient
toutes leurs provisions pour les vendre aux baleiniers.
Souvent même ils témoignaient, par des actes
de violence envers les colons, combien ils étaient mé-
contens de ce que ceux-ci se refusaient à leur procurer
des munitions de guerre.
Le 20 août 1815, les naturels d’une baie voisine
du cap Colville attaquèrent les deux navires Trial et
Brothers, et s’en rendirent maîtres; mais les Anglais
réussirent ensuite à les chasser. Cinq Européens et
une centaine de naturels périrent dans ce combat : il
paraît que les blancs eurent les premiers torts i .
M. Hall ayant trouvé qu’à Waï-Tangui la qualité
du sol était beaucoup meilleure, et que le bois était
plus facile à se procurer, était allé s’y établir. Mais,
à la mort du chef Waraki, les naturels le dépouillèrent
d’une partie de ses effets, et il retourna à Rangui-Hou
le 15 janvier 1816 2.
Non loin du cap Est, les habitans de Toko-Malou, le
11 mars suivant, font main-basse sur le brick américain
lA g n e s mouillé sur leur rade; ils massacrent
presque tout l’équipage, et l’Anglais Rutherford parait
avoir été le seul qui ait survécu à cette horrible
boucherie. Epargné par la compassion de son chef, il
est successivement tatoué, marié et naturalisé dans sa
tribu ; durant dix années entières il se soumet aux
1 M issio n n a ry R e g isie r , d ’U l 'V . , I I I , ji , )
1 1 1 , p . 2 3 8 .
1 7 - 2 4 0 . — 2 Kendall, d ’U r v . ,
coutumes de ces sauvages, el partage leur singulière
existence. Enfin, le 9 mars 1827, il réussit à se soustraire
à sa longue captivité, et reparaît quelque temps
après en Angleterre où ses aventures ont été publiées ■.
L’école de M. Kendall prend un accroissement assez
remarquable. A son ouverture, au mois d’août 1816,
elle ne comptait que trente-trois enfans ; en septembre
il y en eut quarante-sept; en octobre, cinquante-un;
en janvier 1817 le nombre en fut de soixante, el au
mois d’avril de soixante-dix, dont moitié d’un sexe el
moitié de l’autre. M. Kendall observa que leur facilité
pour apprendre était au moins égale à celle des
enfans anglais 2.
Au commencement de 1817, une expédition navale,
forte de trente pirogues et d’environ huit cents guerriers,
se dirige, sous les ordres de Shongui, vers le
cap Nord. Elle s’arrête à W^angaroa pour prendre des
vivres ; les babitans de cet endroit ont querelle avec
les gens de Shongui, et ce cbef est obligé de revenir à
la baie des Iles, sans avoir accompli ses desseins 3.
Au mois d’avril de cette année, M. Marsden fait
porter à la Nouvelle-Zélande six bêtes à cornes par le
navire {A ctiv e 4.
En février, Shongui, à la tète de huit cents guerriers
, fait voile pour le sud ; il réunit ses forces a
celles deHoupa, chef deShoiiraki, et déclare la guerre
I liu lh e ifo rd , d ’ U r v . , I I I , p . 782 e t s u i v . — 2 K e n d a ll, d ’ U r v . , I I I ,
p . 2 4 4 . — 3 K en d a ll, d ’U r v . , I I I , p . 2 4 < > . ~ 4 M is s io n n a r j R e g is te r ,
d ’U r v . , 1 1 1 , p . 2 4 3 ,