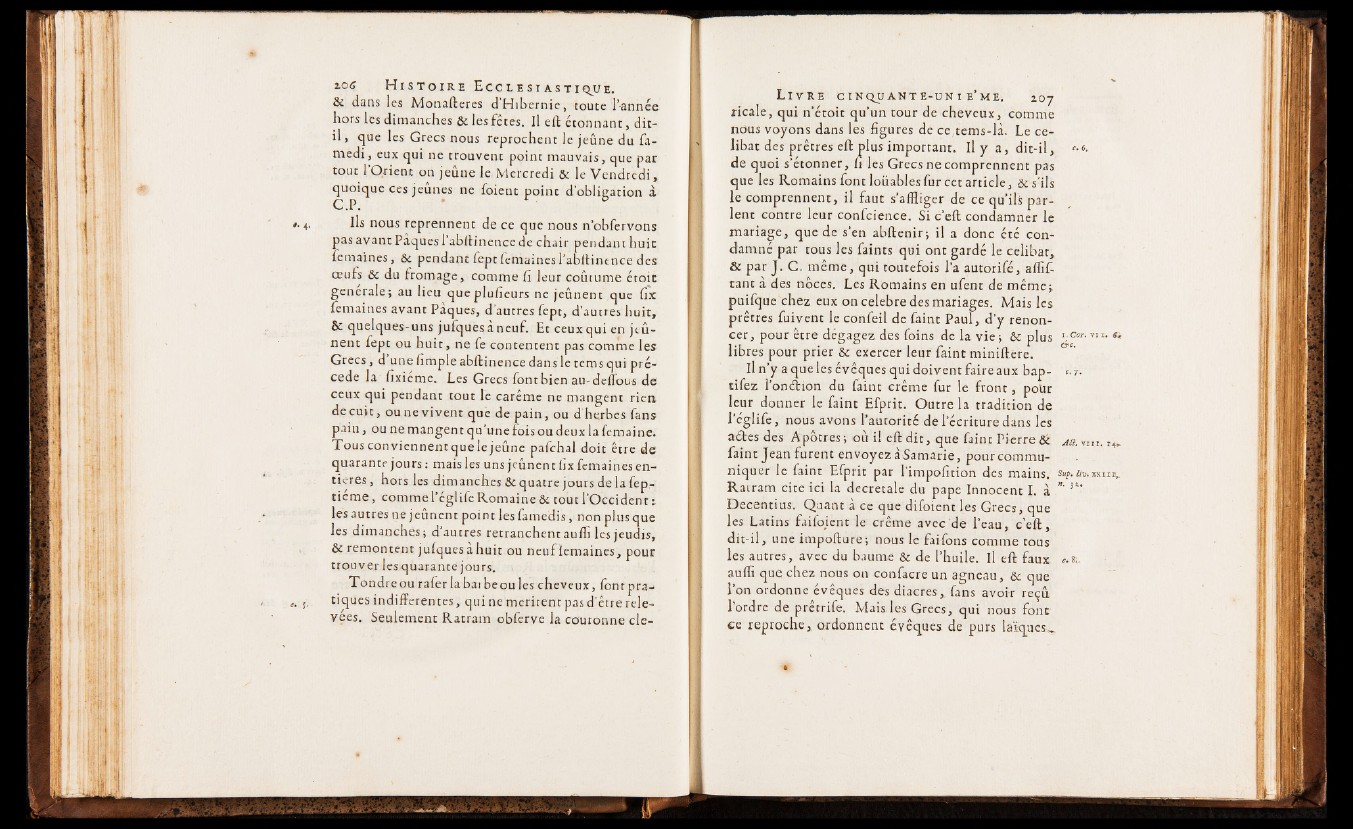
io<r H i s t o i r e E c c l e s i a s t iq u e .
& dans les Monafteres d’Hibernie, toute l’année
hors les dimanches 8c les fêtes. Il eft étonnant, dit-
i l , que les Grecs nous reprochent le jeûne du fa-
niedi, eux qui ne trouvent point mauvais, que par
tout l’Orient on jeûne le Mercredi & le Vendredi,
quoique ces jeûnes ne foient point d’obligation à
C.P.
ils nous reprennent de ce que nous n’obfervons
pas avant Pâques l’abftinence de chair pendant huit
femaines, 8c pendant fept femaines l’abftintnce des
oeufs 8c du fromage, comme fi leur coûturne étoîc
generale; au lieu queplufieurs ne jeûnent que fix
femaines avant Pâques, d’autres fept, d’autres huit,
ôc quelques-uns jufques a neuf. Et ceux qui en jeûnent
fept ou h uit, ne fe contentent pas comme les
Grecs, d unefimpleabftinencedansletemsqui précédé
la fixieme. Les Grecs font bien au-deUous de
ceux qui pendant tout le carême ne mangent rien
de cuit, ou ne vivent que de pain, ou d herbes fans
pain, ou ne mangent qu’une fois ou deux la femaine.
Tous conviennent que le jeûne pafchal doit être de
quarante jours : mais les uns jeûnent fix femaines entières
, hors les dimanches 8c quatre jours de la fep,-
tieme, comme l’églife Romaine 8c tout l’Occident t
les autres ne jeûnent point les famedis, non plus que
les dimanches ; d’autres retranchent aulh les jeudis,
ôc remontent jufquesahuit ou neuflemaines, pour
trouver lesquarante jours.
Tondreouraier labarbeoules cheveux, fontpra-
tiques indifférentes, qui ne merirent pas d'être relevées.
Seulement Ratrara obferve la couronne cle-
L i v r e c i n q j j a n t e - u n i e ’ me . 1 0 7
ricale, qui n’étoit qu’un tour de cheveux, comme
nous voyons dans les figures de ce,tems-là. Le célibat
des prêtres eft plus important. Il y a , dit-il,
de quoi s'étonner, fi les Grecs ne comprennent pas
que les Romains font louables fur cet article, & s’ils
le comprennent, il faut s’affliger de ce qu’ils parlent
contre leur confcience. Si c’eft condamner le
mariage, que de s’en abftenir; il a donc été condamné
par tous les faints qui ont gardé le célibat,
ôc par J . C. même, qui toutefois l’a autorifé, affifi
tant à des noces. Les Romains en ufent de même;
puifque chez eux on célébré des mariages. Mais les
prêtres fuivent le confeil de faint Paul, d’y renoncer,
pour être dégagez des foins de la v ie ; ôc plus
libres pour prier 8c exercer leur faint miniftere.
Il n’y a que les évêques qui doivent faire aux bap-
tifez l’ondion du faint crème fur le front, pour
leur donner le faint Efprit. Outre la tradition de
le g life , nous avons l’autorité de l’écriture dans les
aêtes des Apôtres; oit il eft dit, que faint Pierre 8c
faint Jean furent envoyez à Samarie, pour communiquer
le faint Efprit par l'impoficion des mains.
Ratram cite ici la decretale du pape Innocent I. à
Decentius. Quant à ce que difoient les Grecs, que
les Latins faifoient le crème avec de l’eau, c’e ft,
dit-il, une impofture; nous le faifons comme tous
les autres, avec du baume 8c de l’huile. Il eft faux
auffi que chez nous on confacre un agneau, 8c que
l’on ordonne évêques des diacres, fans avoir re<~û
l’ordre de prêtrife. Mais.les Grecs, qui nous font
ce reproche, ordonnent évêques de purs laïques-«.
*
1. Cor. v i r« &e.
c. 7 .
AU. vi-1 1 , i-4„
S u p . l i n , XX LIE,.
». 3z.