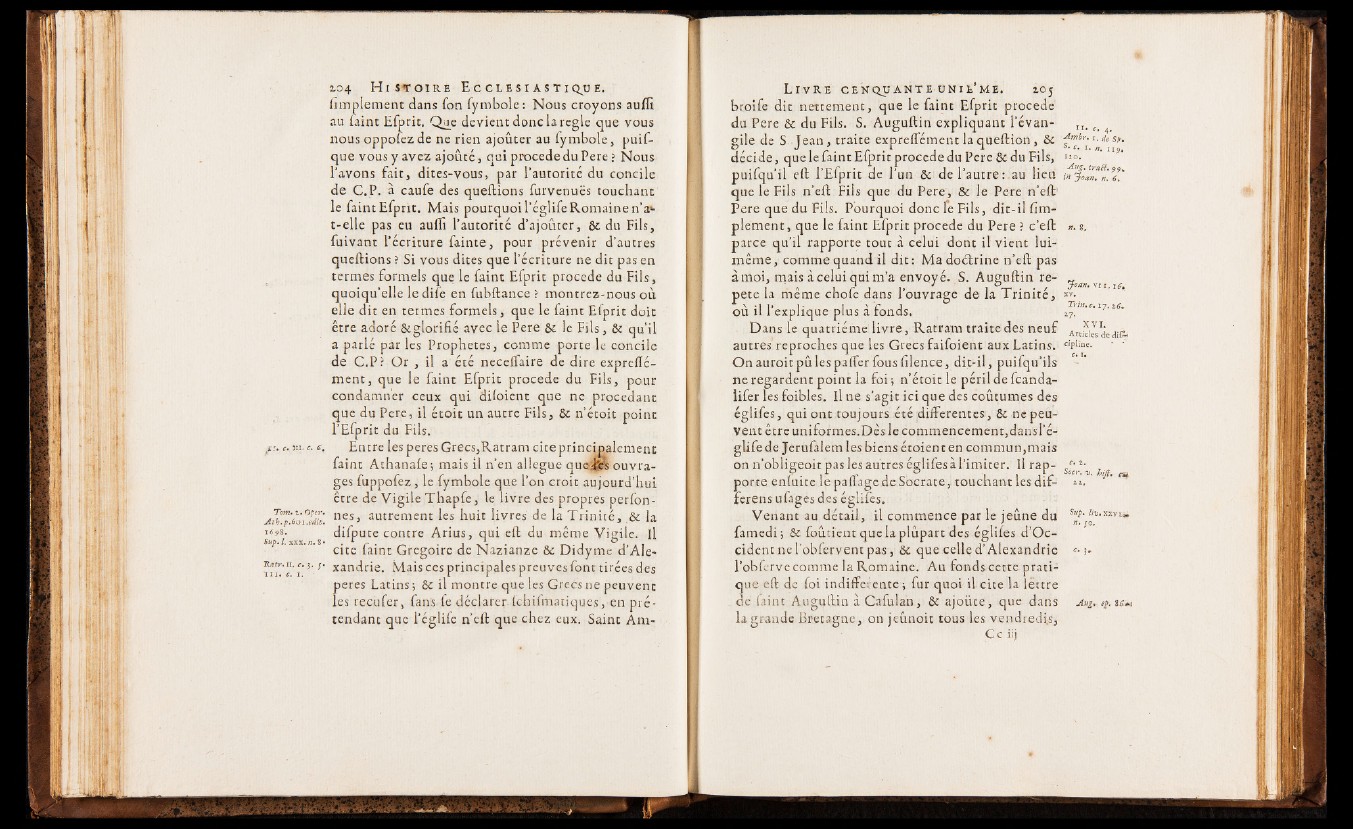
zc>4 H i s t o i r e E c c l e s i a s t iq ^u e .
iîmplement dans fon fymbole: Nous croyons auiG
au faint Efprit. Que devient donc la réglé que vous
ppofezde ne rien ajouter nous o au fymbole, puifs
:, c. ni. c. ff.
Tom. r , Oper.
Ath.p.éoi.edit,
169%.
Sup, l. xxx. ». 8*
Ratr-11. c, 3. y*
ï n . c. i . •
que vous y avez ajouté, qui procédé du Pere ? Nous
l’avons fait, dites-vous, par l’autorité du concile
de C.P. à caufe des queftions furvenuës touchant
le faint Efprit. Mais pourquoi l’églife Romaine n’a*-
t-elle pas eu auffi l’autorité d’ajouter, ôc du Fils,
fuivant l’écriture fainte, pour prévenir d’autres
queftions ? Si vous dites que l’écriture ne dit pas en
termes formels que le faint Efprit procédé du Fils,
quoiqu’elle ledife en fubftance ? montrez-nous où.
elle dit en termes formels, que le faint Efprit doit
être adoré Scglorifié avec le Pere ôc le F ils , & qu'il
a parlé par les Prophètes, comme porte le concile
de C.P? Or , il a été neceifaire de dire expreflé-
ment, que le faint Efprit procédé du Fils, pour
condamner ceux qui diioient que ne procédant
que du Pere, il étoit un autre Fils, ôc n’étoit point
l’Efprit du Fils.
Entre les peres Grecs,Ratram cite principalement
faint Athanaie; mais il n’en allégué qua^rs ouvrages
fuppofez, le fymbole que l’on croit aujourd’hui
être de Vigile Thapfe, le livre des propres perfon-
nes, autrement les huit livres de la T rinité, & la
diipute contre Arius, qui eft du même Vigile. Il
cite faint Grégoire de Nazianze ôc Didyme d’Alexandrie.
Mais ces principales preuves font tirées des
peres Latins ; ôc il montre que les Grecs ne peuvent
les recufer, fans fe déclarer.ichifmatiques, en prétendant
que l’églife n’eft que chez eux. Saint Am-
L i v r e c e n q u a n t e u n i e ’ m e . 105
broife dit nettement, que le faint Efprit procédé
du Pere ôc du Fils. S. Auguftin expliquant l’évangile
de S. Je an , traite expreffément la queftion, &
décide, que le faint Efprit procédé du Pere ôc du Fils,
puifqu’il eft l’Efprit de l’un &c de l’autre: au lieu
que le Fils n’eft Fils que du Pere, ôc Je Pere n’eft
Pere que du Fils. Pourquoi donc le Fils, dit-il Amplement,
que le faint Efprit procédé du Pere ? c’eft
parce qu’il rapporte tout à celui dont il vient lui-
même, comme quand il dit : Ma doélrine n’eft pas
à moi, mais à celui qui m’a envoyé. S. Auguftin répété
la même chofe dans l’ouvrage de la Trinité,
où il l’explique plus à fonds.
Dans le quatrième livre, Ratram traite des neuf
autres reproches que les Grecs faifoient aux Latins.
Onauroitpûlespafferfousiilence, dit-il, puifqu’ils
ne regardent point la foi ; n’étoit le péril de fcanda-
lifer les foibles. Il ne s’agit ici que des coûtumes des
églifes, qui ont toujours été différentes, ôc ne peuvent
être uniformes.Dès le commencement,dansl’é-
glife de Jerufalem les biens étoient en commun,mais
on n’obligeoit pas les autres églifes à l’imiter. Il rapporte
enfuite le paffage de Socrate, touchant lesdif-
ferens ufages des églifes.
Venant au détail, il commence par le jeûne du
famedi; ôc foûtient que la plupart des églifes d’Oc-
cident ne l’obfervent pas, ôc que celle d’Alexandrie
l’obferve comme la Romaine. Au fonds cette pratique
eft de foi indifférente ; fur quoi il cite la lettre
de faint Auguftin a Cafulan, ôc ajoüte, que dans
la grande Bretagne, on jeunoit tous les vendredis,
C c iij
II. C. 4. . ■
■Aniby, 1 .de Sp*
S* c. i, n. 119, I2(D.
Aug, traft. 99^
in Joan, n. ff.
n, 8,
Joan, v u , iff,
xv. •
Trin, c, 17. iff.
17 .
X V I .
Articles de di£«
cipline. ‘ '
c, i.
c, t .
Socr. v . hifi,
Sup, liv , x x v i«
n, jo.
Aug,.. eÿ. 8ff*a