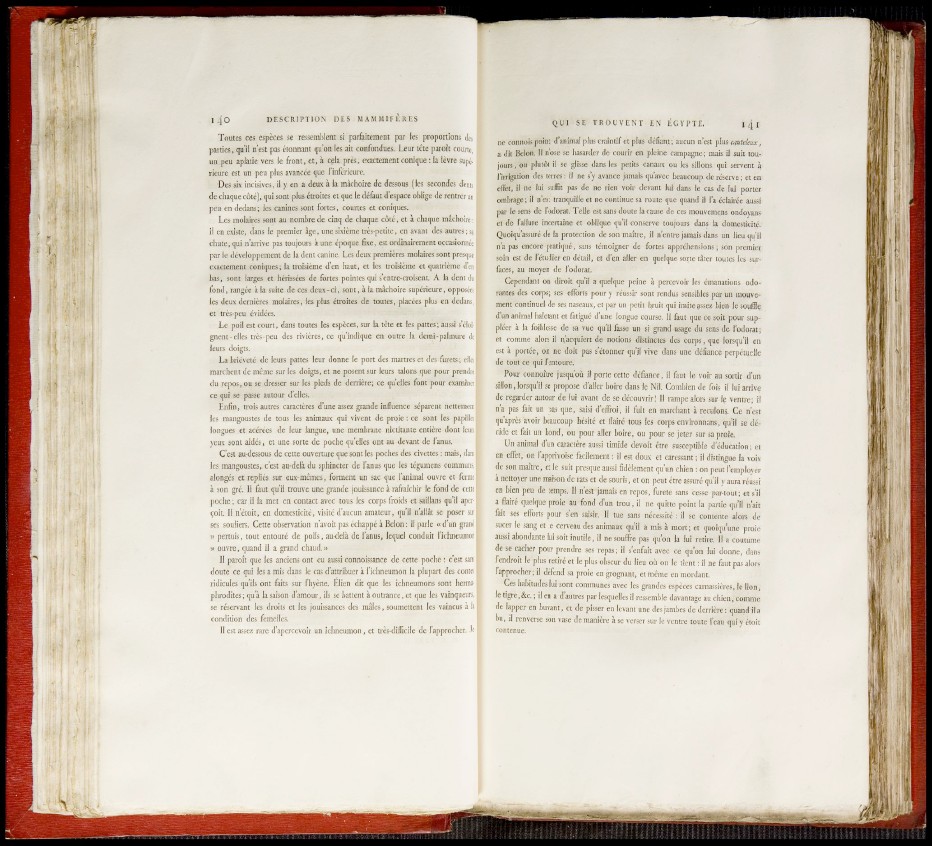
• f
il I 4 0 D E S C R I P T I O N D E S M A M M I F IL R E S
Toutes ces espèces se ressemblent si parfaitement par les propor t ions des
parties,, qu'il n'est pas é tonnant qu'on les ait confondues. Leur tête pai-oît courte,
u n peu aplatie vers le f r o n t , e t , à cela près, exactement conique : la lèvre sup¿.
rieure est un peu plus avancée que l'inférieure.
Des six incisives, il y en a deux à la mâchoire de dessous (tes secondes deni>
de chaque côté) , qui sont plus étroites et que Le défaut d'espace oblige de rentrer un
peu en dedans ; les canines sont for t e s, courtes et coniques.
Les molaires sont au n omb r e de cinq de cliaque c o t é , et à chaque mâchoire;
il en existe, dans le premier âge, une sixième très-petite, en avant des autres ; sa
chute, qui n'arrive pas toujours a u n e époque fixe, est ordinaii-ement occasionnée
par le déve loppement de la dent canine. Les deux premières molaires sont presfjue
exactement conique s ; la troisième d'en haut , et les troisième et quatrième d'en
bas, sont larges et hérissées de fortes pointes qui s'entre-croisent. A la dent du
fond , rangée à la suite de ces d e u x - c i , s o n t , à k mâchoire supérieure, opposée;
les deux dernières molaires, les plus étroites de tout e s, placées plus en dedans,
et très-peu évidées.
L e poil est cour t , dans toutes ies espèces, sur la tete et les pattes; aussi s'éloignent
elles très-peu des rivières, ce qu'indique en out re la demi -pa lmur e de
leurs doigts.
La briéveté de leurs pattes leur d o n n e le por t des martres et des fur e t s ; elles|
marchent de même sur les doigts, et ne posent sur leurs talons que pour prendre:
du r epos , ou se dresser sur les pieds de den-ière; ce qu'elles font pour examiner
ce qui se passe autour d'elles.
Enfin, trois autres caractères d'une assez grande influence séparent nettemeni
les mangoustes de tous les animaux qui vivent de proi e •. ce sont les papillelongues
et acérées de leur langue, u n e membr ane nictitante entière d o n t leun
yeux sont aidés, et une sorte de poche qu'elles o n t au devant de l'anus.
C'est au-dessous de cette ouverture que sont les poches des civettes : mais, dansj
les mangoustes, c'est au-delà du sphincter de l'anus que les tégumens comminu,
alongés et repliés sur e u x -même s , forment un sac que l'animal ouvre et ferme
à son gré. Il faut qu'il trouve une gi'ande jouissance à rafraîchir le fond de cette
poche ; car il la me t en contact avec tous les corps froids et saillans qu'il aperçoit.
Il n' é toi t , en domesticité, visité d'aucun ama t eur , qu'il n'allât se poser suil
ses souliers. Ce t t e observation n'avoit pas échappé à Belon : il parle « d'un grand ^
» pertuis, tout entour é de poi l s , au-delà de l'anus, le([uel condui t l'ichneimioi:
M o u v r e , quand il a grand chaud. »
Il paroit que les anciens ont eu aussi connoissance de cette poche : c'est san-1
J o u t e ce qui les a mis dans le cas d'attribuer à l'ichneumon la plupart des conte; ;
ridicules qu'ils ont faits sur l'hyène. Élien dit que les i chneumons sont hermaphrodites;
qu'à la saison d ' amo u r , ils se battent à out r anc e , et que les vainqueiivi,
se réservant les droits et les jouissances des mâ l e s , soumettent les vaincus à la
condition des femelles.
Il est assez rare d'apercevoir un i c h n c umo n , et très-diilicile de l'approcher. Je
QUI SE T R O U V E N T EN l Î G Y P T E . i l
ne coniiois point d'anijnal plus craintif et plus défiant ; aucun n'est plus cauteleux,
a. dit Belon. Il n'ose se hasai-der de courir en pleine c ampagne ; mais il suit toujours,
ou plutôt il se glisse dans les petits canaux ou les silions qui servent à
l'irrigation des terres: il ne s'y avance jamais qu'avec beaucoup de réserve ; et en
eiïèt, il ne lui suffit pas de ne rien voir devant kr dans le cas de lui por t e r
ombrage ; il n'est tranquille et ne continue sa route que quand il l'a éclairée aussi
par le sens de l'odorat. Te l le est sans dout e la cause de ces mouvemen s ondoyans
et de l'allure incertaine et oblique qu'il conserve toujours dan« la doinesticité.
Quoiqu'assuré de la protection de son maître, il n' ent r e jamais dans un lieu qu'il
n'a pas encore pr a t iqué , sans témoigner de fortes appréhensions ; son premier
soin est de l'étudier en détail, et d'en aller en quelque sorte tâter toutes les surfaces,
au moyen de l'odorat.
Cependant on diroit qu'il a quelque peine à percevoir les émanations o d o -
rantes des corps ; ses efforts p o u r y réussir sont rendus sensibles par un mo u v e -
ment continuel de ses naseaux, et j>ar un petit bruit qui imi te assez bien le souffle
d'un animal haletant et fatigue d'une longue course. Il faut que ce soit p o u r suppléer
à la foiblesse de sa vue qu'il fasse un si grand usage du sens d e l'odorat;
et c omme alors il n'acquiert de not ions distinctes des c o r p s , que lorsqu'il en
est à por t é e , on ne doit pas s'étonner qu'il vive dans une défiance perpétuelle
de tout ce qui l'entoure.
Pour connoître jusqu'où il por t e cette dé f i anc e , il faut le voir au sortir d'un
sillon, lorsqu'il se propos e d'aller boire dans le Nil. Combi en de fois il lui arrive
de regarder autour de lui avant de se dé couvr i r! 11 r ampe alors sur Iç vent r e ; il
n'a pas fait un pas que, saisi d'effroi, il fuit en mai-chant à reculons. Ce n'est
qu'après avoir beaucoup hésité et flairé tous les corps envi ronnans , qu'il se dé -
cide et fait un b o n d , ou pour aller boire, ou p o u r se jeter sur sa proie.
Un animal d'un caractère aussi timide de voit être susceptible d'éducation ; et
en effet, on l'apprivoise facilement : il est doux et caressant ; il distingue la voix
de son maître, et le suit presque aussi fidèlement qu'un chien : on peut l'empio}er
à nettoyer une maison de rats et de souris, et on peut être assuré qu'il y aura réussi
en bien peu de temps. Il n'est jamais en r epos , furete sans cesse par-tout; et s'il
a flairé quelque proie au fond d'un t r o u , il ne quitte point la partie qu'il n'ait
fait ses efforts pour s'en saisir. II tue sans nécessité : il se cont ent e alors de
sucer le sang et le cerveau des animaux qu'il a mis à mo r t ; et q u o i q u \me proi e
aussi abondante lui soit inutile, il ne souffi-e pas qu'on la lui retire. Il a coutume
de se cacher pour pr endr e ses repas; il s'enfuit avec ce qu'on lui d o n n e , dans
fendroit le plus retiré et le plus obscur du lieu où on le tient : il ne faut pas alors
l'approcher; il défend sa proie en grognant, et même en mordant .
Ces habitudes lui sont commune s avec les grandes espèces carnassières, le l ion,
le tigre, &c. ; il en a d'autres par lesquelles il ressemble davantage au chi en, c omme
de lapper en buvant , et de pisser en levant une des jambes de de r r i è r e : quand ila
bu, il renverse son vase de manière à se verser sur le ventre toute l'eau qui y étoit
contenue.